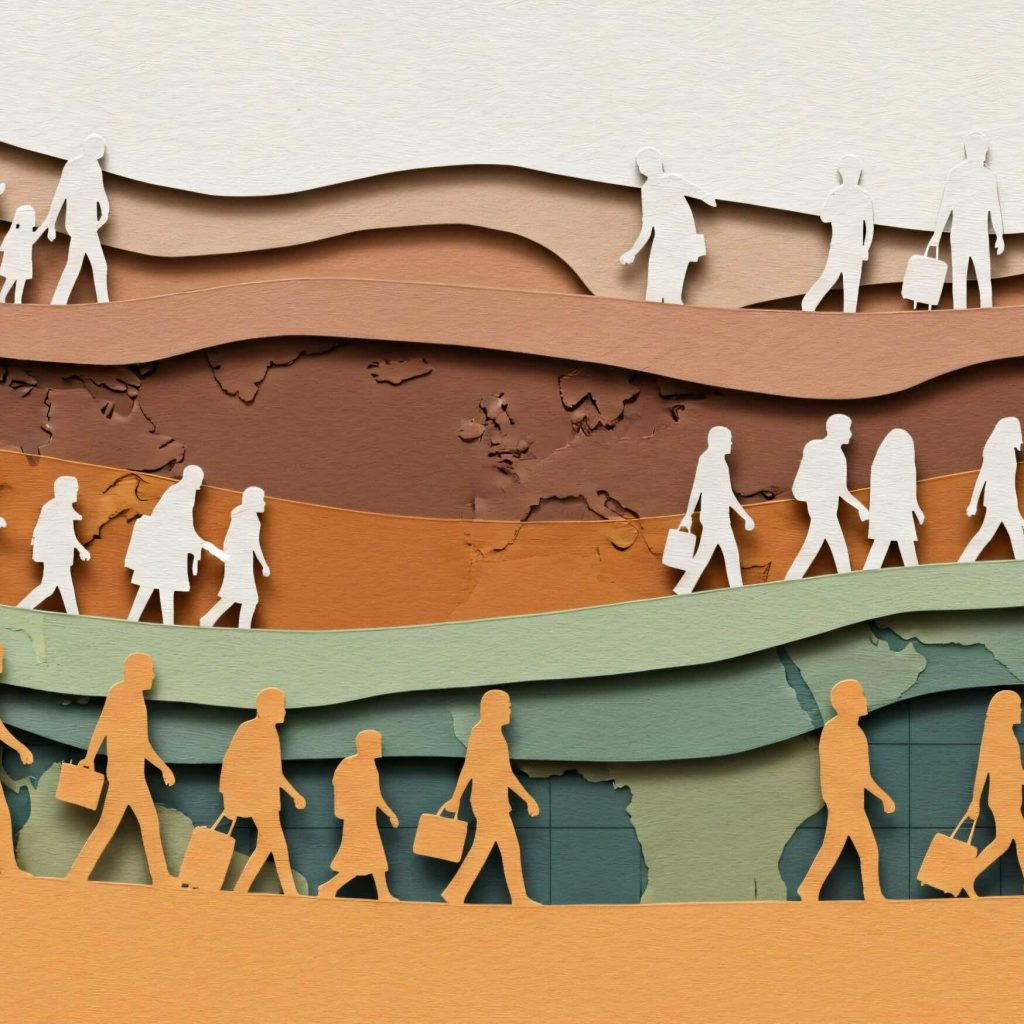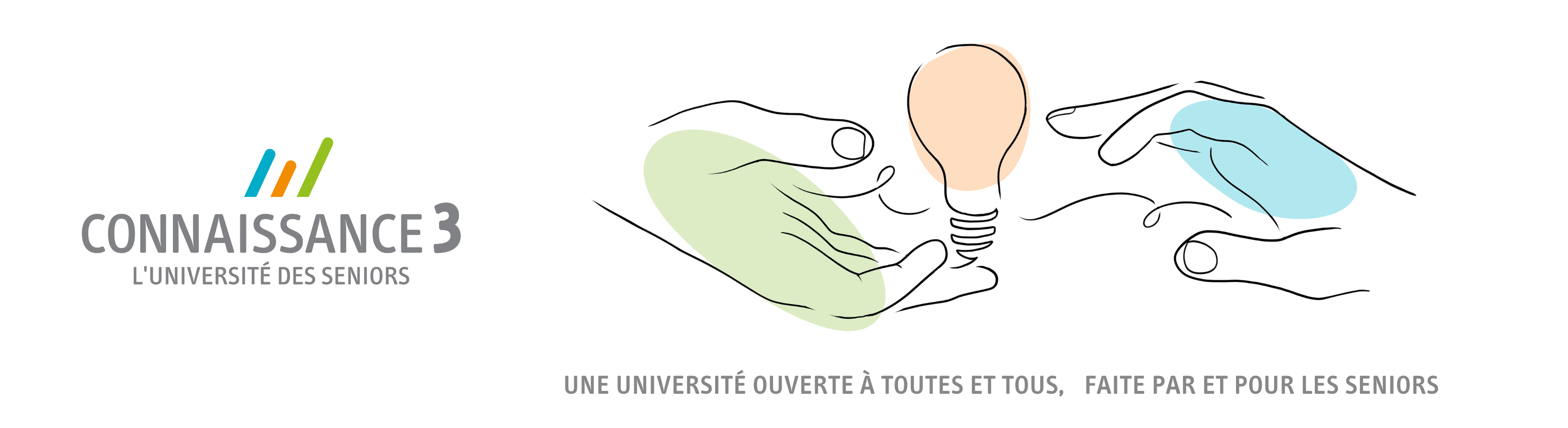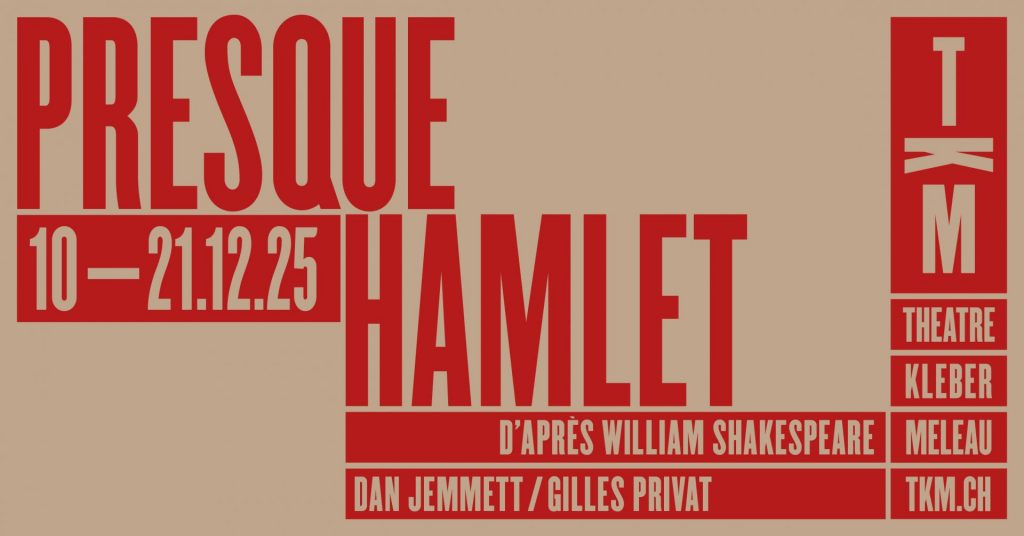Dans le cadre d’un partenariat avec la Revue d’information sociale REISO, les conférenciers de Connaissance 3, dont les thématiques touchent à l’action sociale et à la santé publique, se voient proposer la rédaction d’un article de fond autour de leur intervention. Ces articles paraissent en marge des conférences et contribuent à la visibilité de Connaissance 3, tout en permettant aux participant-e-s aux conférences de conserver une trace du sujet abordé.
Au début des années 70, la sexualité devient un sujet de préoccupation, forçant la parole publique à s’y intéresser. Le développement de cours d’éducation dans les écoles relève de ce mouvement.
Un taux élevé de handicap visuel est lié aux deux formes de dégénérescence maculaire liée à l’âge chez les personnes de plus de 55 ans, faisant de cette maladie un véritable enjeu de santé publique.
En cours, la révision du système de politique de retraites, et plus particulièrement celle du deuxième pilier, devrait contribuer à respecter les engagements pris par le passé pour assurer une vraie retraite populaire.
De la première greffe de cœur, réalisée en 1967, à celle effectuée récemment avec un organe de cochon humanisé implanté chez un homme, ce domaine de la médecine évolue sans cesse. Tour d’horizon sur le fonctionnement suisse en la matière.
Avec l’âge, les facultés auditives tendent à diminuer, provoquant un effort émotionnel chez le·a senior et favorisant son isolement social. Comprendre cette perte progressive aide à mieux accepter le trouble.
Amener la créativité au chevet du patient adulte ouvre un espace-temps qui apaise et reconnecte corps et esprit. Il convie l’essence réparatrice, intime, d’une personne malade et contribue à prendre soin de son équilibre psychologique.
Si le burnout existait déjà avant le Covid, les sources de stress professionnel se sont multipliées depuis mars 2020. En parallèle, l’absence de loisirs, de sport ou d’interactions sociales ont mis à mal l’équilibre psychique.
Sophie Reviron, « Manger suisse! Pourquoi et comment? », REISO, Revue d’information sociale, mis en ligne le 9 mars 2020
Grâce à la proximité, manger suisse a des effets positifs directs sur l’économie et l’environnement. De plus, des bénéfices nutritionnels indirects résultent de la part accrue de produits frais et peu transformés dans les menus.
Dans l’ombre du jeunisme ambiant, l’image publique des seniors se résume souvent à leurs besoins matériels et au coût de leur santé fragilisée. Leurs compétences et leur disponibilité au service de la société sont rarement mises en avant.
Carla Gomes da Rocha, « La douleur chez la personne âgée », REISO, Revue d’information sociale, mis en ligne le 12 décembre 2019
Elle est souvent mal évaluée et insuffisamment traitée. La douleur n’est pourtant pas une fatalité de l’âge ! Une évaluation globale et un plan de soins coordonnés par l’infirmière peut améliorer tant l’état de santé que l’autonomie de la personne.
Elisabeth Parmentier et Lauriane Savoy, « Que devient la Bible entre les mains des femmes? », REISO, Revue d’information sociale, mis en ligne le 5 décembre 2019
L’attitude d’ouverture de Jésus à l’égard des femmes est manifeste. Elle se perd peu à peu pour ne renaître qu’au XIXe siècle. Aujourd’hui, de nombreuses théologiennes réinterprètent ensemble les passages controversés de la Bible.
Les rumeurs et les fake news ne naissent pas de la prétendue crédulité de personnes adeptes de complots. Elles surgissent quand un rapport social est inégalitaire et quand la démocratie échoue à offrir un espace d’échanges libres.
Kevin Selby et Omar Kherad, « Actes médicaux inutiles: le rôle du patient », REISO, Revue d’information sociale, mis en ligne le 28 octobre 2019
Dans les systèmes de santé développés, entre 20 et 30% des actes médicaux seraient injustifiés. Un mouvement médical grandissant vise à combattre cette surconsommation de soins. En Suisse aussi! Cette révolution culturelle se fera avec les patients.
Qu’est-ce que le racisme et son expression contemporaine? Quel rapport y a-t-il entre racisme et sexisme ? Quel rôle peut jouer la culture dans une société démocratique et ouverte?
Les discours transhumanistes prônent l’amélioration du corps humain en corrigeant ses limites. Cette idéologie, creuset du narcissisme contemporain, semble éloigner l’homme du monde réel. En fait, magnifie-t-elle ou déteste-t-elle les corps?
Déchets toxiques provoquant des maladies graves, conditions de travail inhumaines, travail des enfants… Une initiative populaire veut obliger les multinationales suisses à respecter les droits humains et l’environnement.
Ethique et politique font-ils bon ménage ? Un vif débat oppose tenants des droits humains et avocats des intérêts politiques et économiques. Présentation de six valeurs clés pour les Etats et les sociétés qui aspirent à la justice.
Roger Darioli, « Demain, tous véganes? », REISO, Revue d’information sociale, mis en ligne le 22 octobre 2018
Pas un jour sans que les médias publient des informations sur l’activité et les revendications des véganes! Mais combien sont-ils? Qu’en est-il au niveau nutritionnel? Que concluent les études de cohorte et les rapports des experts?
Kaj Noschis, « Comment habiter avec son âge? », REISO, Revue d’information sociale, mis en ligne le 21 juin 2018
Une étude exploratoire sur des seniors vaudois a montré combien ils tiennent à vivre chez eux le plus longtemps possible. Pas par habitude mais pour rester «utiles aux autres» et mener les activités sociales qui font sens pour eux.
La société reconnaît l’immense travail accompli par les proches aidant·e·s en Suisse. En revanche, ils et elles ne sont pas encore reconnus comme un partenaire incontournable dans les diverses étapes socio-sanitaires de l’accompagnement.
Il existe des lésions organiques sans douleur et des douleurs sans cause. Sensations, émotions, mémoire et environnement social interagissent sans discontinuer. Analyse des hypothèses actuelles pour cerner les ruses de la douleur.
Fatouma Diawara, « Les prises de décisions en fin de vie », REISO, Revue d’information sociale, mis en ligne le 24 novembre 2016
Les soins palliatifs mettent les malades et leurs proches au centre des prises de décisions thérapeutiques. Comment assurer des soins qui respectent leur volonté et leur définition personnelle de ce qu’est la «qualité de vie»?
La liberté d’expression est un droit fondamental. Le respect de la dignité humaine l’est aussi. Cette liberté trouve sa limite lorsque le respect n’est plus garanti.
Michel Oris, « Inégaux jusque dans la vieillesse », REISO, Revue d’information sociale, mis en ligne le 20 octobre 2016
Des recherches ont étudié les conditions de vie et de santé dans la population de 65 ans et plus résidant en Suisse. Elles montrent que les inégalités subsistent et parfois s’amplifient. Elles constatent aussi des progrès réels.
Patrick Bodenmann, Françoise Ninane, Brigitte Pahud-Vermeulen, Elodie Dory, Martine Monnat, Jacques Cornuz, Eric Masserey, « Dispositif sanitaire pour les nouveaux migrants », REISO, Revue d’information sociale, mis en ligne le 1er février 2016
Les réfugiés ont des besoins sanitaires spécifiques qui nécessitent une réponse « généraliste » interdisciplinaire. Elle doit être rapide et adaptée. Comment fonctionne le dispositif mis en place dans le canton de Vaud?
A l’occasion d’une conférence du Dr Jean Martin sur l’éthique médicale, REISO a sélectionné une quarantaine d’articles et de recensions du médecin de santé publique publiés dans la revue depuis 2010.
Sophie Swaton, « L’économie sociale et solidaire », REISO, Revue d’information sociale, mis en ligne le 26 novembre 2015
Les entreprises sociales et solidaires représentent désormais un emploi sur dix en Suisse romande. Dans quels secteurs travaillent-elles ? Avec quelles ambitions ? Quels principes de base doivent-elles respecter ?
Aujourd’hui comme hier, les racistes pratiquent la discrimination raciale en faisant appel à une prétendue hiérarchisation des races. La lutte doit être menée sans répit contre leurs discours de haine opiniâtre.