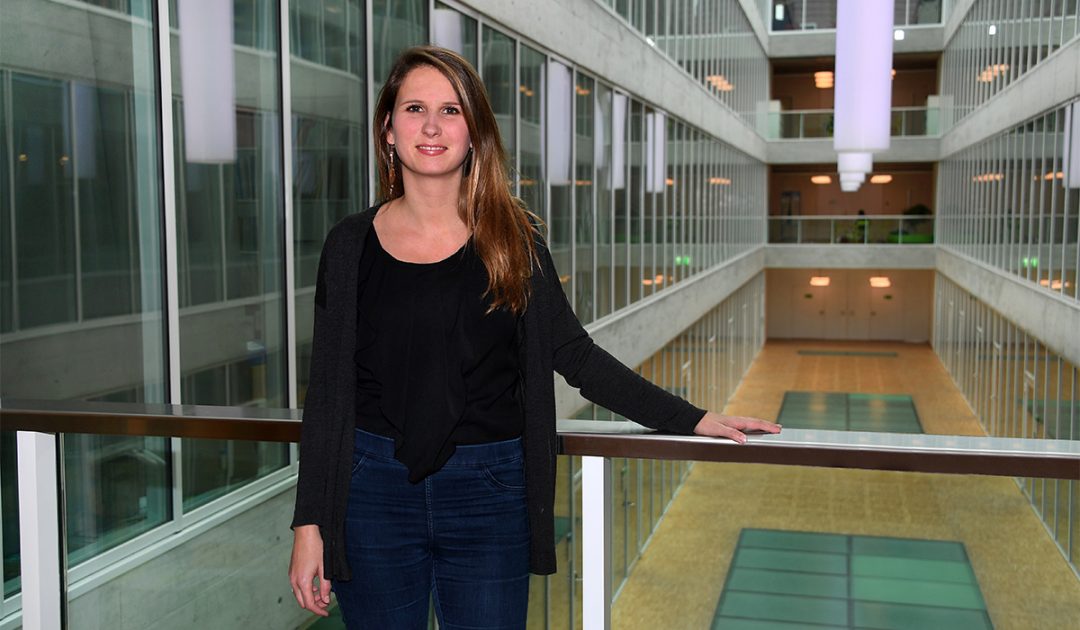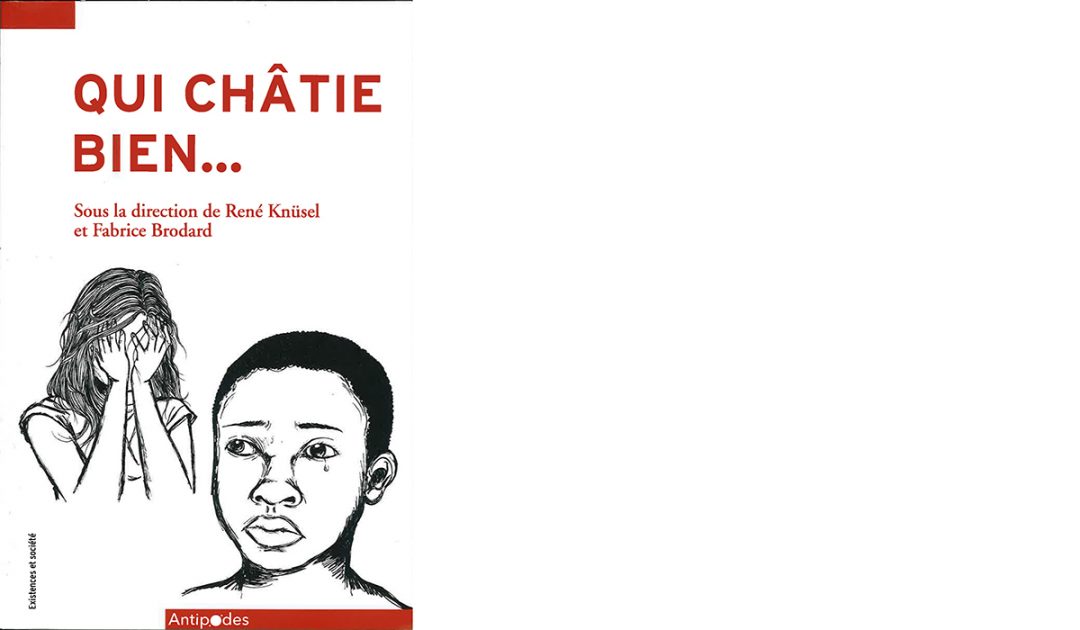C’est un mélange d’art carnavalesque, graphique, visuel, musical, théâtral, mural, numérique et d’activisme, une forme d’expression artistique collective et politique. Petit tour en artivisme avec Monika Salzbrunn, Raphaela von Weichs et Sara Wiederkehr.
On ne dira pas que c’est un sujet facile. Déjà, il faut se projeter dans le Sud méditerranéen (Nice, Marseille, Gênes ou Viareggio), mais aussi à Bruxelles ou à Cologne, puis au Cameroun et en Californie. On va suivre la professeure Monika Salzbrunn, socio-anthropologue attachée à la Faculté de théologie et de sciences des religions. Ça tombe bien, des expériences carnavalesques alternatives se préparent dans les ruines d’un ancien couvent génois, épousant les rituels catholiques et les anciens codes carnavalesques, pour à la fois se situer historiquement et détourner ces expressions – initialement associées à un pouvoir politico-religieux – au profit d’un discours féministe, populaire et politique dénonçant la spéculation actuelle, les privatisations hasardeuses et le surtourisme.
Au cœur d’un réseau alternatif
La professeure Salzbrunn dirige depuis plusieurs années un projet soutenu par le Conseil européen de la recherche (ERC) autour de l’alliage renouvelé entre l’art et l’activisme, autrement dit l’artivisme. Elle a écumé les carnavals européens officiels et alternatifs et rencontré quantité de militantes et militants lassés par les expressions politiques traditionnelles. En Italie, par exemple, on peut citer Simona Ugolotti, qui détourne la messe pour honorer la mémoire des combattantes oubliées de la Résistance italienne durant la Seconde Guerre mondiale.
À la fin de cette messa partigiana, la distribution des hosties est remplacée par l’attribution à chaque participant d’un billet portant le nom d’une de ces résistantes. Autre exemple lors de la fête de la Saint-Jean-Baptiste le 24 juin : la portée en procession de grandes cartes du tarot, inspirées du peintre génois Emanuele Luzzati, par des activistes soucieux d’illustrer l’opposition entre la globalisation heureuse et les portes qui se referment aujourd’hui sur les migrants. L’accès à l’espace public est aussi un enjeu pour ces habitantes et habitants dans une ville appauvrie, bien loin de son glorieux passé…
S’opposer à l’extrême-droite
L’artivisme est donc une expression essentiellement non muséale et une manifestation de solidarité (notamment durant la période Covid). Les références sont plutôt contemporaines (ou issues du XXe siècle) mais les personnes impliquées possèdent rarement une formation artistique. Monika Salzbrunn évoque, pour simplifier, une « perspective par le bas » et la renaissance d’un art carnavalesque à portée subversive dans tout l’arc méditerranéen (côté européen), ainsi que dans le nord, par exemple à Bruxelles et à Cologne, où le carnaval alternatif est aussi une manière de s’opposer à l’extrême-droite.
La professeure entraîne volontiers ses étudiantes et étudiants sur ces terrains – ainsi, Federica Moretti a réalisé sa thèse sur les carnavals et autres événements festifs dans la région de Nice – non sans prendre quelques précautions ; en effet, ces expressions politico-artistiques, qui se veulent non violentes, peuvent se heurter à une répression policière en certaines circonstances aggravées par exemple par la crise des gilets jaunes en France.
Des artistes menacés au Cameroun
Au Cameroun, les limites à ne pas dépasser paraissent plus étroites qu’en Europe et plus mystérieuses, un dessin à première vue anodin pouvant conduire son auteur en prison, alors même que l’intention d’attaquer le pouvoir n’y était pas forcément. « C’est très arbitraire », relate Raphaela von Weichs, chercheuse senior sur ce projet ERC et spécialiste de la bande dessinée. Le neuvième art reste, selon elle, grâce à sa subtilité un moyen d’expression plus ou moins toléré par un gouvernement autoritaire, engagé qui plus est dans une guerre avec des séparatistes anglophones eux-mêmes violents.
« La BD n’est pas acceptée par la société camerounaise, sinon comme un média pour les enfants, mais on ne peut pas entraver un tel dynamisme qui se déploie avec le soutien de l’Institut français, de l’Institut Goethe ou encore des ambassades suisse et belge, chacun poursuivant bien entendu ses propres intérêts en matière de politique culturelle », décrit-elle. Un festival se déploie d’ailleurs à Yaoundé et à Douala, et l’édition 2023 se tiendra dès le 22 novembre. Ces jeunes bédéistes font preuve d’une belle créativité graphique et numérique, quitte à recourir à des codes humoristiques subtils dans un pays où chaque réalisation doit être dûment déclarée et soumise à autorisation.
Un point de vue africain
La recherche montre bien qu’il s’agit pour eux d’exprimer un point de vue africain (et non une vision occidentale en surplomb), de distraire leur public et de s’amuser, mais aussi de gagner leur vie en s’inscrivant dans une « industrie créatrice émergente », via la BD, les jeux vidéo, le graphisme, l’édition numérique ou encore la mode. « Il y a beaucoup d’artistes avec des formations universitaires en art, mais aussi des amateurs qui ont tout appris sur Internet et vendent maintenant leurs créations et leurs compétences dans leur pays mais aussi à l’international », résume la chercheuse, qui a coréalisé le film documentaire Street sur un défilé de mode locale dans une rue renouvelée par les artistes muralistes. « Il y a toute cette énergie qui se dégage, j’ai l’impression pour ma part qu’ils sont tous jeunes », sourit-elle.
L’art mural en Californie
Et maintenant : la Californie, où Sara Wiederkehr a contribué non seulement à cette vaste recherche anthropologique mais encore à la réalisation d’une peinture murale dans la chaleur du désert à Pacoima, un quartier de Los Angeles. « L’art mural est né au Mexique autour de Diego Rivera et de Frida Kahlo », rappelle Monika Salzbrunn. Les femmes américaines d’origine mexicaine établies en Californie se sont saisies de cet héritage pour en faire un outil d’émancipation, de réappropriation historique et de lutte contre les inégalités, voire de réconciliation de différents peuples en lutte, comme Judy Baca, qui a ainsi donné du travail et occupé toute une jeunesse reléguée à la périphérie.
Débutée au milieu des années 1970, la réalisation de son Great Wall of Los Angeles se poursuit aujourd’hui pour intégrer d’autres jeunes et d’autres histoires. Sara Wiederkehr a ainsi travaillé avec Kristy Sandoval, une célèbre muraliste xicana. Il y a selon elle de nombreux artistes dans cette région, soucieux de faire de Pacoima un centre d’art mural aussi fameux que Boyle Heights, un autre quartier latino de L.A. qui fut pionnier dans le street art.
Pour les non-connaisseurs, cet art urbain semble être par son essence même – réactive, insaisissable et pas d’emblée dans la recherche esthétique – un geste collectif tourné vers des objectifs sociaux, mais quelques noms peuvent émerger, qui finissent par se frayer un chemin paradoxal dans une galerie ou un événement prestigieux comme la Miami Art Fair, ou encore par décrocher un financement de la ville. On pense aussi à un Jean-Michel Basquiat, devenu à juste titre une valeur sûre dans le marché de l’art. Pour Monika Salzbrunn et ses collègues cette rançon du succès, en quelque sorte, se paie parfois d’une déperdition de ce fragile alliage entre l’art et l’activisme.
Question(s) de méthode

Mettre la main à la pâte, utiliser soi-même la peinture, le dessin, la photo, comme Sara Wiederkehr en Californie ou Raphaela von Weichs au Cameroun, permet de mieux comprendre son terrain et de le faire connaître, quitte à le prendre avec soi pour le ramener un jour à Lausanne, le faire circuler dans un événement public à la Maison de quartier sous-gare et à la Ferme des Tilleuls de Renens (avril 2022) en présence de certains interlocuteurs privilégiés, dans l’idée de briser les frontières entre les mondes scientifique, militant et artistique. Il s’agit de repousser ce que Monika Salzbrunn appelle « la tentation hégémonique du chercheur ». Cette « immersion multisensorielle » fait donc partie du travail scientifique, de même que le fait de visionner avec les personnes concernées les premiers montages des films documentaires qu’elle réalise avec ses collaboratrices, et d’échanger en intégrant les remarques formulées, dans un effort de « coconstruction ». La restitution du travail dans le respect des interlocuteurs et via des supports divers – pas uniquement des textes académiques – devient ainsi aussi importante que le travail lui-même. Le long-métrage Créer, résister, exister et le court-métrage Défilé Maddalena la Superba en sont la preuve. « Notre rôle n’est pas non plus d’idéaliser ces mouvements », précise Raphaela von Weichs, en guise de conclusion toujours temporaire.