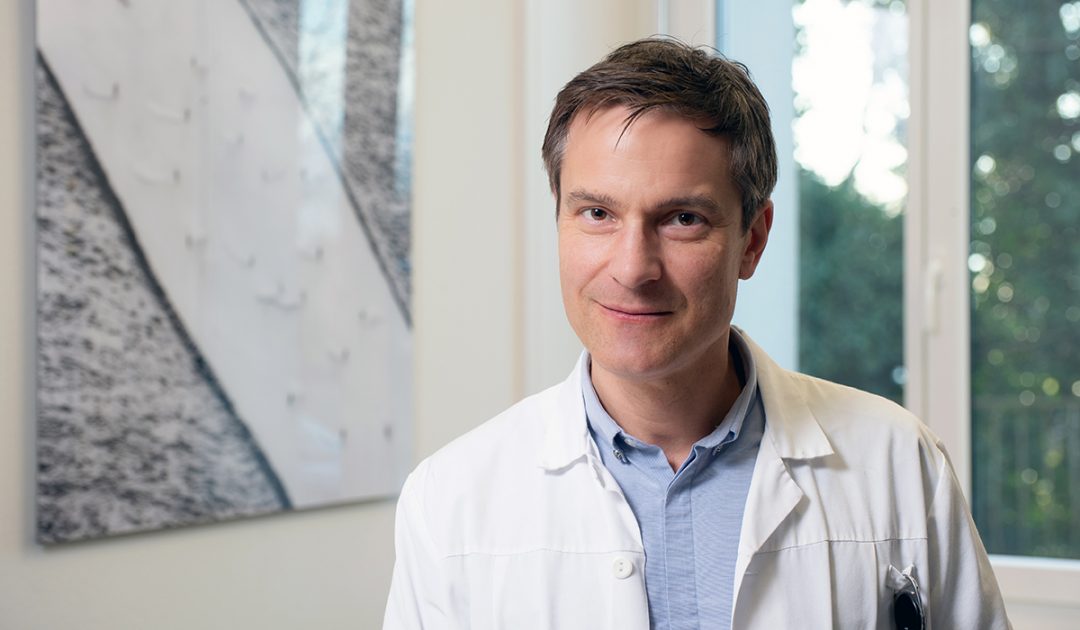La toute première Journée de droit pénal de l’UNIL, consacrée aux infractions contre l’intégrité sexuelle, a eu lieu le 15 septembre 2021. Entre cyberharcèlement, revenge porn et définition du viol, ce thème est tout particulièrement d’actualité, comme nous l’explique sa coorganisatrice, Camille Perrier Depeursinge, professeure associée au Centre de droit pénal de l’UNIL.
Comment avez-vous eu l’idée d’organiser une telle journée ?
Camille Perrier Depeursinge : Cela nous semblait, à la professeure Nathalie Dongois et moi-même, une excellente manière de susciter les débats autour d’une question d’actualité. C’était également une façon de mettre en avant la spécificité de l’UNIL qui est d’avoir, au sein de la même faculté, une école de droit et une école des sciences criminelles (sciences forensiques et criminologie) ainsi que d’encourager la pluridisciplinarité.
Quel public visiez-vous ?
Juges, procureur·e·s et avocat·e·s, de même que les étudiant·e·s en droit – hommes et femmes, bien sûr !
Pourquoi avoir choisi ce thème en particulier ?
Comme avocate et présidente d’Ajures, l’Association pour la justice restaurative en Suisse, il me semblait important de questionner la prise en charge judiciaire des victimes et auteurs d’infractions contre l’intégrité sexuelle. Mais surtout, des modifications du « droit pénal sexuel » ont été proposées et ont fait l’objet d’une procédure de consultation au début de 2021. On s’interroge par exemple sur la notion de viol. Comment le définir ? Actuellement, ce terme recouvre exclusivement la pénétration contrainte d’un pénis dans un vagin. Or cette définition semble très éloignée de la réalité vécue. Pour les victimes d’autres actes contraints, elle est difficile à comprendre. Aujourd’hui, il y a quasiment unanimité pour étendre la définition du viol à tout acte sexuel forcé qui implique une pénétration du corps.
Les changements sociaux nous obligeraient donc à revoir cette définition ?
Oui, mais pas seulement. On sait aujourd’hui qu’un phénomène dit « de sidération » touche 40 à 70 % des victimes. Leurs sens se déconnectent, leur corps se fige, se met « en veille ». Elles ne se débattent pas et on ne relève par conséquent aucune trace de résistance – et l’auteur n’a pas à faire usage de « contrainte ». Ce qui nous amène à une autre question : la notion de contrainte est-elle véritablement pertinente ? Des courants féministes – dont je fais partie – considèrent qu’une vision plus saine de la sexualité consisterait à toujours exiger le consentement du ou de la partenaire avant un acte. Accepter un baiser ne signifie pas que l’on est d’accord d’avoir un rapport sans préservatif…
On a dû vous objecter que cela revient à enterrer le flirt et la drague…
Bien sûr, mais c’est faux ! Le débat ne se situe pas à ce niveau : c’est encore comme si, aujourd’hui, on considérait qu’il y a un sujet qui veut et propose – souvent l’homme – et un objet qui tolère jusqu’à ce qu’il résiste – souvent la femme. Il me semble qu’il faut changer la donne pour que, désormais, deux sujets qui veulent, ou non, soient l’un en face de l’autre. C’est justement grâce à cette notion de consentement que l’on ramène le projecteur sur le·a prévenu·e, qu’on le·a responsabilise : comment a-t-il·elle compris que son geste était accepté ?
C’est une petite révolution : il faudrait alors démontrer que l’on a reçu le consentement de l’autre et non plus prouver que la personne s’opposait à un acte donné.
Plutôt : il faudrait que celui ou celle qu’on accuse explique ce qui lui a fait comprendre que l’autre consentait à un certain acte (et lequel). S’il y a un doute, il y aura acquittement. Le·a prévenu·e n’a pas à « prouver » quoi que ce soit, juste à rendre vraisemblable que son ou sa partenaire souhaitait le rapport. Par rapport au droit actuel, ce changement législatif impliquerait néanmoins que l’on tracerait la ligne rouge en amont. Ces thèmes nous ont occupés durant toute la première partie de la journée. Nous avons aussi abordé la question de savoir de quelle manière de réagir au mieux lorsqu’une infraction est commise.
Une deuxième partie était consacrée aux interrogatoires et au rôle des expertises. Y a-t-il des nouveautés dans ce domaine ?
On le sait depuis longtemps mais les victimes, spécialement si elles sont jeunes, peuvent se rappeler les faits par bribes. Il faut veiller à les interroger sans influencer leurs déclarations. Par ailleurs, leur poser des questions sans les culpabiliser est essentiel et tout le monde n’est pas nécessairement formé pour cela. Nous nous sommes aussi intéressés aux outils dont disposent les juges pour apprécier la crédibilité des deux parties, pour savoir si une personne dit ou non la vérité et si, ou non, elle était responsable de ses actes.
Vous avez également abordé l’intégrité sexuelle sur Internet. Mais est-ce très différent de la « vraie vie » du point de vue des infractions ?
Justement, la réponse des autorités à ces comportements a souvent été que ce qui se passait en ligne devait obéir aux mêmes règles que la « vraie vie ». Or, si l’infraction demeure identique, son impact est beaucoup plus fort, car cet acte s’inscrit dans la durée et est visible par le monde entier. Cette discussion a été l’occasion de pointer les lacunes actuelles.
Existe-t-il des infractions d’un nouveau genre ?
Oui, le revenge porn, qui consiste à partager publiquement en ligne et sans le consentement des personnes impliquées un contenu sexuellement explicite, n’est pas reconnu comme une infraction. Le grooming (utiliser les réseaux pour tisser des liens d’amitié avec des mineurs dans le but d’avoir des rapports sexuels avec eux) non plus. Rien d’étonnant à cela : la dernière fois que le droit pénal sexuel a été repensé, c’était en 1985. Il mérite donc une bonne mise à jour !