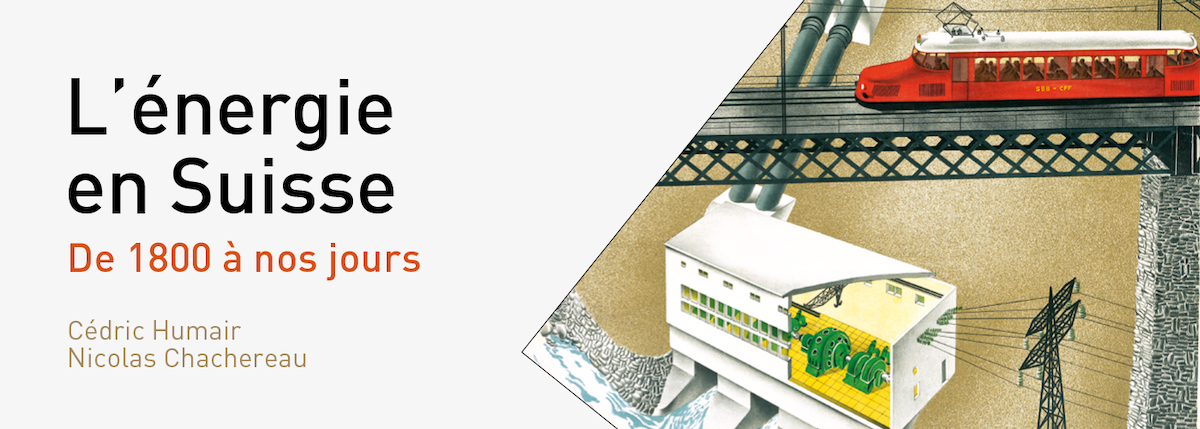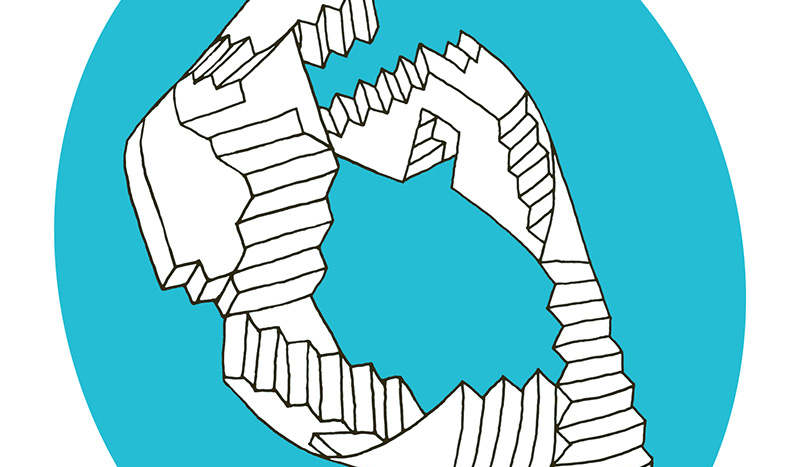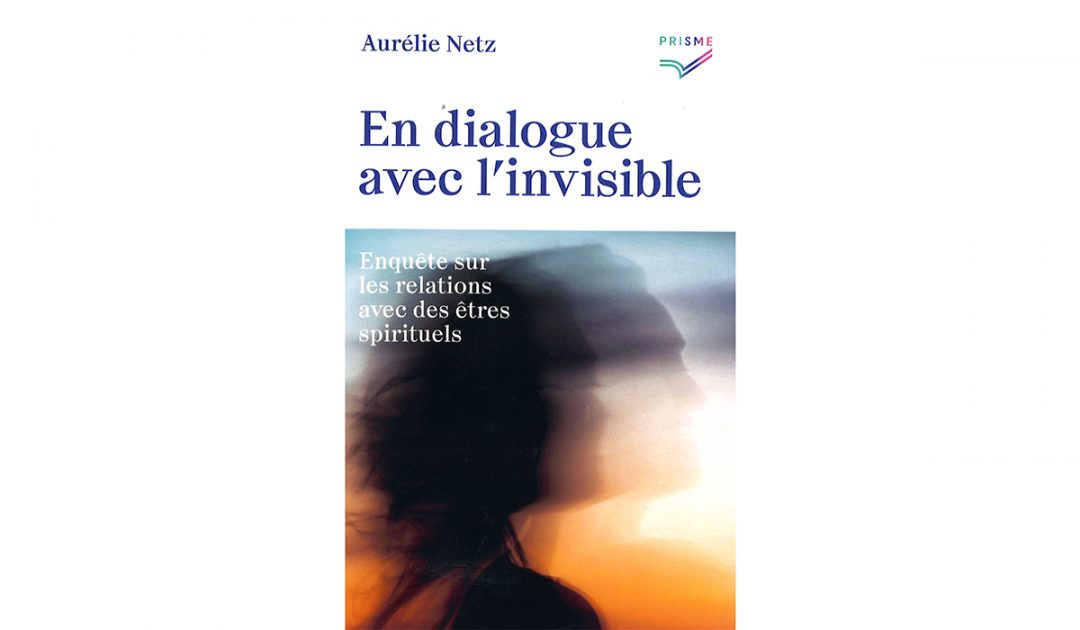En 160 pages, les historiens Cédric Humair et Nicolas Chachereau suivent le paquebot du mix énergétique helvétique sur 200 ans, abordant ses diverses composantes qui se superposent et se substituent les unes aux autres. Pour éviter le naufrage.
Ce « petit livre » présente un tour d’horizon des énergies utilisées en Suisse depuis le XIXe siècle. Mais pas seulement. L’énergie en Suisse. De 1800 à nos jours veut éclairer le débat et « éviter l’iceberg » que représente la situation climatique. En soulignant la difficulté d’une vraie transition énergétique.
« La Suisse s’est enrichie en consommant de l’énergie fossile et sa dette environnementale est donc lourde, écrivent Cédric Humair, maître d’enseignement et de recherche à l’UNIL, et Nicolas Chachereau, collaborateur scientifique à l’EPFL. Les Suisses ont une responsabilité dans le problème climatique, ce qui leur impose un devoir d’exemplarité. »
Spécificité helvétique
Si notre pays suit le trend commun aux sociétés occidentales avec une explosion de la consommation d’énergie en deux siècles, il possède aussi ses spécificités. L’hydroélectrique en fait partie. L’eau est devenue la « ressource phare » de notre système. La première centrale hydraulique d’Europe voit d’ailleurs le jour sur le Rhin, à Schaffhouse, en 1866. Et au cours de la première moitié du XXe siècle, les barrages fleurissent dans les Alpes.
Le bois reste cependant la principale source d’énergie sur notre territoire, avec la force humaine et animale, jusqu’au milieu du XIXe siècle. Au point que la déforestation est décriée et que des mesures doivent être prises à l’échelon national. Outre ses arbres, la Suisse possède aussi de la tourbe, mais très peu de charbon, qui plus est de piètre qualité. En outre, importer du charbon coûte cher. Devenues marginales au tournant de la fin du XIXe siècle, les tourbières connaîtront un regain d’intérêt avec les deux guerres, avant leur déclin et leur mise sous protection en 1987.
Nouvel essor
C’est l’arrivée du chemin de fer, dans les années 1850, qui renverse la vapeur. Le prix du charbon diminue. En 1870, il est déjà un tiers meilleur marché que le bois. Entre 1851 et 1916, sa part dans la consommation helvétique bondit de 3 à 82%. Le bois n’a désormais plus la cote, si ce n’est durant les guerres mondiales, où l’approvisionnement en charbon s’avère difficile.
Et le pétrole dans tout ça ? Il faudra attendre 1956 pour qu’il dépasse le charbon en Suisse. Sa consommation explose après le deuxième conflit mondial ; chauffage et voitures en profitent. « Le nombre de véhicules motorisés est multiplié par 18 entre 1946 et 1970 », détaillent les deux historiens.
Pourquoi un tel boom ? Essence et mazout sont bon marché, faciles d’utilisation. Et le lobby pétrolier parvient à imposer ses produits. Dans les années 1970, 78% de l’énergie primaire est ainsi fournie par le pétrole. En 2022, sa part a reculé à 36%. Le choc pétrolier de 1973 est passé par là, déclenchant une prise de conscience face à cette dépendance énergétique. Le gaz naturel commence à faire son apparition, mais modestement.
Atome et soleil
Avec le nucléaire, on passe de « l’eldorado énergétique » fantasmé à « l’enfer sanitaire et environnemental », soulignent les chercheurs. Les accidents de Tchernobyl en 1986, puis de Fukushima en 2011 remettent le renouvelable au goût du jour. Les Suisses décident même de renoncer à l’atome en 2017, mais celui-ci pourrait renaître de ses cendres « tel le phœnix », précisent Cédric Humair et Nicolas Chachereau.
Quant au photovoltaïque, il reste un marché de niche jusque dans les années 80. En 1990, il ne représente que 0,003% de la consommation finale d’électricité. Cette technologie devra attendre 2008 pour susciter davantage d’engouement. « En 2023, la production d’électricité solaire est 126 fois plus élevée qu’en 2008 », relèvent les historiens. Soit 6% de l’électricité produite en Suisse.
Un pays de pendulaires
Si l’industrialisation débute précocement en Suisse dès 1800, la mondialisation est plus lente à démarrer. Il faut attendre le milieu du XIXe siècle et l’apparition des réseaux de chemins de fer pour assister à une intensification des échanges extérieurs. Les premiers pendulaires font leur apparition au début du XXe siècle. À peine un siècle plus tard, 93% des Suisses se déplacent pour travailler. L’automobile a achevé de démocratiser la mobilité d’une population qui explose. Entre 1850 et 2021, le pays passe de 1,7 million à 8,7 millions d’habitants.
L’énergie en Suisse. De 1800 à nos jours, Cédric Humair et Nicolas Chachereau, EPFL Press, collection Savoir suisse, 2024.
Apéro-sciences « L’énergie en Suisse : comment éclairer l’avenir sans éteindre la nature ? »
Comment l’énergie a-t-elle façonné notre pays et comment continue-t-elle encore à le modeler ? Échangez autour de cette question lors d’un apéro-sciences gratuit organisé par L’éprouvette, le Laboratoire Sciences et Société de l’UNIL, le 28 mars 2025 à 18h au Musée de la Main UNIL-CHUV. À l’occasion de la sortie du livre L’énergie en Suisse : de 1800 à nos jours de Cédric Humair et Nicolas Chachereau, cette soirée abordera les défis majeurs liés à l’énergie dans notre pays, avec des spécialistes issu·es de différents horizons, en partageant une dégustation de vins et de boissons non alcoolisées.