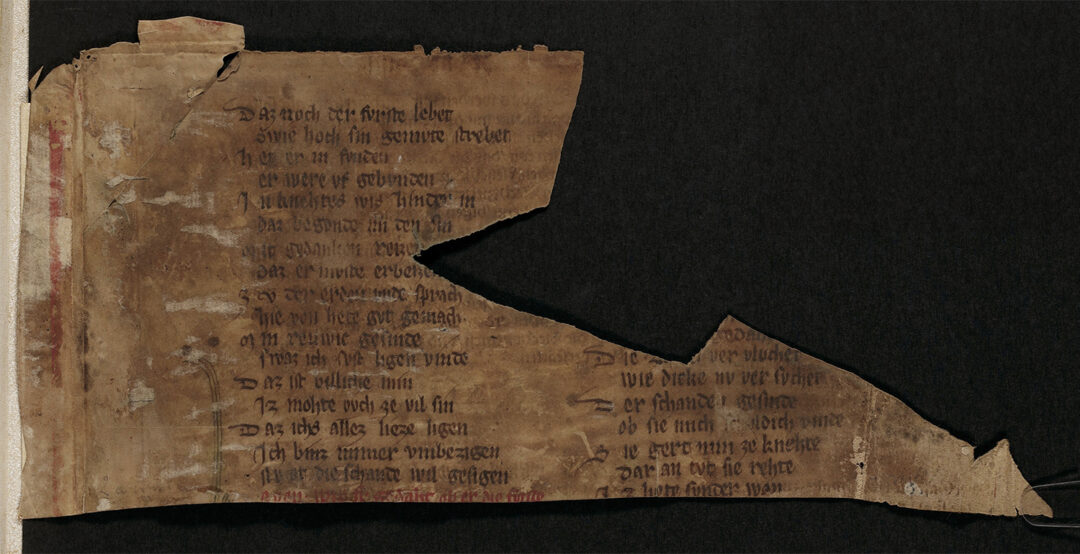Étudiant en lettres, Marco Crescenzio se prépare au plus gros concert de sa jeune carrière de musicien. Avec son groupe, Broken Bridge, et en compagnie de ses deux acolytes, il ouvre cette année la nouvelle édition du Paléo Festival.
La semaine, Marco Crescenzio, 22 ans, étudie l’histoire et l’histoire de l’art. En dernière année de bachelor, il participe aussi à la vie de sa section, membre de l’association Paragone. Le week-end, le public le connaît beaucoup moins sage, sous le nom et les traits de Don Saltamontes. Chanteur et guitariste au sein du trio garage rock nyonnais Broken Bridge, il enchaîne les concerts, aussi bien en Suisse qu’à l’étranger. S’il a déjà foulé des scènes renommées, comme le Blues Rules Festival de Crissier, le Sierre Blues Festival ou des salles telles que Les Docks, Marco et ses frères de rock partagent cette année l’affiche du Paléo Festival pour la journée d’ouverture avec des groupes de légende. Interview.
Vous serez cet été sur scène à Paléo. Comment vous sentez-vous ?
Les émotions évoluent. C’est un grand honneur d’avoir été contactés pour jouer à Paléo. Nous avons sauté de joie. Qu’il s’agisse de moi ou des deux membres du groupe, nous avons ressenti ce choc qui bloque les voies respiratoires. Nous ne nous attendions pas à ce que cela nous arrive. À ce stade, c’est un summum dans notre petite carrière musicale. Ça m’a de nouveau fait un gros effet lorsque la programmation complète est sortie. Quand on a vu notre nom écrit sur l’affiche. Nous le savions évidemment avant, mais voir notre nom écrit en dessous de celui de Kiss et de La Femme, un groupe que j’apprécie particulièrement, m’a fait couler quelques larmes. C’est aussi doublement un honneur pour nous, un groupe de Nyon, d’ouvrir Paléo, le plus grand festival open air de Suisse, basé à Nyon.
Au sujet des coulisses. Comment cela s’est-il passé ? Avez-vous été contactés ou avez-vous fait des démarches pour « postuler » ?
Nous avions été programmés au Caribana Festival en 2020, édition qui n’a malheureusement pas eu lieu. Cela nous a donné une grande visibilité et probablement ouvert des portes. Peut-être celles de Paléo. En sachant que nous avions déjà pu établir des contacts par le passé et que les programmateurs suivent depuis un certain temps l’évolution du groupe. Il faut savoir qu’à notre stade nous devons évidemment encore faire des demandes, des postulations. Montrer un intérêt pour jouer dans des salles de concert et pour nous produire sur scène. Ce qui est parfaitement normal, tout est encore relativement frais pour notre groupe. Sans compter qu’en quatre ans d’existence deux ont pratiquement été mises entre parenthèses avec la pandémie. Mais il arrive aussi que des clubs ou des festivals nous contactent, eux, et c’est ce qui est arrivé avec Paléo. Nous avons reçu un mail nous demandant si nous étions intéressés à nous produire à Paléo. Une question totalement rhétorique pour nous, il n’y avait pas de « non » possible (rires).
Vous partagez l’affiche avec Kiss, une légende du rock, mais aussi de très grands noms, comme les Dropkick Murphys ou -M-. Qu’est-ce que cela représente pour un jeune groupe ?
En tant que fan de rock, c’est énorme. J’ai écouté tous les grands groupes, les Beatles, les Stones, puis du hard rock avec des périodes tournées vers AC/DC. Là, il s’agit d’une légende du glam rock. C’est encore assez inimaginable de se dire que nous allons jouer avant Kiss. Les émotions sont encore en train d’évoluer. Nous avons commencé par éclater de joie, pleurer avec un énorme sourire. Se sont ensuite installés stress et adrénaline. Je pense que nous réaliserons pleinement ce qui nous arrive quand nous poserons notre pied sur scène.
En quelques mots, qui est Broken Bridge ?
Nous avons donné notre premier concert et présenté nos premières compositions à Genève en 2018. Nous sommes un groupe de garage rock, sur scène assez proches du punk de la première heure. On puise beaucoup dans la mouvance fin années 60 et tournant des années 70, avec des groupes comme MC5 ou Iggy Pop et les Stooges. Et de façon générale, dans ce qui se faisait au cours des sixties. Beaucoup de groupes sont passés par le garage. Les Stones surtout mais les Beatles aussi. Quand on regarde les vidéos de leurs premiers concerts à Hambourg, sapés avec des blousons de cuir, le son de voix distorsionné, beaucoup de grain, tout est un peu à la limite de la saturation avec beaucoup d’énergie. C’est une sorte de rock’n’roll à haute tension, pour reprendre un terme d’AC/DC. Nous nous sommes rencontrés avec Alex (Redd Knee, à la batterie et au chant, ndlr) au gymnase. Quand nous avons commencé à jouer ensemble, nous étions très influencés par les combos guitare/batterie comme les Black Keys et les White Stripes, plus blues rock. Le groupe a évolué avec le temps et nous avons trouvé notre identité propre quand nous avons compris ce qu’était le garage rock. Je nous définis comme une sorte de rock’n’roll punk.
Votre nom est une référence au Grand-Pont de Lausanne. Expliquez-nous.
Nous avons trouvé ce nom en 2017, avant de commencer à nous produire sur scène. Nous étions sur la terrasse d’un bar avec Alex en évoquant des noms qui pouvaient sembler cool. En tournant la tête et en voyant le Grand-Pont, nous trouvions que le mot bridge sonnait plutôt bien. En cherchant une allitération, nous avons trouvé broken. Nous avons établi une liste de noms et Broken Bridge était celui qui nous parlait le plus. Il nous parle évidemment aujourd’hui encore plus vu que le Grand-Pont est en travaux pour cause d’infiltration d’eau. On peut dire qu’il est relativement cassé (rires).
La musique, d’où vous vient-elle ?
C’est dans mon sang depuis toujours. Mon père est bassiste, musicien professionnel. Mais je n’ai jamais été forcé à jouer d’un instrument ou à faire de la musique. Je commence de mon plein gré à m’intéresser à la basse mais je suis avant tout guitariste. J’ai grandi dans ce milieu, entre différentes scènes. J’adore cet univers et je ressens le besoin de continuer à y vivre. Ma mère est aussi une grande amatrice de musique, elle a eu un magasin spécialisé en hard rock à Genève où venaient des gens de toute la Suisse et de France voisine pour trouver des disques spécialisés. Je m’inscris un peu dans la tradition familiale.
Et votre passion pour le garage rock ?
Je dois avouer que j’ai commencé à en écouter relativement tard. C’est Alex qui me l’a fait découvrir. Jusque-là, j’étais un grand fan de blues rock. Notre première discussion tournait autour de Stevie Ray Vaughan, de guitaristes blues. Quand il s’est aperçu que j’aimais beaucoup les sons de guitare distorsionnée, il m’a fait écouter des groupes que je ne connaissais pas. Le genre m’a passionné. Je suis aussi un grand fan de vinyles, je passe de nombreuses heures dans les magasins à fouiller dans les bacs, ce qui m’a permis de découvrir beaucoup de groupes de garage. J’ai une affection pour ces formations de la fin des années 60, sapées en costard et qui envoyaient de la musique sauvage. Nous aimons aussi jouer sur cette esthétique avec Broken Bridge, un peu dandy, en costume, avec de jolies chaussures et une musique sauvage.
Vous êtes étudiant en histoire et histoire de l’art. Pourquoi ce choix ?
Sur les sites archéologiques, j’ai toujours été attiré par les colonnes grecques. J’ai craqué pour toute cette histoire après un voyage en Grèce, pour la richesse des civilisations passées. J’ai toujours adoré l’histoire. J’ai voulu y consacrer mes études et, petit, je rêvais de devenir archéologue. C’est un choix de passion et de curiosité. Je suis très content d’étudier autant l’histoire que l’histoire de l’art. Les deux disciplines sont particulièrement complémentaires. Elles me permettent d’analyser des objets de façon très concrète. Qu’il s’agisse d’objets, de sculptures, d’œuvres, de tableaux ou plus simplement d’analyser une colonne qui m’a fasciné quand j’étais petit.
Le contraste est plutôt grand entre le « classicisme » de ces disciplines et le garage rock, un genre plutôt « sale », non ?
C’est un contraste qui me caractérise plutôt bien, dans ma vie en général et dans ma personnalité. J’aime ce côté « classique » à travers les vêtements par exemple. Porter un costard, un joli blaser et de jolies chaussures, mais proposer une musique sale. On a besoin d’une sorte de sauvagerie, mais on aime aussi le côté plus propre.
Dans la mesure où vos études et la musique vous prennent beaucoup de temps, comment conciliez-vous ces deux activités ?
L’activité musicale a été nettement moins présente ces deux dernières années avec la pandémie. La reprise a été un peu bizarre, mais je m’y réhabitue. Pour concilier les deux, sachant que nous sommes tous les trois étudiants à des endroits différents, la plupart des concerts sont programmés en fin de semaine. Le vendredi ou le samedi. Évidemment, si un événement majeur devait nous être proposé en semaine, nous acceptons aussi. Mais je suis aussi très content d’être sur le campus et de partager des moments avec d’autres étudiantes et étudiants, à boire des cafés et échanger autour des cours. Finalement, le week-end, je suis quelqu’un d’autre. Quand j’invite mes camarades à nos concerts, ils voient une autre personne. J’ai un tempérament plutôt posé, calme, alors que je suis très excité sur scène.
Vous êtes aussi investi dans la vie associative de l’UNIL. Est-ce important pour vous ?
Je suis membre de Paragone, l’association des étudiant·e·s en histoire de l’art, en tant que responsable des réseaux sociaux. Participer à la vie estudiantine est un besoin que j’ai d’autant plus ressenti pendant la pandémie. Ça m’a fait réaliser que la vie étudiante, l’aspect social, est cruciale. Au cours de ces deux années où elle était inexistante et où tout était aseptisé, les cours étant donnés à travers un écran, sans contact ni avec les enseignantes et enseignants ou les étudiantes et étudiants, j’ai eu besoin de m’investir. C’est là que j’ai voulu intégrer une association. Comme j’y connaissais des gens, j’ai rejoint Paragone. Participer à la vie associative nous permet d’organiser des sorties, des apéros. Et, plus important encore, de contribuer à faire se rencontrer les gens. Les études, ce sont aussi des échanges. Elles ne peuvent pas se résumer à un écran. Nous avons enfin pu organiser une première grande soirée où j’ai rencontré plein de nouvelles personnes. C’était drôle aussi parce que des gens que je ne connaissais pas venaient vers moi après avoir entendu que j’allais jouer à Paléo.
Dernière question. Deux grandes échéances vous attendent cet été : la session d’examens de juin et le Paléo Festival le 19 juillet. Laquelle vous stresse le plus ?
C’est un stress différent. Je commence en effet par la session d’examens en juin, ce qui me permettra de bien me défouler ensuite, sur scène, à Paléo. Paléo, c’est plutôt de l’adrénaline. C’est ce qui fait ne pas dormir la nuit et rêver. Je n’attends que ça. J’ai hâte d’être sur scène, de vivre le moment et de partager cet instant. Un examen, on se réjouit surtout qu’il soit passé. C’est plus stressant, même si je me sens à l’aise. J’essaie de faire en sorte que ce ne soit pas trop stressant, mais cela fait partie de cette phase. Parce que nous sommes toutes et tous en train de réviser à la Banane en même temps. Le stress en période d’examens se fait aussi ressentir de cette manière, de façon indirecte. Évidemment, Paléo est une grosse date que j’appréhende fortement.