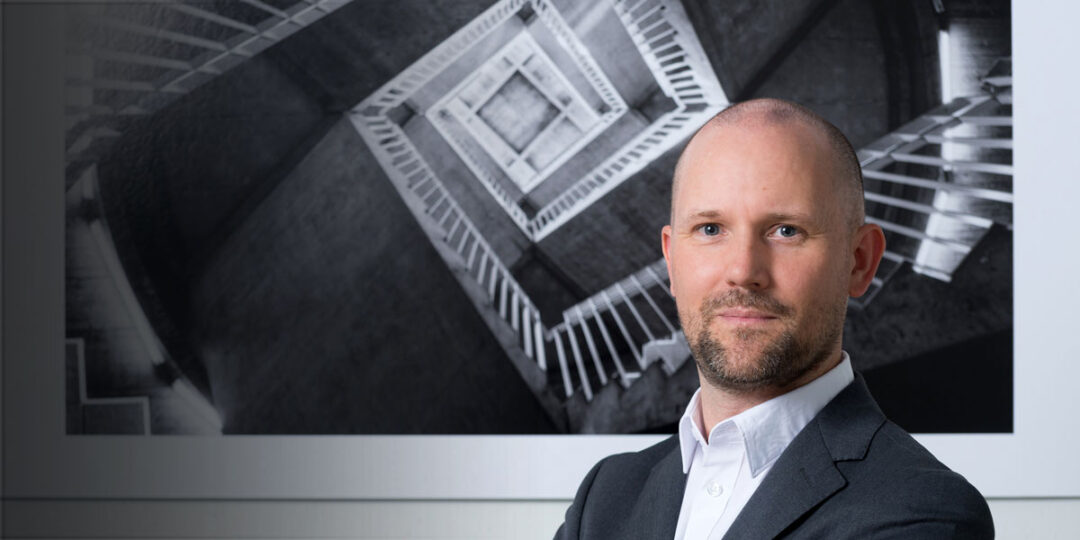Invitée par le Centre de traduction littéraire, Rosie Pinhas-Delpuech aime la France et Israël, le français et l’hébreu, parmi d’autres langues. Rencontre au château de Lavigny, où elle séjourne comme lauréate 2021 du Programme Gilbert Musy.
Menue mais pas fragile, Rosie Pinhas-Delpuech s’adonne à sa tâche quotidienne comme une artisane à son ouvrage. Traduire ne consiste pas à faire du tourisme, même si ça permet aussi de voyager. Il faut s’attribuer un nombre de pages par jour, tenir le délai prévu dans le contrat, et Boue, de l’auteur israélien Dror Burstein, n’est pas précisément un petit format dans son va-et-vient facétieux du prophète Jérémie entre hier et aujourd’hui à Jérusalem. Ce sera sa prochaine traduction, favorisée par un séjour de deux mois au château de Lavigny, dans le cadre du Programme Gilbert Musy que pilote le Centre de traduction littéraire de l’UNIL.
Traduire jusqu’au bout de la vie
« Même si je paie des contributions sociales comme tout le monde, je n’aurai pas de retraite car je ne suis pas salariée, je dois traduire jusqu’au bout de ma vie », glisse-t-elle avec une pointe d’amertume. Mais attention, si vous pensez que notre interlocutrice, née en 1946 à Istanbul, est abonnée à la plainte, vous faites fausse route. Elle assume ses choix et a pris la décision de quitter l’enseignement « avec la crise de la quarantaine », sourit-elle. La traduction est arrivée à elle comme « une bouée de secours pour ne pas oublier l’hébreu appris lors de deux installations en Israël, la première fois seule et la seconde en famille, et aussi pour être en prise directe avec la littérature ». Pour traduire il faut d’abord être un bon lecteur, non ? Elle répond « bravo » avec l’œil pétillant de la professeure qu’elle reste sans doute dans son cœur. À l’UNIL, elle donnera une masterclass à de jeunes traductrices et traducteurs en devenir et participera à deux rencontres ouvertes au public.
Qui était cet homme ?
Elle passe et repasse régulièrement de chaque côté du miroir, alternant traductions et œuvres plus personnelles comme Le Typographe de Whitechapel, une enquête littéraire et biographique sur les pas de l’écrivain Yossef H. Brenner (1881-1921), parue cet automne chez Actes Sud, maison d’édition dont elle dirige par ailleurs la série «Lettres hébraïques». Qui était cet homme ? « Il venait de Russie et croyait à l’utopie sioniste. Il y avait une commission composée de linguistes pour la constitution de l’hébreu moderne et lui a été l’un des illustres fondateurs de la littérature hébraïque moderne avec ses deux collègues H.N. Bialik et S.Y. Agnon, futur Prix Nobel », esquisse-t-elle.
Mais alors cette langue, l’hébreu ?
Brenner a connu la grande misère londonienne dans le quartier de Whitechapel, que Rosie Pinhas-Delpuech décrit dans son livre comme si elle y avait elle-même vécu à cette époque. Il rêve d’un lieu où les juifs, interdits de posséder de la terre et persécutés en Russie et en Europe – en dépit de la discrétion et de l’intégration remarquables dont ils font preuve – gagneraient le respect par le travail, agricole ou autre. « En Russie, les juifs, qui boivent peu, en général, étaient volontiers cabaretiers, ils servaient à boire aux moujiks qui allaient ensuite les pourchasser », affirme la traductrice, pour émailler son propos d’un exemple historique.
Mais alors cette langue, l’hébreu ? Alors que le yiddish était selon elle à son apogée en Europe… « Les pionniers d’Eretz Israël ne venaient pas tous d’Europe de l’Est, il y avait même des Yéménites, et il leur fallait une vraie langue commune, pas ce qu’ils considéraient comme un patois maison, même si en effet le yiddish avait permis de traduire les grandes œuvres classiques », répond-elle.
Staline n’a rien compris
Accrochez-vous, maintenant, car l’hébreu moderne issu de la Bible – qui en reprend les mots usuels tout en innovant à partir de bribes d’autres langues comme le russe, l’allemand ou l’anglais – a été façonné dans une perspective non religieuse. « Il s’agissait pour ces jeunes pionniers de se couper de la diaspora, avec une visée révolutionnaire qui déconnectait la Bible de la religion », précise-t-elle. Un paradoxe à nos yeux formés par le christianisme. Car la Bible hébraïque est d’abord le récit obscur et grandiose d’un peuple ancien, avec les violences de ce temps, les guerres, le sang, le sexe… Pas un catéchisme. « Tout Shakespeare est dans la Bible », résume notre interlocutrice, qui estime que ce texte fondateur, truffé de jeux de mots, reste « intraduisible » et ne peut être lu sans les éclairages du Talmud…
Au passage, elle évoque Staline, eh oui, qui « rejette l’hébreu comme langue décadente et religieuse » et n’a donc pas compris ou voulu comprendre ce que les écrivains et les linguistes juifs affirmaient. Plus le temps passe, précise-t-elle, plus l’hébreu se modernise, se métisse et s’éloigne de la langue biblique. Elle traduit des auteurs modernes et s’aperçoit très directement de cette évolution par rapport à la langue de Yossef H. Brenner, de moins en moins parlante pour un jeune Israélien. Vous voulez un titre contemporain ? Elle cite sa traduction d’un livre intitulé en français Le Roman égyptien (2016), écrit par la romancière Orly Castel-Bloom, née à Tel-Aviv en 1960.
Il faut parler d’amour
À écouter Rosie Pinhas-Delpuech, on se demande si on ne pourrait pas apprendre assez facilement l’hébreu, finalement. « Ce n’est en effet pas si difficile, l’hébreu ne comporte que trois temps, le passé, le présent et le futur, le français en compte 22, l’hébreu est une langue jeune qui ne possède que 8000 mots contre 80’000 pour le français », décrit-elle. On ne quitte pas la traductrice sans parler d’amour, celui qu’elle vouait enfant déjà à la France, amour naïf déçu lors de son arrivée en 1965 dans ce pays qui considère alors cette jeune francophone émérite comme une étrangère, et « amour fou » d’Israël et de sa langue.
La Turquie, qu’elle continue à aimer aussi, ne sera qu’effleurée dans notre entretien, tant de choses à dire encore au sujet d’Israël. Comme nombre d’intellectuels et d’artistes israéliens, elle estime que les Palestiniens doivent obtenir leur État. Elle observe avec inquiétude la montée de l’islamisme dans cette région et celle du nationalisme le plus étroit dans le monde en général. Mais Rosie Pinhas-Delpuech ne se voit pas comme une spécialiste de ces questions politiques et refuse par ailleurs de s’appesantir trop longuement sur les regains d’antisémitisme. « Je ne veux pas devenir parano », dit-elle.
Le sionisme n’est pas victimaire
On lui demande encore si Brenner – assassiné à 40 ans dans un pogrom arabe – était prêt à donner sa vie afin d’accoucher d’Israël pour que les juifs cessent, comme il le disait, d’errer telle « une prostituée de Buenos Aires ». Elle nous regarde avec surprise et répond doucement : « Non, le sionisme n’est pas une posture victimaire, il témoigne d’un projet utopique, d’un principe d’espérance, pour citer le philosophe Ernst Bloch. » Une espérance dont l’humanité plongée de crises en crises a bien besoin aujourd’hui…
Événements à venir
- Lecture-conférence «Traduire : un parcours byzantin», jeudi 30 septembre à 18h30, Cercle littéraire, Lausanne Entrée libre, inscription obligatoire au 021 312 85 02 ou admin@cerclelitteraire.ch
- SÉMINAIRE DE MASTER – Entretien avec Rosie Pinhas-Delpuech sur sa biographie traductive, mardi 12 octobre de 10h15 à 12h.
- COURS PUBLIC «Femmes en traduction». Rosie Pinhas-Delpuech et Camille Logoz : deux traductrices littéraires aujourd’hui – trajectoires et expériences, mercredi 20 octobre de 18h15 à 20h. UNIL, Anthropole, entrée libre. Horaires et descriptifs détaillés sur le site du CTL | www.unil.ch/ctl/pgm
Pour aller plus loin…
Le Typographe de Whitechapel. Comment Y. H. Brenner réinventa l’hébreu moderne. PAR ROSIE PINHAS-DELPUECH, Actes Sud, 2021