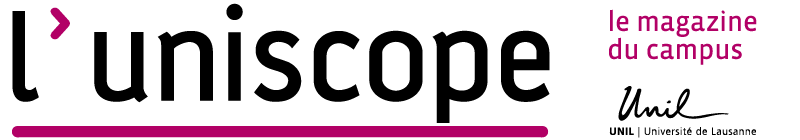À l’issue de son travail de thèse, Carlotta Manz, chercheuse en droit à l’UNIL, lance un appel aux institutions européennes sur l’utilisation des données génétiques par des parties privées. À travers sa recherche, elle a mis en évidence des lacunes dans la protection des droits humains selon un traité régulant la biomédecine.
Dresser une liste de recommandations à destination, entre autres, des plus grandes institutions du Conseil de l’Europe, peu d’entre nous pourront se vanter de l’avoir fait un jour. Mais Carlotta Manz, si ! Dans le cadre de son travail de thèse, qu’elle a soutenu fin mai, la chercheuse en droit international s’est penchée sur la délicate question de l’utilisation des données génétiques par des parties privées et a identifié, au fil de son analyse, différentes menaces à l’encontre des droits humains, liées à des flous juridiques. Sur la base de ses résultats, elle a ensuite établi plusieurs listes d’actions adaptées à chacun des acteurs concernés : les États, la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH), le Comité directeur pour les droits humains dans les domaines de la biomédecine et de la santé, le Conseil des ministres, les ONG ainsi que les entreprises privées.
« Il existe trois zones d’ombre, au sein desquelles la protection est inadéquate, selon les critères de ma méthodologie de recherche. »
Carlotta Manz, chercheuse en droit à l’UNIL
Au cœur de son travail : la Convention d’Oviedo. En s’appuyant sur la littérature scientifique, Carlotta Manz a d’abord identifié quatre menaces envers les droits humains liées à l’utilisation des données génétiques par des parties privées. Puis, « pour chacune de ces menaces j’ai évalué si la Convention d’Oviedo offrait une protection adéquate en matière de droits de l’homme », explique l’ex-doctorante. Alors qu’en est-il ? « Globalement la Convention est adéquate et protège les droits de l’homme, répond la chercheuse. Mais il existe néanmoins trois zones d’ombre, au sein desquelles la protection est inadéquate, selon les critères de ma méthodologie de recherche. »
La Convention d’Oviedo du Conseil de l’Europe
Premier instrument juridiquement contraignant au niveau international pour réguler les droits de l’homme et la biomédecine, la Convention d’Oviedo est un pilier central dans ce domaine depuis 1997. Contrairement à de simples recommandations, son caractère contraignant impose aux États qui l’ont ratifiée de l’appliquer. À ce jour, 37 états y ont adhéré. Le dernier signataire en date est l’Arménie, qui a signé la Convention en mai dernier.
Trois points de vulnérabilité
Tout d’abord, si, en termes de protection des données, les processus de transfert de données génétiques secondaires sont réglementés, au terme de son analyse la chercheuse estime toutefois que la protection est inadéquate, car elle est basée sur une idée de contrôle individuel. « En théorie, chacun de nous peut accepter ou refuser que ses données génétiques soient utilisées plus loin, à des fins secondaires, lorsqu’il ou elle participe à un test ou à une recherche. Mais dans la pratique il est difficile de comprendre réellement ce que cela implique, quelles seront les utilisations faites avec ces données et comment refuser de donner son accord. »
Transfert de données génétiques secondaire
« Lorsqu’une personne achète un test génétique en ligne, elle ne réalise pas toujours qu’elle paie aussi avec ses données », détaille Carlotta Manz. Souvent les résultats sont transmis à des compagnies pharmaceutiques ou à des fonds de recherche. De plus, « la stratégie commerciale de ces entreprises repose principalement sur la collecte de données génétiques des clients à d’autres fins, à savoir le transfert secondaire d’informations à des fins lucratives à des instituts de recherche et à d’autres entreprises privées, peut-on lire dans sa thèse. Les clients sont encouragés à permettre à l’entreprise d’utiliser leurs données à des fins de recherche pour « faire partie de quelque chose de plus grand qu’eux-mêmes. » »
La deuxième zone d’ombre identifiée par Carlotta Manz concerne les recherches familiales dans les bases de données commerciales externes, ainsi que le phénotypage de l’ADN dans le cadre d’enquêtes criminelles. « Dans certains pays, lorsque la police est confrontée à un cas non résolu, par manque de moyens, il est possible d’avoir recours aux bases de données de compagnies privées pour comparer l’ADN trouvé sur une scène de crime, détaille la jeune femme. Cela afin de chercher d’abord une correspondance ou un lien de parenté avec les personnes qui se sont un jour soumises à un test génétique, mais aussi pour essayer de déterminer l’apparence physique sur la base de données génétiques. » Cette pratique pose évidemment plusieurs questions juridiques. Au niveau du Conseil de l’Europe, il s’agit là encore d’une situation floue. Les États possèdent une grande marge de manœuvre. « Dans certains pays il y a des limites, alors que d’autres n’ont aucune réglementation », précise la chercheuse.
Le dernier point vulnérable mis en évidence par Carlotta Manz concerne finalement la confidentialité. « Si je reçois le résultat d’un test génétique et qu’il pourrait être important pour mes parents, est-ce que j’ai l’obligation de leur dire que cela pourrait aussi les concerner ? Et si je décide de ne rien leur dire, est-ce que la partie privée à l’origine du test pourrait passer outre ma volonté et prévenir elle-même mes parents ? Dans ce cas-là, la Convention d’Oviedo n’aborde pas le comportement de ceux qui effectuent le test génétique. »
Protection mise à jour
Si elle s’attendait à trouver des points vulnérables, la chercheuse a cependant été surprise de découvrir que non seulement « les cas de protection inadéquate identifiés sont des cas où l’on sait très bien et depuis longtemps qu’il s’agit de zones floues, mais où l’on ne fait rien pour y remédier ». Mais aussi que, « si les États appliquaient et réglementaient ce que le droit international préconise de façon plus forte, il y aurait une protection adéquate. Le problème, reste que parfois les signataires ne respectent pas leurs obligations internationales », explique Carlotta Manz. C’est donc ce constat qui l’a poussée à établir des propositions d’actions concrètes.
Bien qu’il s’agisse d’une initiative relativement courante en droit international, publier ce type de recommandations revêt une importance particulière dans un contexte où les avancées technologiques, notamment en matière de données génétiques, soulèvent des questions éthiques et juridiques toujours plus complexes. En identifiant les zones d’ombre de la Convention d’Oviedo et en proposant des actions précises, Carlotta Manz contribue ainsi non seulement à combler ces lacunes, mais aussi à renforcer la protection des droits humains face aux défis contemporains.