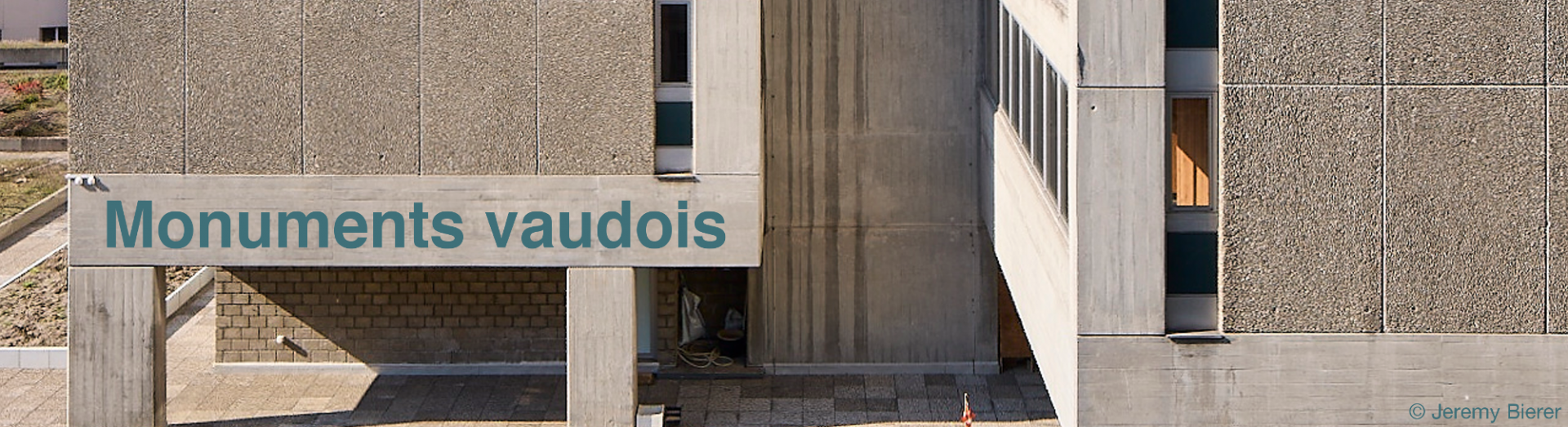Petite construction religieuse élevée dans un milieu agreste vers le milieu du XVe siècle puis modifiée vraisemblablement au cours des années 1520, caractéristique par son portail, son clocher-arcade ou encore ses chapelles-baldaquins, l’église de Treytorrens retient, à la fin du XIXe siècle déjà, l’attention d’Albert Naef (1862-1936), archéologue et architecte chargé depuis 1894 de dresser un premier inventaire d’édifices dignes d’intérêt pour le compte de l’Etat. Devenu au tournant du XXe siècle une figure incontournable des restaurations menées dans le canton (architecte du château de Chillon dès 1897 et archéologue cantonal dès 1899), Naef argumentera le bien-fonde? d’une restauration de l’église pour peu après en assumer la direction, du début des travaux préparatoires en 1898 à la fin du chantier en 1907.
MVD 7-2017
Dave LÜTHI, « Pourquoi étudier les restaurations? Pour une histoire de la pratique de la conservation du patrimoine dans le canton de Vaud »
Depuis quelques années, la pratique de la restauration des monuments historiques, plus que centenaire en Suisse, a suscité un intérêt non négligeable auprès de chercheuses et de chercheurs qui ne traitent plus cette question comme une annexe de l’étude monumentale, mais bien comme un sujet en soi. En effet, cette archéologie du passé récent du patrimoine bâti produit souvent des résultats étonnants, et renouvelle complètement le regard porté sur de vénérables monuments dont on se rend compte qu’ils sont moins « authentiques » qu’on l’imaginait… Cette lecture a deux conséquences essentielles: elle permet de pointer les éléments les plus anciens, souvent intéressants parce que rares, et d’assurer leur documentation et leur préservation; mais elle permet surtout de prendre conscience du caractère organique de la conservation, de la rénovation et de la restauration des monuments.
Guillaume CURCHOD, « L’architecte Frédéric Gilliard et le temple de Bière. Enjeux d’une restauration des années 1940 »
Diplômé de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich en 1909 et associé à l’architecte vaudois Frédéric Godet dès 1913, Frédéric Gilliard est avant tout connu pour son engagement en faveur de la construction de logements sociaux à Lausanne. La restauration d’églises constitue une autre facette de son activité qui va de pair avec une forte implication dans la sphère patrimoniale. Frédéric Gilliard siège en effet dans de nombreuses commissions de restauration (Monuments historiques, Cathédrale, Château de Chillon, etc.) et œuvre notamment à la conservation du patrimoine bâti de la Cité à Lausanne, et à la restauration de quelques châteaux et de dizaines d’églises. Au sein de cet important corpus, le chantier du temple de Bière constitue un cas remarquable de restauration des années 1940. Dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, près de dix ans après la rédaction de la Charte d’Athènes, l’intervention de Frédéric Gilliard témoigne des enjeux posés par une restauration au cours de cette période peu étudiée: les choix stylistiques, les intentions et valeurs guidant la restauration et finalement la compréhension même du concept de restauration par l’architecte.
Anne-Gaëlle NEIPP, « Claude Jaccottet et la restauration de la maison de l’Élysée à Lausanne (1974-1980) »
Importante figure de la restauration en Suisse romande de la seconde moitié du XXe siècle, l’architecte Claude Jaccottet (1915-2000) a dirigé un grand nombre de chantiers, principalement sur des églises et des châteaux, la maison de maître de l’Elysée, en tant que maison de campagne, faisant figure d’exception. Si durant son premier chantier de restauration à l’abbaye de Saint-Maurice (1942-1950), il prend beaucoup de libertés par rapport à la substance historique conservée, son attitude change lors de ses chantiers postérieurs à la Charte de Venise (1964). Il tente alors de prendre en considération cette dernière et d’en appliquer les principes du mieux possible. Ainsi, il privilégie le respect du monument et de son histoire plutôt que la restitution d’un état ancien mal documenté. De même, il favorise la collaboration pluridisciplinaire, comme le préconisent les Chartes d’Athènes puis de Venise, en ayant recours à des spécialistes pour chaque type d’intervention. L’étude du chantier de la maison de maître de l’Elysée (1974-1980) montre l’approche de Jaccottet face à la restauration, à l’histoire et à l’art de l’édifice.
Bernard ZUMTHOR, « De minimis curat conservator etiam ». Au sujet de la restauration du temple de Crans-près-Céligny »
Le patrimoine culturel est à l’histoire ce que l’écriture est au texte: un assortiment d’objets matériels et immatériels légués en vrac à notre génération par celles qui nous ont précédés et que chaque époque s’efforce d’ordonnancer en un nouveau récit qui leur donnera signification et dans lequel les héritiers seront censés se reconnaître. Or, compte tenu du fait que notre regard sur les témoins de l’histoire évolue au cours du temps, chaque proposition de mise sous protection, a fortiori lorsqu’elle s’accompagne de conservation et de restauration, nous invite à interroger les procédures intellectuelles et les paradigmes sur la base desquels se crée la valeur historique ou symbolique, c’est-à-dire de comprendre de quelle manière et pourquoi, à un moment donné, un objet, resté jusqu’alors dans l’anonymat public, acquiert la distinction mémorielle.
La restauration du petit temple de Crans-près-Céligny offre, en dépit – ou peut-être en raison – de sa modestie, une illustration intéressante du processus d’objectivation du fait patrimonial dans la pratique contemporaine de la sauvegarde.
Camille NOVERRAZ, « Marcel Poncet (1894-1953) et le vitrail religieux moderne
S’inscrivant dans la lignée du travail de Clement Heaton (1861-1940), Marcel Poncet a mené de front sa carrière de peintre et de peintre-verrier, puis de mosaïste dès les années 1930. Sa production comprend environ soixante-sept vitraux, situés dans les cantons de Vaud, Genève, en Valais et en Suisse allemande, ainsi que quelques-uns en France, pratiquement tous religieux. Le fonds de l’artiste relatif au vitrail, comprenant près de 1130 œuvres graphiques, esquisses, maquettes et cartons, a été déposé en 1996 au Vitrocentre Romont où il a fait l’objet d’un inventaire réalisé dans sa majeure partie entre 2013 et 2014, sur lequel a pris appui un mémoire de maîtrise achevé en 2016. Ce travail a permis de mettre en lumière une part jusqu’alors peu étudiée de la carrière de Marcel Poncet, avant tout présenté comme un peintre par les critiques, reléguant le vitrail et la mosaïque au rang d’activités secondaires et mineures de l’artiste.
Bruno CORTHÉSY & Bruno SANTOS, « Le Corbusier à Lausanne. L’architecte Jacques Dumas, le cas d’un émule corbuséen. Le Centre universitaire catholique, la chapelle du Servan et l’école du Riolet à Lausanne »
Hormis ses œuvres de jeunesse, conçues dans sa ville natale, La Chaux-de-Fonds, et, en partie, désavouées, Le Corbusier n’a pas réussi à s’implanter dans son pays d’origine par la captation de commandes de grande envergure. Entre la fin de la Première Guerre mondiale et sa mort en 1965, il ne laissera que trois bâtiments, d’ampleur variable, sur le sol helvétique, la villa Le Lac (Corseaux, 1923), l’immeuble Clarté (Genève 1933) et le Musée Heidi Weber (Zurich, 1964-1967). Le refus de son projet pour le Palais de la Société des Nations à Genève en 1927 marquant, ce titre, l’occasion ratée de s’imposer aux niveaux suisse et international. En revanche, après la Seconde Guerre mondiale, le chaux-de-fonnier n’a pas manqué d’émules et sa démarche détermine une grande partie la production en Suisse romande. Parmi les architectes tributaires de la leçon du maître, Jacques Dumas (1930-2015) constitue un exemple particulièrement remarquable par la reprise et la réinterprétation qu’il propose dans le canton de Vaud de la figure emblématique du Style international.
Claire PIGUET, « Charles-Henri Matthey (1880-1956). Un nom « qui restera attaché à la restauration de nos principaux monuments historiques »
« Les regrettables circonstances qui motivèrent, en 1934, la suspension, par le Conseil d’Etat, de l’intendant des bâtiments Charles-Henri Matthey, ne sont pas une raison d’oublier à tout jamais les services que ce citoyen a rendus au pays par son activité professionnelle et par d’heureuses initiatives et réalisations ».
A toute bonne histoire, son héros, ses ressorts dramatiques et son mystère! Pour quelles raisons, Charles-Henri Matthey (1880-1956) ne se voit-il accorder qu’un hommage en demi-teinte en lieu et place de l’éloge flatteur rendu habituellement aux notables? Suspension ou services rendus? Regrettables circonstances ou heureuses initiatives? Les termes a? connotations contradictoires se côtoient dans les rares nécrologies qui lui sont consacrées; ces mots sèment le doute sur le bilan de la carrière de l’intendant des bâtiments ayant œuvré à ce titre de 1902 à 1934 au service de l’Etat de Neuchâtel. Tentons de cerner le personnage à travers sa conception de la restauration et de la conservation du patrimoine.
Nicole MEYSTRE-SCHAEREN & Carole SCHAUB, « La redécouverte des décors en faïence de l’ancienne boulangerie Kauert au White Horse pub de Montreux »
C’est l’histoire d’un bâtiment qui, comme tant d’autres, a connu plusieurs vocations et marqué autant de générations. Situé au no 28 de la Grand-Rue à Montreux, l’édifice a d’abord abrité la boulangerie Kauert (de 1904 a? 1970), puis le White Horse Pub (de 1972 à 2014), et s’apprête à vivre une troisième destinée en tant que restaurant. Malgré les lourdes transformations entraînées par ces changements d’affectation, le lieu n’a pas perdu toute sa substance historique, puisque le magnifique décor en faïence réalisé au début du XXe sie?cle pour orner les murs de la boulangerie Kauert a survécu jusqu’à nous et a pu être préservé ?
Retrouvées par hasard en 2014 derrière des boiseries, ces faïences peintes présentent un double intérêt: d’une part comme nouvel apport à l’historiographie montreusienne, et, d’autre part, en tant que cas particulier de sauvetage d’un objet patrimonial. Carole Schaub, historienne de l’art et ancienne collaboratrice des Archives de Montreux, prèsente ainsi le résultat de ses recherches historiques sur ce décor; Nicole Meystre-Schaeren, responsable des Archives de Montreux, évoque ensuite les démarches entreprises par la Commune de Montreux entre 2014 et 2016 – de la redécouverte des faïences à leur dépose – pour sauvegarder ce pan de l’histoire montreusienne.
Martine JAQUET, « Quelques jalons à propos de la plateforme de Sévelin »
En 2016, la plateforme de Sévelin, à Lausanne, s’apprête à vivre une mutation importante avec l’élaboration d’un nouveau plan d’affectation, qui permettra en particulier la créations de logements dans ce périmètre, dédié jusqu’à ce jour par définition à des activités artisanales ou industrielles. Alors que l’histoire de la plateforme du Flon qui débute en 1874 est bien connue grâce à plusieurs ouvrages publiés dès le milieu des années 19802, celle de la plateforme de Sévelin, que nous délimitons entre le pont Chauderon, à l’est, et l’avenue de Sévelin à l’ouest, n’a pas encore été établie. La présente contribution permet de poser quelques jalons, en particulier concernant les décisions communales, les enjeux économiques et spatiaux ainsi que les acteurs qui ont contribué à façonner sa physionomie actuelle.