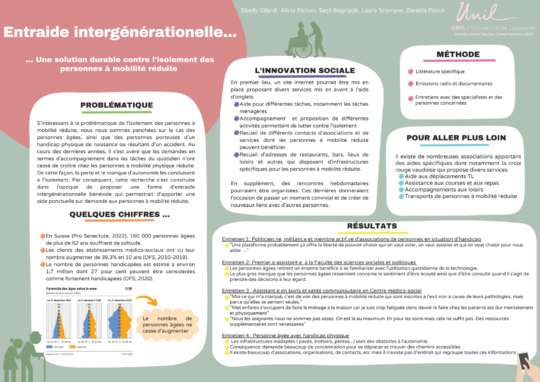Par Camille Bardet
1. Présentation de l’enquêté
Il y a trois mois, j’ai réalisé un entretien avec Mathieu, 28 ans, habitant dans le quartier sous-gare à Lausanne. Nous nous sommes rencontrés via zoom, il était sur son canapé, un poster d’art moderne accroché derrière lui. Mathieu est le compagnon de la sœur de ma meilleure amie, et je l’ai contacté dans le cadre d’une enquête de terrain exploratoire sur la gentrification.
Mathieu a une coupe au bol avec une raie au milieu, une moustache et un style « branché » mais « décontracté » : il y a une recherche de style dans le choix des vêtements mais sans pour autant faire trop habillé. Il est de nationalité suisse et d’origine allemande et autrichienne, il est également diplômé d’un master en psychologie sociale à l’université de Lausanne et travaille actuellement en tant que chercheur en sciences sociales pour une université. Il avait monté une entreprise avec des amis après ses études, mais il manquait de stabilité sur plusieurs points et ne se sentait pas à l’aise dans le poste qui lui était attribué, vu son manque d’expérience dans le milieu professionnel. Mathieu vit dans le quartier sous-gare de Lausanne avec sa compagne depuis quelques mois, il a toujours habité en Suisse. Son père est directeur d’une assurance juridique et avocat et sa mère s’occupait des enfants quand il était petit mais est maintenant employée de commerce pour un arboretum. Cette enfance privilégiée lui a donné l’occasion de beaucoup voyager.
2. Démarche méthodologique
J’ai rencontré Mathieu dans le cadre du séminaire de sociologie générale. Mon enquête s’est basée sur le texte de Sylvie Tissot : « ”Anything but Soul Food”. Goûts et dégoûts alimentaires chez les habitants d’un quartier gentrifié »1. Le terme « gentrification » désigne, sur un territoire donné, le processus de mise à l’écart voire de remplacement d’une population faiblement dotée en capital économique et culturel au profit d’une autre plus privilégiée. J’ai tout de suite pensé à Mathieu pour cette enquête, en effet lorsque les textes ont été présentés en début d’année je me suis dit que j’avais l’enquêté parfait pour ce sujet, je l’imaginais déjà avec son gilet en laine, son pantalon de seconde main et ses mocassins, prêt à me répondre avec son grand sourire. Dans les modes de vie de sa copine je reconnaissais les caractéristiques de la gentrification, que ce soit lié à la nourriture ou à tous les registres du style de vie. Mathieu est un diplômé aux goûts exotiques et branchés et ayant l’air de pouvoir se le permettre. En outre, il a récemment déménagé dans le quartier sous-gare, reconnu à Lausanne comme le quartier « branché » après avoir été un quartier populaire, ce qui complète le profil type du gentrifieur. Le contact avec Mathieu a été facilité par ma condition sociale se rapprochant de la sienne. Étant un jeune intellectuel qui vient de s’installer dans le quartier, le prix du logement est encore suffisamment accessible mais ce sont des personnes plus âgées et avec de plus grands moyens financiers qui risquent de le remplacer par la suite avec les loyers qui vont certainement augmenter avec le temps. Ceci explique ses goûts qui se rapprochent d’un environnement privilégié, mais qui incluent aussi des pratiques éloignées du modèle « bourgeois », comme participer à des manifestations politiques ou aller dans des brocantes par exemple, ce qui lui permet d’avoir un certain confort mais de continuer à paraître « cool ».
Dans son étude, Sylvie Tissot parle du quartier gentrifié de South End à Boston où la population nouvellement installée rejette la Soul Food, nourriture typique de la culture afro-américaine mais très peu diététique. Les habitus « branchés » de cette nouvelle population favorisée penchent vers l’« exotisme culinaire » comme l’a expliqué Pierre Bourdieu dans La distinction2. Les choix quant à l’alimentation sont au centre de mon enquête mais celle-ci dépeint en réalité plusieurs éléments propres au « style de vie » dans ce quartier. Les commerces et les activités préférées par cette population forment un ensemble de pratiques sociales typiques des habitants de quartiers gentrifiés. J’ai tenté de comparer ces habitudes à celles de mon enquêté et de son entourage, certaines choses allaient certainement coïncider ou non et j’ai donc trouvé cela pertinent. J’ai interrogé Mathieu sur son quartier, ses habitudes alimentaires et celles de ses amis, ainsi que sur ses expérience passées et futures afin de cerner son style de vie. Au cours de la conversation, il a beaucoup mentionné les voyages, auxquels il donne une grande importance mais à propos desquels il est réticent maintenant, en grande partie dû à sa conscience écologique. Je me suis rendue compte que ces voyages sont partie intégrante de la manière dont il se conçoit : comme un jeune homme progressiste et ouvert sur le monde sans le détruire.

Les choix quant à l’alimentation sont au centre de mon enquête mais celle-ci dépeint en réalité plusieurs éléments propres au « style de vie » dans ce quartier.
3. Éléments du contexte de vie
3.1 Le quartier
Mathieu a grandi à Aubonne dans une famille de classe moyenne supérieure. Dès ses 23 ans et ce pendant 4 ans, il a habité dans une colocation située à l’avenue d’Echallens à Lausanne, étant encore en train d’étudier, c’est ses parents qui payaient le loyer. Il décrit ce quartier de Lausanne où il habitait auparavant comme « bobo pop » : à la fois alternatif et branché mais avec un niveau de vie « populaire », dit-il.
Il vit maintenant depuis 6 mois dans un appartement sous-gare avec sa compagne. Il explique qu’ils ont pu avoir accès facilement à ce logement car ils connaissaient les anciens locataires qui les ont prévenus quand ils quittaient l’appartement. Nous pouvons donc en déduire qu’ils fréquentaient des gens de ce niveau de vie avant même d’y habiter, donc leur style de vie grâce à leur position sociale ressemblait déjà à ceux de ce quartier. Mathieu décrit l’appartement comme très « fonctionnel » avec un balcon, une cuisine et une machine à laver. Selon lui, même si ce n’est pas l’endroit le plus riche du quartier, la différence est nette par rapport à son ancien logement qui n’avait pas le même confort. L’enquêté m’a décrit l’ambiance comme très calme, ce qui est agréable quand on est chez soi, mais parfois presque trop calme et manque à ses yeux de charme, notamment d’un côté « communautaire ». Le quartier leur semble trop impersonnel, donc ils ne sortent plus autant. À l’avenue d’Echallens, il avait l’habitude quand il sortait de chez lui, d’aller dans la rue et d’y voir du monde et de l’ambiance. Ceci est également dû au coût de la vie qui est plus élevé sous-gare car la clientèle a des moyens financiers supérieurs. Pas de fast food ici, mais par exemple un restaurant indien où mangent principalement des familles : « Y’a un resto indien qui est très bon mais tu payes vite 30 balles ton plat, à l’avenue d’Echallens y’avait le petit spot à ramen, un spot avec des pizzas pas cher et tout ». Cependant, il est pertinent de remarquer que Mathieu avait déjà été socialisé à aimer des plats comme les ramen, nourriture qui provient de l’étranger et coûte quand même plus de 10 francs, une somme dont pas tout le monde peut se permettre.
Sa vision du quartier par rapport à l’ancien, en plus de son enfance, nous montrent bien sa position sociale favorisée qui a formé ses goûts et sa culture, intégrés dans son style de vie.
3.2 La cuisine
J’ai beaucoup discuté avec Mathieu de ses habitudes alimentaires.
Son restaurant préféré pour aller manger avec des amis est un libanais, ou un autre qui fait des bowls orientaux. Pour lui c’est le juste milieu entre quelque chose de bon et de sain, « histoire de se faire plaisir en toute bonne conscience ». Il admet avoir adoré les fast food durant son enfance mais ses préférences ont changé. On peut donc en déduire que ses goût actuels alimentent le cercle vertueux des habitants des quartiers gentrifiés. En effet, sa demande au niveau culinaire pousse l’offre à se développer dans ce sens pour satisfaire les consommateurs.
À la maison, il m’a expliqué qu’il adorait cuisiner mais pour lui ça n’était pas vraiment une corvée, au contraire, il voit cela comme un bon moment qui le coupe de sa journée de travail : « C’est la cuisine qui me fait sentir que y’a rien qui m’oppresse, c’est assez thérapeutique au final ». Mathieu et sa compagne essaient de faire à manger plutôt que de commander mais il explique que cela dépend du temps qu’ils peuvent prendre. On comprend qu’il a le confort de pouvoir commander quand il le souhaite, manger au restaurant ou encore compter sur sa compagne, ce qui n’est pas le cas d’un grand nombre de femmes pour qui l’accomplissement de ces tâches domestiques est une obligation quotidienne. Pour ce qui est des repas, puisque, comme il me l’a dit lors de l’entretien : « on se lâche sur de la malbouffe parfois en soirées, par exemple je vais me prendre un bon burger », à la maison ils mangent sainement pour maintenir une certaine stabilité. Ils ne mangent pas de gluten car sinon ils risquent de se sentir ballonné, les plats sont à base de quinoa, boulgour ou riz avec des légumes ou des protéines végétales car ils ne mangent pas de viande, par conscience écologique. Finalement, l’équilibre dans leur assiette leur permet ainsi de le maintenir dans leur vie. Ce style de vie est bien typique des habitants des quartiers gentrifiés comme Sylvie Tissot l’explique dans son texte. En effet, l’auteure montre que les habitants des quartiers gentrifiés cherchent à se démarquer des classes populaires notamment grâce à leur alimentation. Ils privilégient des aliments plus fins contre des plats gras jugés malsains et vulgaires, ils choisissent ce qu’ils adoptent mais aussi ce qu’ils repoussent. Ces jugements de goût vont donc passablement changer le paysage commercial du quartier en le renouvelant afin de correspondre à des normes culinaires bien précises, allant du type de nourriture, au choix des matériaux et du décor selon les établissements. La ville, ou du moins le quartier apparaît alors comme un endroit « ouvert sur le monde » à même d’accueillir des populations diversifiées dans leurs origines, mais surtout des populations ayant des moyens financiers non négligeables. Ce processus se déroule au détriment des commerces et plus largement des habitants antérieurement présents dans ces quartiers, pour qui le coût de la vie devient trop élevé. L’exemple de Tissot se base sur la « soul food » qui est une nourriture grasse de tradition afro-américaine et qui est rejetée par les gentrifieurs car opposée aux modes « healthy ». J’ai retrouvé chez mon enquêté les mêmes éléments qui expliquent donc les logiques des pratiques d’ouverture et de fermeture à certains goûts et produits dans les quartiers gentrifiés, comme le dit Tissot : « les cultures légitimes se transforment, en puisant parfois dans les pratiques illégitimes. (…) donnent finalement à voir ce que la « diversité » fait à la distinction sociale. ».
Mathieu et sa compagne cuisinent parfois tous les deux, pour « partager ce moment », m’a-t-il expliqué. Il m’a également dit que beaucoup de ses recettes étaient inspirées du réseau social Instagram. On peut supposer que c’est une façon pour lui d’avoir une bonne image de sa propre vie en s’inspirant de celles des influenceurs auxquels il s’identifie. Ainsi, la conception que nous avons de l’alimentation va bien plus loin que le simple fait de se nourrir, elle est largement symbolique et contribue à construire notre identité sociale. Pour Mathieu, c’est un des éléments fondateurs de son style de vie sain, écologique et « ouvert sur le monde ».
Il est clair que la plupart des personnes qu’il côtoie ont une alimentation, de même qu’une position socio-économique, similaire à la sienne. Lorsque je lui ai demandé comment ses goûts avaient évolué à travers le temps, il m’a dit que quand il était enfant il détestait beaucoup d’aliments, son adolescence quant à elle était centrée sur la viande et le pain, mais maintenant il est attiré par des choses différentes : « Maintenant j’ai pris beaucoup de plaisir dans des trucs qu’avant je trouvais pas ouf, là un bon Dahl ça me fait trop plaisir de le préparer », « ça m’aurait semblé chiant mais maintenant je trouve ça cool ». Il dit qu’il a parfois l’impression d’être un « daron » (un père de famille, un « vieux ») mais que c’est assez « cool » au final.
De plus, Mathieu m’a dit appartenir à un groupe de course à pied avec lequel il sort tous les dimanches, ce qui me semble participer dans la recherche d’un mode de vie sain et certainement d’une apparence « fit ».
Ces éléments nous indiquent que la position sociale des habitants de quartiers gentrifiés leur permet d’avoir des pratiques aimantaires saines, avec de bons produits, étant souvent exotiques. Plus largement, les fréquentations et la socialisation, forment les goûts en matière de cuisine, de sport ou encore de façon de parler ou de s’habiller. De manière générale, l’entretien que j’ai eu avec Mathieu a beaucoup recoupé le texte de Sylvie Tissot : les habitants des quartiers gentrifiés cherchent à manger des choses perçues comme « saines » et « simples » et sont attirés par une alimentation plus exotique que traditionnelle. Le goût affirmé par Mathieu pour ces produits mais aussi pour la pratique de la cuisine comme activité de choix, reposante et agréable, le distingue des classes populaires dans lesquelles la cuisine est plus souvent perçue comme une corvée quotidienne.
3.3 Les voyages
Mathieu et moi avons aussi parlé de ses voyages afin d’approfondir la question des styles de vie au sens large, et ses réponses ont été passionnantes. Il dit apprécier voyager, mais explique qu’il l’a surtout fait par le passé. Il avait plus de vacances, moins de responsabilités vis-à-vis de son employeur, il partait avec ses parents, ou ensuite grâce à l’argent qu’il gagnait avec des petits jobs étudiants. Il a également fait un voyage « Erasmus » aux États-Unis et en a profité pour voyager au Mexique. Ces éléments permettent de situer la classe favorisée à laquelle Mathieu appartenait depuis le début de sa vie. Cependant, il a réduit la cadence depuis environ trois ans. En effet, sa volonté d’investir financièrement, les responsabilités nouvelles qu’il a acquises ou encore les nombre de semaines de vacances qui ne sont plus les mêmes. De plus, sa conscience écologique l’a assez vite rattrapé « J’ai tellement pris l’avion que quand je suis rentré de mon Erasmus, j’ai eu une prise de conscience, ça me paraissait démesuré et je me suis dit que j’avais un peu abusé ». Depuis trois ans donc, il voyage uniquement en Europe et en train, ce qu’il estime être une bonne alternative écologique. Mathieu dit que s’il reprenait l’avion ce serait pour un long voyage et il faudrait que cela en vaille la peine, cependant trouver la possibilité de le faire n’est plus aussi simple. Il semble que dans le discours de Mathieu, lorsqu’il parle de la cuisine autant que des voyages, sa conscience écologique est souvent en contradiction avec (et parfois subordonnée à) son plaisir.

Il semble que dans le discours de Mathieu, lorsqu’il parle de la cuisine autant que des voyages, sa conscience écologique est souvent en contradiction avec (et parfois subordonnée à) son plaisir
A propos de son « Erasmus », Mathieu dit avoir apprécié ce voyage car il s’y est senti intégré comme un local et non comme un simple touriste. Le discours qu’il tient semble bien découler de sa volonté de se distinguer des classes populaires, qui incarnent les « touristes » (« de masse ») donc les « mauvaises pratiques » de mobilité et de loisir. Au contraire, Mathieu développe ce qu’il conçoit comme de « bonnes pratiques ». On peut retenir de cette enquête que la cuisine n’est qu’un élément parmi l’ensemble des goûts et des pratiques distinctives des fractions intellectuelles des classes moyennes supérieures, notamment en situation de gentrification. Mathieu m’a fait part de son côté sportif comme de sa conscience écologique en passant par les manifestations auxquelles il participe régulièrement. Ce sont ces préférences et bien d’autres qui le permet de se distinguer par ses goûts mais aussi ses dégoûts.
4. Conclusions générales
Revenons pour terminer sur le terme de bobo que Mathieu a utilisé plus d’une fois durant l’interview. Le terme bobo signifie initialement « bourgeois-bohème », mais cette notion aux contours flous est plus intéressante à appréhender sous l’angle des usages sociaux qui en sont faits. En utilisant le terme « bobo pop », Mathieu inclue dans une même appellation les termes « bourgeois » et « populaire », qui apparaissent a priori opposés. On peut faire l’hypothèse qu’il entend ainsi justifier son style de vie plutôt bourgeois par le fait qu’il aime certaines choses plus banales. Les membres des classes moyennes-supérieures, en particulier dans les fractions intellectuelles, sont souvent attirés par le mode de vie des bourgeois-bohème « branchés » qu’ils envient. Finalement, on ne peut pas vraiment dire qui « l’est » ou « ne l’est pas », et ce n’est pas une question pertinente sociologiquement, car c’est plus une catégorie relationnelle qui sert de repoussoir : le « bobo » c’est toujours l’autre. Ce qui a été pertinent pour moi dans cette enquête, est que lorsqu’on questionne quelqu’un au cours d’un entretien, on se questionne toujours un peu soi-même aussi. Alors finalement, si ma condition sociale se rapproche de la sienne, à quel point mon mode de vie risque-t-il de se rapprocher progressivement du sien ? Je n’ai qu’une emprise limitée sur ces éléments mais c’est un réel pouvoir que d’en prendre conscience.
Références
1Sylvie Tissot, « 9. “Anything but Soul Food“. Goûts et dégoûts alimentaires chez les habitants d’un quartier gentrifié », in Philippe Coulangeon et al., Trente ans après La Distinction de Pierre Bourdieu, Paris, La Découverte, 2013, p. 141-152.
2Pierre Bourdieu, La distonction, Paris, Minuit, 1979
Informations
| Pour citer cet article | Pour citer cet article Nom Prénom, « Titre ». Blog de l’Institut des sciences sociales [En ligne], mis en ligne le XX mois 2022, consulté le XX mois 2023. URL : |
| Auteur·ice | Par Camille Bardet, étudiante |
| Contact | camille.bardet.1@unil.ch |
| Enseignement | Séminaire de sociologie générale Par Marc Perrenoud et Lucile Quéré |