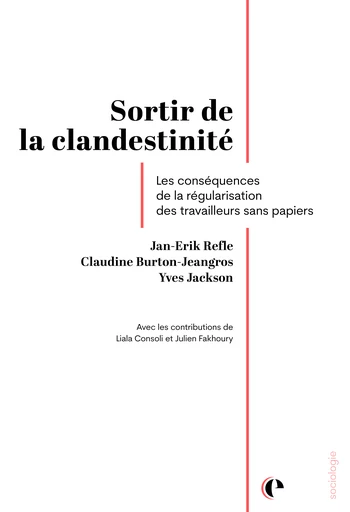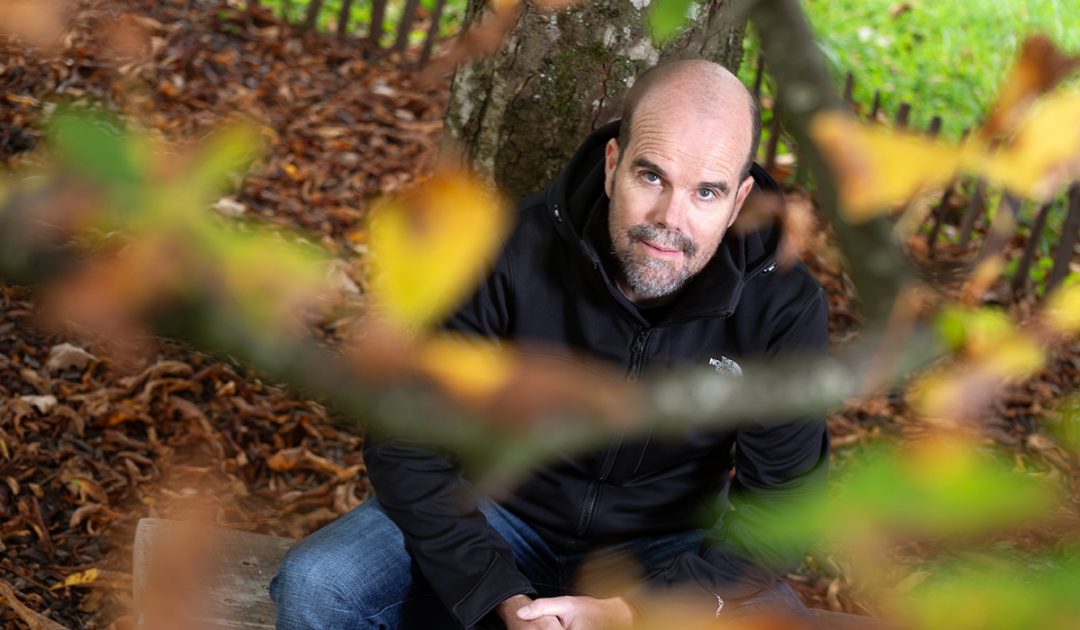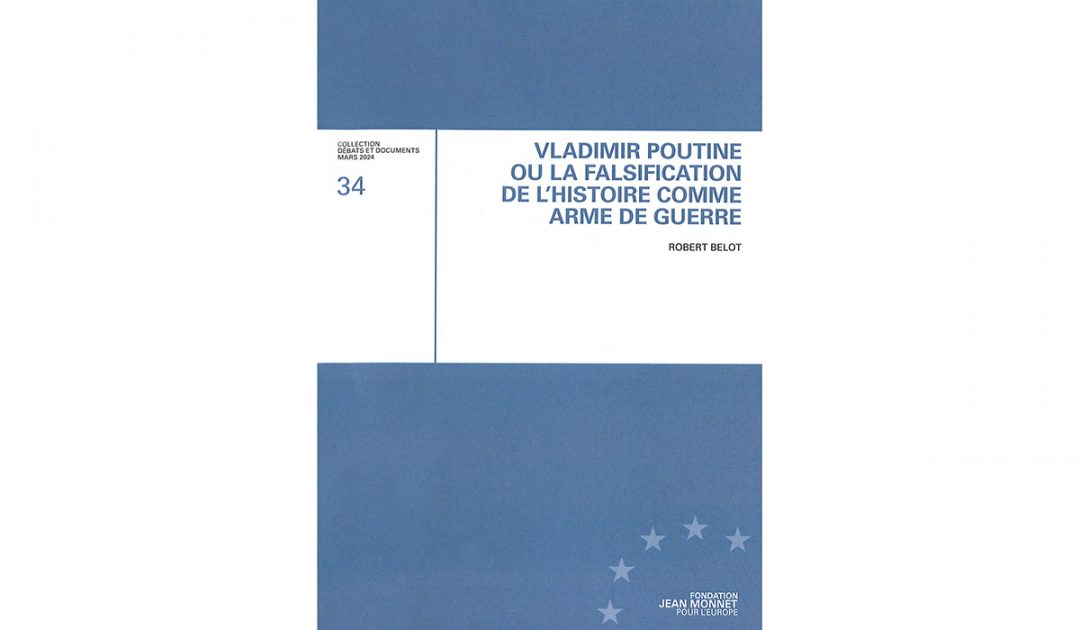Que signifie vivre et travailler en Suisse pendant des années sans papiers ? Une recherche et un ouvrage apportent des réponses à cette question. Rencontre avec l’un des auteurs, Jan-Erik Refle.
C’est une expérience de régularisation réalisée entre 2017 et 2018 dans le canton de Genève (en lien avec le Secrétariat d’État aux migrations), mais qui pourrait se reproduire ailleurs, sans doute avec des résultats similaires. D’abord un progrès pour toutes les personnes concernées par cette opération « Papyrus » (permis de séjour d’un ou deux ans renouvelable). Ceci sans effet notable d’appel d’air, contrairement à des craintes souvent exprimées dans la société et répercutées au niveau politique. Chargé de cours à l’UNIL (SSP) et chercheur associé LIVES, le politologue Jan-Erik Refle signe Sortir de la clandestinité avec Claudine Burton-Jeangros, professeure à l’Unige, et Yves Jackson, médecin aux Hôpitaux universitaires de Genève.
Un sujet encore peu exploré
Ce bref ouvrage résume la vaste étude « Parchemins » (2017-2022), rare recherche à éclairer sur quelques années ces chemins de vie en migration et à pouvoir livrer des résultats quantitatifs, qualitatifs et comparatifs. « La première vague de l’enquête auprès des personnes sans papiers répondant ou non aux critères de Papyrus a concerné 468 participants avec une moyenne d’âge de 44 ans, en majorité des femmes travaillant dans l’économie domestique, mais aussi des hommes, engagés dans la restauration et la construction », décrit le chercheur.
Ces femmes déracinées cumulent parfois jusqu’à 11 employeurs, avec de nombreux déplacements non rémunérés, et exécutent des tâches peu valorisées malgré un degré de formation initial généralement plus élevé que celui de leurs homologues masculins. Elles étaient les candidates idéales pour l’opération de régularisation Papyrus, qui exigeait des individus seuls dix ans de vie et de travail dans le canton de Genève, et cinq ans pour les familles.
Les bénéfices de la régularisation
Parmi les bénéfices de la régularisation, le chercheur cite le salaire (relativement meilleur, surtout s’agissant des hommes), une plus grande stabilité professionnelle, l’accès à des vacances rémunérées et aux congés maladie, la possibilité (à vérifier sur le long terme) d’accéder à une formation professionnelle, voire de quitter son secteur d’activité, la liberté de voyager et de revenir en Suisse (essentielle pour des personnes ayant laissé leurs enfants au pays, les femmes plus que les hommes), celle de vivre sans craindre l’expulsion, ainsi que le droit – enfin – de signer un bail pour se loger autrement qu’en sous-location ou chez son employeur. Ces grandes tendances collectives (saisies à travers le temps par quatre vagues de questionnaires) ont été accompagnées d’un suivi individuel et qualitatif de 39 personnes, dont on trouve des extraits dans le livre.
La santé, une question délicate
« Nous avons été frappés d’entendre la plupart des participants se déclarer satisfaits de leur vie – encore davantage après régularisation – et en bonne santé, alors qu’une observation plus rigoureuse révélait un degré d’anxiété et de dépression plus élevé que dans la population générale », esquisse Jan-Erik Refle. Raison même de leur présence en Suisse, le travail implique forcément une bonne santé, dès lors sans doute surestimée par les personnes concernées. « On peut penser aussi que seules les personnes les plus solides sont capables de quitter leur pays pour survivre autant d’années dans des conditions aussi précaires », ajoute-t-il.
Des espoirs sur le temps long
Une autre caractéristique témoigne de la loyauté des personnes régularisées envers « le pays des opportunités » que la Suisse représente pour elles : la réticence à utiliser les services d’un État qui leur a accordé cette régularisation, alors même que leurs faibles revenus leur donnent des droits aux subsides et autres prestations complémentaires. Mais une sortie définitive de la précarité prendra du temps ; malgré son caractère longitudinal, cette recherche qui porte sur la transition ne peut pas suivre ces parcours de vie sur le long terme : « On pense que ce sont surtout les enfants nés en Suisse qui pourront pleinement profiter des possibilités associées au nouveau statut familial », déclare le chercheur.
Comparaison avec un groupe non régularisé
Il faut préciser qu’un groupe de sans-papiers non éligibles à la procédure Papyrus a fait partie de l’étude et permis d’esquisser une comparaison avec les personnes nouvellement dotées d’un statut légal. On constate que ces travailleurs non régularisés obtiennent moins d’heures travaillées, dès lors moins de revenu et de sécurité, et ont plus de peine à trouver un emploi. Les personnes régularisées risquent cependant l’endettement, confrontées pour leur part à de nouvelles obligations (assurances, impôts, loyers plus élevés…) qui, couplées à la réticence à solliciter l’aide étatique, peuvent en obliger certaines à contracter des dettes. Le rôle des associations d’aide aux migrants et des syndicats vis-à-vis des travailleurs sans papiers est souligné dans cet ouvrage, et ne s’arrête ni au travail administratif effectué avec ces personnes en vue de leur régularisation ni au soutien apporté aux chercheurs durant leur enquête.
« Et maintenant, je me sens normal »
Mais les études de ce type ne font sans doute que commencer tant les questions liées à la migration et à l’intégration de profils très diversifiés (contrairement à la relative homogénéité des participants sélectionnés par Papyrus) prennent des tours complexes et potentiellement troublants pour la société d’accueil ; les données soigneusement anonymisées de l’étude Parchemins sont à la disposition d’autres chercheurs intéressés sur SWISSUbase.
Deux exemples, pour terminer, illustrant le volet qualitatif de l’étude : d’abord ces mots d’un homme de 47 ans : « Et maintenant, je me sens normal. Je peux accéder à beaucoup de choses, faire des études, au niveau de la Suisse, faire valider des choses que j’avais faites en Bolivie… » Puis cette confidence d’une femme de 39 ans, presque deux ans après sa régularisation : elle se dit soucieuse de voir ses enfants « faire les choses bien » afin de saisir les opportunités ouvertes par la procédure Papyrus, tout en gardant pour elle-même l’espoir de « changer de secteur de travail » et de « profiter un peu plus de sa vie ». On ne peut que le lui souhaiter.
Sortir de la clandestinité, par Jan-Erik Refle, Claudine Burton-Jeangros, Yves Jackson, avec les contributions de Liala Consoli et Julien Fakhoury. EPFL Press, Lausanne. Version e-book en allemand et en anglais. Les auteurs soulignent que pour faciliter la lecture, ils ont renoncé à l’écriture inclusive.