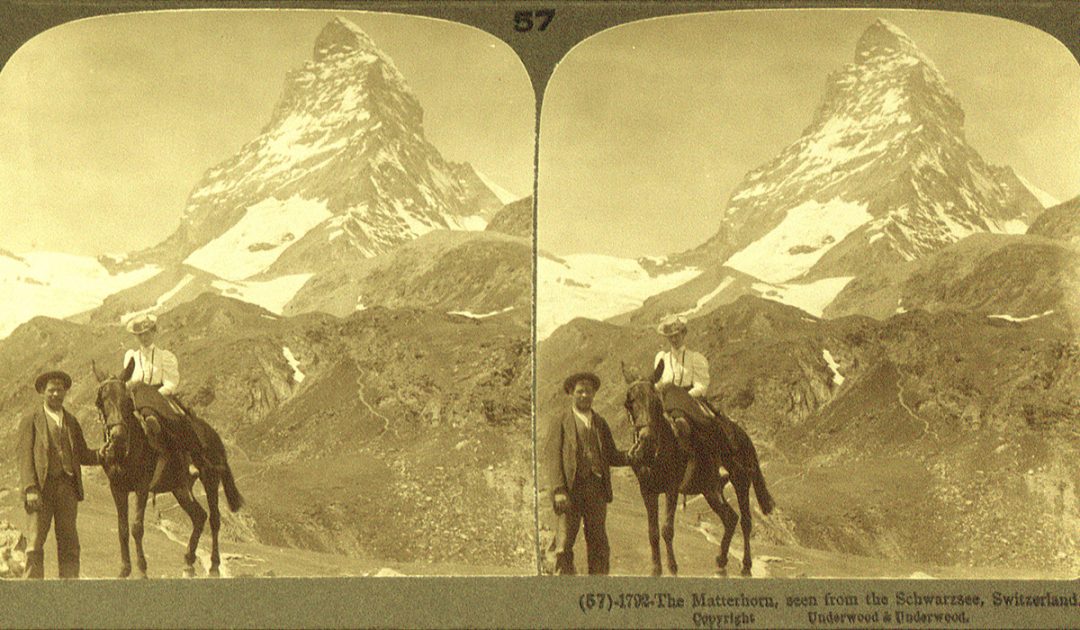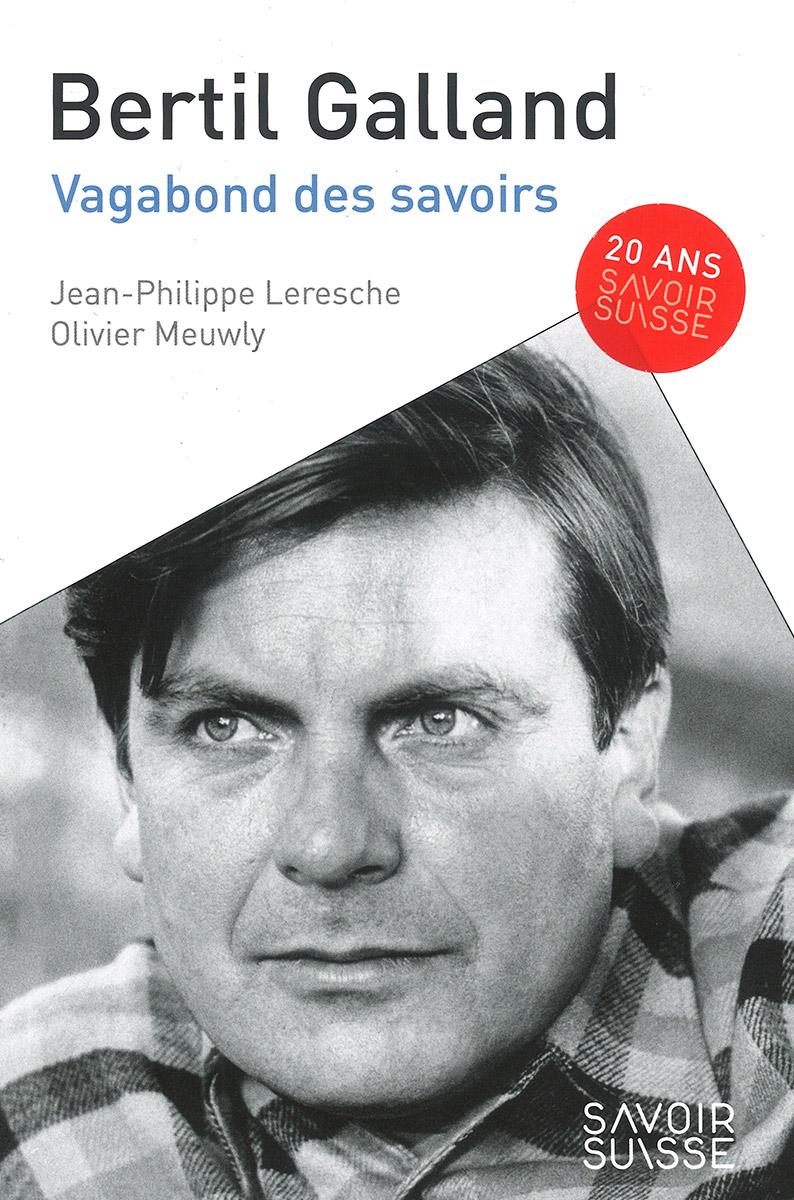Voilà une femme qui écrit pour découvrir autrui, qui refuse l’écriture inclusive par respect de la langue et traduit du suédois et du danois au français, alors même qu’elle est née et a grandi dans ce qui fut l’Union soviétique. Rencontre avec Elena Balzamo, invitée à l’UNIL par le Centre de traduction littéraire.
Lauréate du Programme Gilbert Musy 2022, Elena Balzamo a animé plusieurs rencontres à la Faculté des lettres et séjourne en ce moment au château de Lavigny, où elle achève la traduction d’un grand classique de la littérature scandinave, destiné à l’origine aux écoliers suédois pour les initier à la géographie de leur pays, Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède, de Selma Lagerlöf. Des traductions intégrales de cet ouvrage fameux publié en 1907, il y en a peu, « hormis en Allemagne », remarque Elena Balzamo avec une pointe d’admiration. La sienne sera la deuxième traduction française à ne pas se contenter de « l’histoire du petit garçon ensorcelé qui voyage avec les oies ».
Elle a réintégré toute la dimension géographique et savante, ainsi que les contes et légendes suédois : « On croit que le héros est un enfant car les illustrations qui ont frappé les esprits l’ont miniaturisé pour le placer sur une oie, mais en réalité il s’agit d’un adolescent ; c’est donc un roman d’éducation et je l’ai abordé comme un récit qui sera intéressant pour des lecteurs adultes. »
Rencontrer Elena Balzamo, menue et exquise jusque dans son petit accent chantant, reconnaissable entre mille, c’est forcément plonger dans sa Russie natale… dont elle a perdu la nationalité durant l’époque soviétique.

Elena Balzamo, votre travail de traductrice ne s’effectue pas dans la langue russe de votre enfance, mais en français. Quel est votre rapport à la Russie et à la France ?
Je suis née en 1956 à Moscou et j’en suis partie en 1981, car je ne me voyais ni y rester sans m’opposer ni emprunter la voie si ardue de la dissidence. Depuis, il y a eu bien des changements dans le pays, mais beaucoup de choses n’ont pas vraiment changé. Ces derniers temps, ma mère, restée là-bas, me dit qu’elle prie tous les jours pour la victoire ukrainienne. Ici, en Suisse, j’ai commencé à rédiger un texte sur la honte : de quoi peut-on ou doit-on avoir honte et a-t-on vraiment honte ? Je me sens russe et française, mais peut-être surtout européenne, étant de ceux pour qui chaque vie humaine est unique et par conséquent « non négociable ». Une position difficile à tenir face aux régimes qui placent l’État, l’idéologie ou la religion au-dessus des individus. Alors la tentation est forte, chez les Européens, de se taire pudiquement… ou lâchement. Il faut distinguer entre la culpabilité et la responsabilité collectives. Certes, je n’ai tué personne, mais si je me tais, je me rends chaque fois un peu plus responsable quand d’autres le font. Autrefois, j’avais honte d’avoir le passeport soviétique, puis, face à notre inaction devant les agissements russes en Géorgie, j’ai commencé à avoir honte de mon passeport français… Mais aujourd’hui je n’ai plus honte : l’Europe s’est réveillée et soutient massivement l’Ukraine. Quant aux citoyens russes, je note avec admiration les cas de ceux qui font preuve d’un grand courage pour essayer de faire entendre leurs voix dissidentes : un homme qui repeint sa palissade en jaune et en bleu, une femme qui écrit « Non à la guerre » sur la neige, audace que ces personnes paient très cher…
Dans votre nouveau livre Périmètre élargi, on trouve chez Julius Lagerheim, le consul général de Suède à Alger, entre 1826 et 1829, cette difficulté à critiquer un régime étranger, même quand un érudit de l’intérieur l’invite à le faire en jetant un regard sévère sur son propre pays, alors sous domination turque…
Oui, les dissidents peinent partout à se faire entendre. Pourtant, ce consul n’est pas aveugle : son récit regorge d’exemples d’injustices et de violences, notamment à l’égard des juifs. Ce diplomate est d’ailleurs un véritable écrivain et un observateur hors pair. Même s’il ne parle ni le turc ni l’arabe, il fait des rapprochements étonnants entre des réalités fort éloignées, grâce à sa curiosité et à sa capacité à surmonter ses aprioris. En me documentant sur cet homme dans les archives suédoises, je me suis aperçue qu’il était loin d’être le seul diplomate à manier la plume. Cela m’a donné l’idée d’organiser en Suède un colloque sur ces ambassadeurs qui se promenaient entre la Russie et l’Europe du Nord, ou encore dans le triangle entre l’Espagne, l’Italie et l’Afrique du Nord, à une époque où le courrier prenait des semaines à arriver, voire se perdait en route. Un volume des actes de ce colloque est en préparation.
Vous avez voulu éditer ce récit du consul en raison de sa qualité littéraire… mais vous n’avez pas trouvé d’informations relatives à son auteur dans les archives suédoises. Et vous n’avez pas ouvert une certaine lettre cachetée, pourquoi ?
Cela n’arrive pas tous les jours qu’on découvre un manuscrit du XIXe siècle d’une telle valeur. Ce texte est fascinant ; à lui seul, le récit du naufrage de la goélette qui transportait l’auteur possède une telle tension dramatique que je n’ai pas résisté à la tentation de le reproduire intégralement dans mon livre. À ma grande déception, je n’ai pas réussi à trouver un portrait de cet homme. Quant à la « lettre cachetée », qui se trouve parmi d’autres papiers et que je n’ai pas voulu ouvrir, je ne suis pas une archéologue qui fracasse les sarcophages, mais qui sait, peut-être un jour… Car je continue à m’intéresser à ces archives comme à la boîte noire d’un avion ; dès qu’on ouvre un classeur, on voit surgir toute une époque, avec des billets, des factures, des lettres. Avec des témoignages étonnants, comme celui du secrétaire du consulat qui tenait un journal : on y trouve d’abord des notes succinctes sur les bateaux qui arrivent à Alger, puis repartent – visiblement, rien ne se passe – puis avec le blocus français, et le siège de la ville, les notes deviennent plus serrées et longues : encore un vaste champ à explorer. Je ne m’intéresse pas suffisamment à moi-même pour écrire des romans et ne veux pas disséquer mes états d’âme ; je préfère suivre des êtres inconnus ou oubliés, même si, dans ce livre, j’évoque quelques souvenirs personnels qui surgissent en regard du manuscrit dont je commente le contexte et les personnages. Ainsi, la description de la peste à Alger entre 1817 et 1824 donne plus de relief à notre époque confrontée à la pandémie, par exemple.
En somme, vous ressemblez au consul Julius Lagerheim qui raconte avec un vrai plaisir d’écriture ceux qu’il rencontre, par exemple le futur émir Abdelkader…
En effet, il décrit avec minutie, et souvent avec humour, ses collègues, diplomates européens, mais aussi des dignitaires locaux et des hommes modestes de son entourage, et même quelques femmes musulmanes, qu’il rencontre à de rares occasions car elles vivent cloîtrées. Concernant Abdelkader, sa rencontre avec le consul suédois – auquel il fait cadeau d’un beau cheval – me paraît fascinante, car nous savons ce que deviendra cet homme, alors que pour le consul suédoisc’est un simple chef local, un inconnu. C’est là que réside la valeur de son récit : son témoignage est un des très rares portant sur l’époque juste avant le début de la colonisation française. On voit, là aussi, qu’il suffit d’un prétexte pour précipiter une invasion…
Aimez-vous la langue française au point de ne pas accepter les interventions actuelles pour la féminiser ?
On ne doit pas violenter la langue, elle évolue selon ses propres lois. Même de simples réformes, comme il y en a eu en Suède, laissent des traces : aujourd’hui, les gens ont du mal à lire les textes pourtant pas très anciens. Quant au français, à force de lire tous ces signes surajoutés de féminisation, on en vient à masquer le féminin et à ne plus voir les femmes dans notre pluriel grammatical, ce qui est un comble. Il y a aussi le risque de transformer notre perception d’une manière anachronique : quand des jeunes liront demain Maupassant, ou tout autre écrivain du passé, y compris des femmes, ils les trouveront tous monstrueusement misogynes, non pas suite à une véritable analyse du contenu des textes, mais uniquement en n’y trouvant pas cette nouvelle signalisation. Si cette tendance devait perdurer, ce qui n’est pas certain, du moins en France, elle va tordre la réalité, déplacer le jugement et introduire des associations hors de proportion entre des auteurs et une misogynie pas forcément réelle, mais comme inscrite dans la langue. Le russe est riche en formes grammaticalement féminines, à l’opposé, par exemple, de l’anglais, qui pourrait alors être considérécomme la langue la plus antiféministe du monde. Mais Tolstoï n’était pas moins machiste que Henry James ou Molière, dont on sait bien qu’il ne l’était pas !
Elena Balzamo, Périmètre élargi, Marie Barbier Éditions, 2022