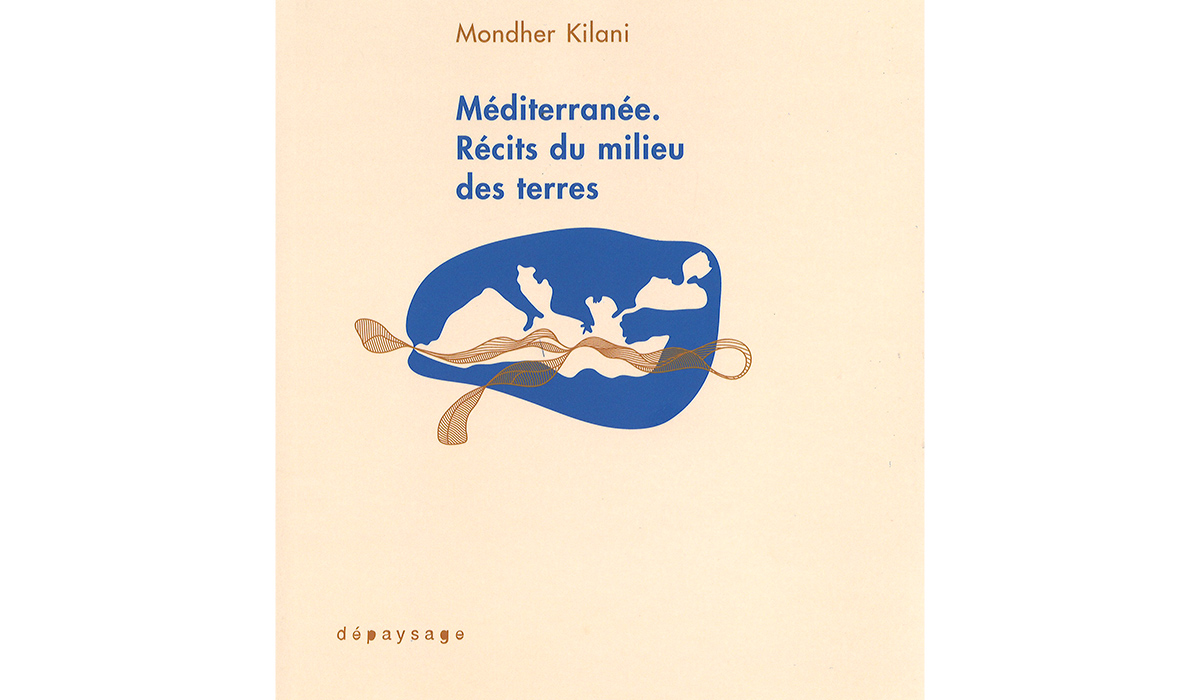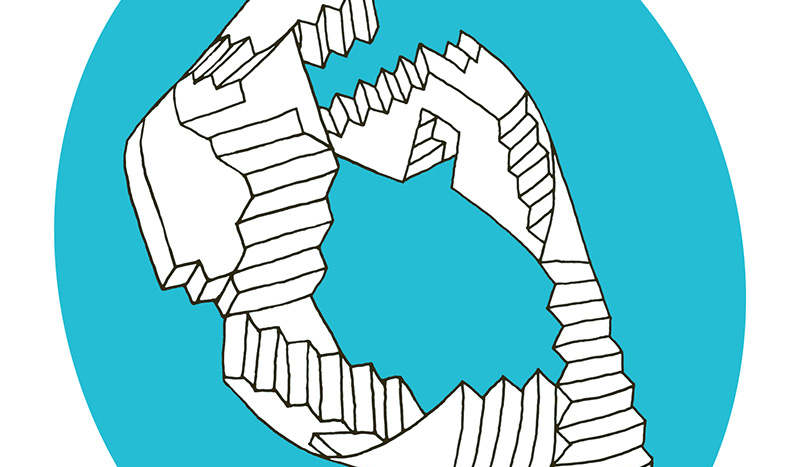En cherchant un titre alternatif à ce livre, on songe qu’une référence aux « braves gens » pourrait traverser les différents moments de ces cultures méditerranéennes mises en relation, d’une rive à l’autre, par l’anthropologue Mondher Kilani.
Des chapitres courts et précis, une écriture élégante et accessible, une culture qui entrelace les événements historiques, les références culturelles, les personnages grandioses ou modestes, un zeste non pas d’autofiction tape-à-l’œil mais de sobre récit familial sur fond d’itinéraire intellectuel : ce livre évoque pour celles et ceux qui – telle la soussignée – furent ses étudiants le raffinement, le savoir anthropologique et la gentillesse de Mondher Kilani, professeur honoraire à l’UNIL. Les autres lecteurs n’en seront pas exclus pour autant : ce bref ouvrage ouvre une porte à la fois enchantée et inquiète sur une mer si proche dont nous aimons tous parcourir les rivages.
D’une rive à l’autre
Aux adeptes actuels d’un repli sur soi identitaire, avec côté Sud une mobilisation politique douteuse et constante du fantôme colonial, dont parle l’écrivain Kamel Daoud, et côté Nord l’oubli entretenu des liens subtils et profonds entre les traditions, l’anthropologue répond par l’histoire des civilisations et de l’humaine condition dans le pourtour méditerranéen. Il invite à quitter le sol stérile de l’ignorance, à se déplacer mentalement d’une rive à l’autre dans cet espace géographique réduit, mais riche culturellement et très étendu dans le temps.
Souvenir de Tunisie
Il se sert de la formule anglaise « route not roots », mais c’est bien vers nos racines communes qu’il nous conduit, et c’est important à l’heure où certains en viennent à oublier dans la détestation réciproque – et la terreur islamiste – que l’islam n’est pas si étranger au christianisme et offre, en particulier, « maintes caractéristiques communes avec le judaïsme ». À propos de la Tunisie, sa terre natale, et plus généralement du Maghreb, Kilani parle d’une « civilisation judéo-musulmane » et se souvient d’un lointain passé où la Tunisie fut carthaginoise, juive, romaine, berbère, islamisée, au carrefour de multiples influences dont il s’est abreuvé à l’école, avant de gagner la France, puis la Suisse.
Les points de rencontre
La mer rapproche, surtout les braves gens, femmes et hommes avec leurs rituels moqués, leurs mythes et leurs savoirs méprisés, leurs efforts matériels et symboliques pour survivre, se consoler ou se rebeller, mais aussi les héros, les anciens dieux, les mystiques chrétiens et musulmans soufis, les poètes, les savants, les langues, les manuscrits. Même un roi de France comme Louis IX (ridâfrans en arabe), qui créa la bibliothèque royale en 1254 après avoir admiré celle du roi des Sarrasins, a nourri par son épopée à la fois guerrière et naïve en Terre sainte la légende catholique de saint Louis, bien sûr, mais aussi le récit musulman de « Sanluwîs ». Il mourut à Carthage, là même où vécut saint Augustin, évêque berbère et grand théologien chrétien.
Antagonismes et combats communs
Mais le mare nostrum est aussi la terre des juifs persécutés, convertis, chassés, une rive sud colonisée, des guerres ancestrales, des esclaves de part et d’autre ; sans oublier des dictateurs modernes, dont certains furent dégagés dans une esquisse de printemps arabes et, avant eux, en Italie, en Espagne ou en Grèce, dans un élan démocratique dont Kilani, peut-être, n’évoque pas assez les prolongements, le sujet dépasse en effet le pourtour méditerranéen mais s’impose dès lors qu’il s’agit d’évoquer ce phénomène majeur de l’après-guerre qu’est la construction européenne. C’est d’ailleurs à cette échelle, et dans un partenariat avec la rive sud, qu’il faudra lutter contre les pollutions et la surpêche internationale et industrielle dont Kilani, avec son regard d’anthropologue sensible à des pratiques ancestrales plus respectueuses, nous livre un poignant aperçu.
La Méditerranée comme modèle de diversité
Animé par le souci d’entendre « l’écho de l’autre en soi », de reconnaître les emprunts culturels au lieu de les oublier dans un excès de cannibalisme prédateur, l’auteur rappelle que la Méditerranée est un modèle de « diversité historique, culturelle, religieuse et linguistique », et que le propre de la culture est justement de « varier à l’infini ses motifs et sa morphologie », ce qu’il nomme le « relativisme culturel ».
Curieusement, il semble lui-même peu reconnaissant envers « l’universalisme républicain français », qu’il réduit un peu trop vite à une forme d’hégémonisme en oubliant la laïcité, qui place toutes les religions à égalité devant la loi, sans qu’aucune, y compris catholique, ne puisse réclamer, seule ou dans un partenariat interreligieux, un rôle social prépondérant.
Universalisme républicain ou particularisme français ?
Bien sûr, ce n’est jamais facile d’être minoritaire, mais où que ce soit au monde. Le projet républicain vise précisément à offrir un cadre commun dont chacun peut se réclamer pour faire valoir ses droits, un cadre citoyen sur lequel s’appuyer indépendamment des appartenances multiples. En ce sens, l’universalisme républicain n’est pas un particularisme français ; même s’il est né en France, il peut inspirer d’autres pays en d’autres horizons.
Voilà pour le bémol surgi à la lecture de cet ouvrage qui ouvre tant de pistes à l’admiration et à la réflexion.
Méditerranée. Récits du milieu des terres, par Mondher Kilani, éditions Dépaysage, 2024