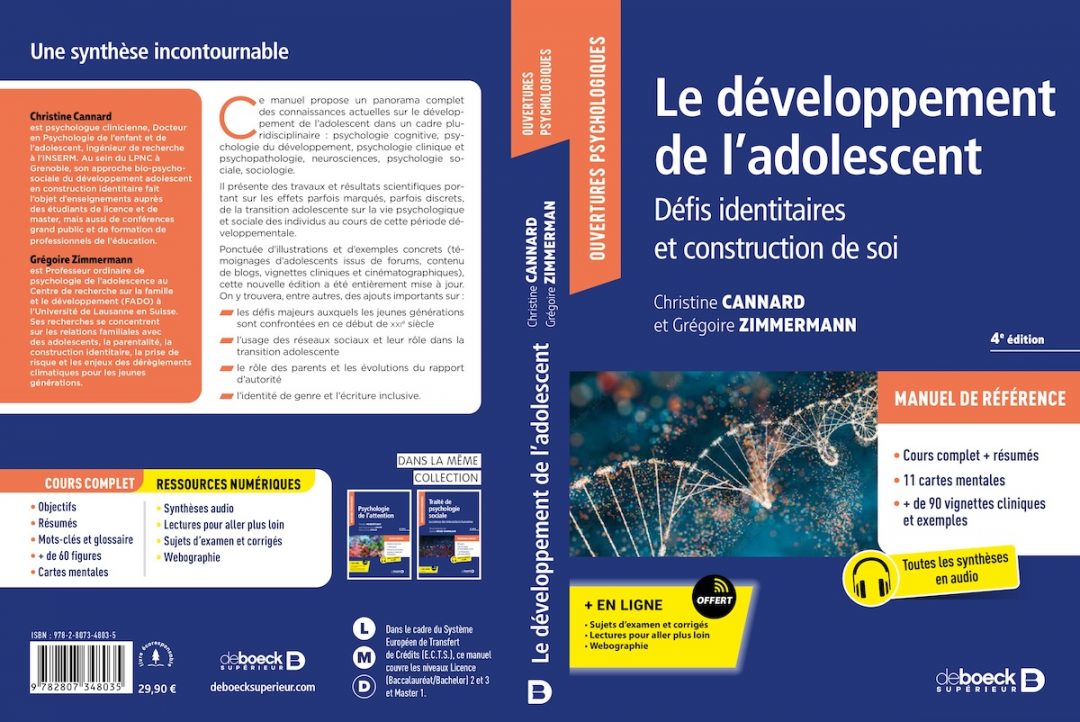Accompagner une personne en souffrance suicidaire est un exercice complexe et délicat. Pour prévenir le suicide, Laurent Michaud, médecin-cadre dans le Service de psychiatrie de liaison, préconise de renoncer à vouloir prédire le passage à l’acte et de privilégier une approche centrée sur la rencontre.
« Nous ne sommes pas tellement meilleurs que le hasard pour évaluer la probabilité statistique que quelqu’un se suicide. » Laurent Michaud, médecin-chef dans le Service de psychiatrie de liaison au CHUV ne baisse pas les bras pour autant. Car un accompagnement pour des personnes dans le besoin reste nécessaire, mais surtout, possible et utile à la prévention du suicide. Mais pour ce faire, un changement de paradigme est nécessaire, estime-t-il. Il s’agit de sortir de l’idée qu’il est possible d’identifier les individus les plus à risque et de concentrer les soins sur ceux-ci, ce que confirme la recherche sur le sujet depuis plus de 50 ans. « Année après année et article après article, ce qu’on voit est que ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ? Parce que, fort heureusement, l’occurrence de l’événement est très faible. Il y a 5000 personnes qui viennent aux urgences psychiatriques du CHUV par année. Sur ces 5000, il y en a entre zéro et dix qui, peut-être dans les mois suivants, vont décéder par suicide. » La difficulté de la prédiction est non seulement due à la rareté de l’acte, mais aussi à son caractère multifactoriel. De nombreuses variables peuvent en effet entrer en jeu, allant des facteurs sociaux aux troubles mentaux.
À la recherche de la grille objective
Même si l’occurrence reste faible, tout le monde souhaiterait qu’elle soit de zéro. Pour limiter au maximum ce taux, il est naturel de souhaiter que les professionnels de la santé qui se retrouvent devant une personne en détresse sortent une grille d’évaluation objective et cochent ses cases en fonction du comportement et de la santé de l’individu. Ainsi, ces professionnels pourraient adopter une marche à suivre afin que l’aide soit optimale en prenant en compte les dernières connaissances scientifiques. « Avoir des recommandations, une marche à suivre et des mesures objectives du risque de suicide rassure souvent les institutions », commente Laurent Michaud.
Le problème réside dans le fait que les grilles d’évaluation développées jusqu’ici manquent non seulement d’efficacité, mais peuvent même s’avérer être contre-productives. Selon certains travaux tels que ceux de Michael J. Smith, une focalisation sur l’évaluation du risque peut détériorer la relation entre médecins et patients et patientes. « Avec un instrument, on va se focaliser là-dessus et délaisser le lien qu’on va pouvoir créer avec la personne qui a besoin d’aide et la construction de l’alliance qui est nécessaire et protectrice vis-à-vis du processus suicidaire. »
Femmes, hommes, une inégalité d’estimation
Qui plus est, il a été remarqué que l’évaluation du risque dépend de nombreux éléments, dont le genre des patient·es et même celui des médecins qui les évaluent. Il existe en effet un « paradoxe du genre » dans la suicidalité en Suisse, où les femmes ont tendance à tenter plus souvent de se suicider (4,5% des femmes contre 3,3% des hommes en Suisse en 2022 selon l’Obsan), mais les hommes décèdent trois fois plus du suicide (16,2 hommes contre 5,8 femmes pour 100’000 habitant·es en 2022, toujours selon l’Obsan). De nombreux éléments, majoritairement sociétaux, interviennent dans ce phénomène, explique le médecin : « Les hommes vont généralement plus vite passer de l’idée à l’exécution. Ils vont aussi avoir plus de difficultés que les femmes à exprimer leur mal-être, leurs émotions et à demander de l’aide. Une éducation marquée par des représentations stéréotypées des rôles de genre explique probablement la surmortalité masculine plus que des facteurs biologiques. »
La prise en charge des patients et patientes qui montrent un risque de tentative de suicide pourrait aussi être différente en fonction du genre des médecins qui sont en face, comme l’a montré une récente recherche menée par Milène Barboteo à l’UNIL et supervisée par Laurent Michaud (voir encadré).
Le genre du ou de la médecin influence l’estimation du risque de suicide
Une recherche publiée cette année dans la revue Cogent Psychology a démontré que le risque de faire une tentative de suicide est évalué différemment en fonction du genre des médecins qui l’estiment. Quatre cent sept médecins suisses étaient invités à lire des cas de patients ou patientes fictionnels et à évaluer le risque d’un suicide. Résultat : non seulement les médecins hommes ont estimé le risque plus bas que leurs collègues femmes, mais il y avait aussi une différence en fonction de la similarité de genre entre médecins et patient·es. Les médecins jugeaient le risque comme étant plus élevé pour des patients du même genre, autant pour les femmes que les hommes. Même si les cas réels restent très différents d’un texte fictionnel, les auteurs concluent qu’« intégrer une sensibilisation aux biais potentiels relatifs à ces caractéristiques dans l’éducation médicale et les formations actuelles est crucial ».
Un changement de perspective nécessaire
Même si elle paraît intuitivement bénéfique, la recherche d’objectivation du risque de suicide ne semble finalement pas l’être. Ce qui change complètement la prise en charge. « On est vraiment en train de faire un changement majeur », commente le médecin-chef dans le Service de psychiatrie de liaison. Celui d’un passage d’une tentative, vaine, d’objectivation de l’évaluation du risque du suicide à une focalisation sur la rencontre humaine et l’accompagnement : « On le voit dans la formation continue universitaire que l’on donne depuis 20 ans. Elle s’appelait auparavant « Faire face au risque suicidaire » et elle vient de changer de nom pour devenir « Prévention du suicide : rencontrer et accompagner ». »
Ce changement de paradigme est observé depuis quelques années en Suisse romande ainsi que dans les pays anglo-saxons. Le mouvement n’est cependant pas mondial, les États-Unis ayant tendance à poursuivre des études pour tenter d’améliorer les évaluations quantitatives. Depuis les débuts de l’histoire de la prise en charge de la suicidalité, l’approche dépend de la route sinueuse qui slalome entre avancées scientifiques, aspects culturels, craintes et tabous.
Pour en savoir plus…
- Le dernier rapport de l’Obsan sur les pensées et comportements suicidaires en Suisse (2024)
- Barboteo, M., Lasserre, A. M., Studer, J., Brovelli, S., Clair, C., & Michaud, L. (2025). « Physician’s and patient’s gender influence on suicide risk assessment : A cross-sectional study ». Cogent Psychology, 12 (1), 2438433.
- Michaud, L., Brovelli, S., & Bourquin, C. (2021). « Le paradoxe du genre dans le suicide : des pistes explicatives et pas mal d’incertitudes ». Revue médicale suisse, 17, 1265-7.
- Smith, M. J., Bouch, J., Bradstreet, S., Lakey, T., Nightingale, A., & O’Connor, R. C. (2015). « Health services, suicide, and self-harm : Patient distress and system anxiety ». The Lancet Psychiatry, 2(3), 275-280.