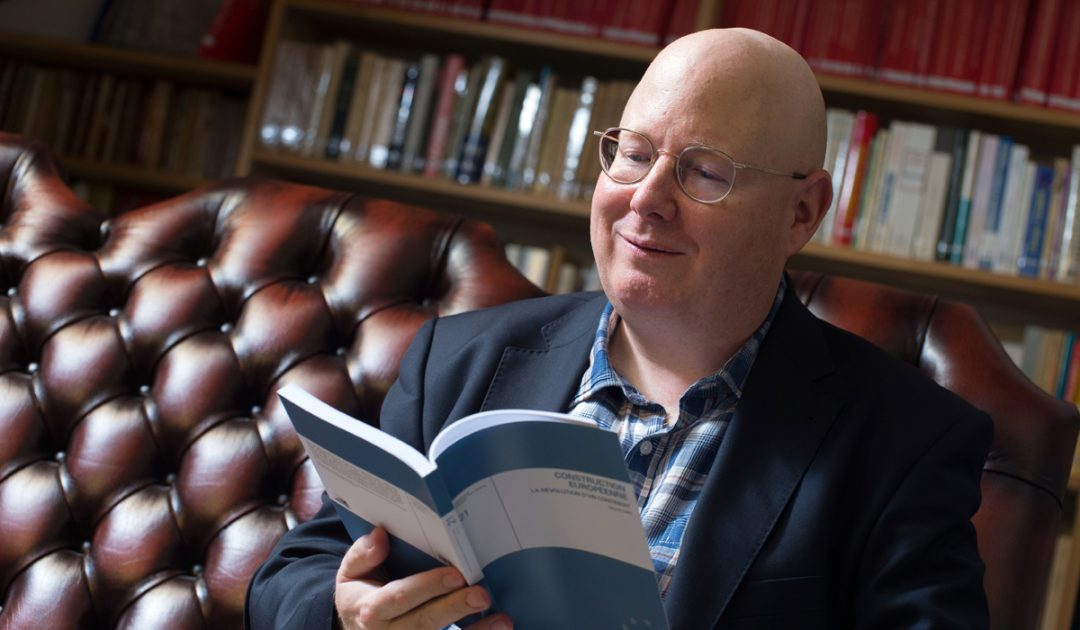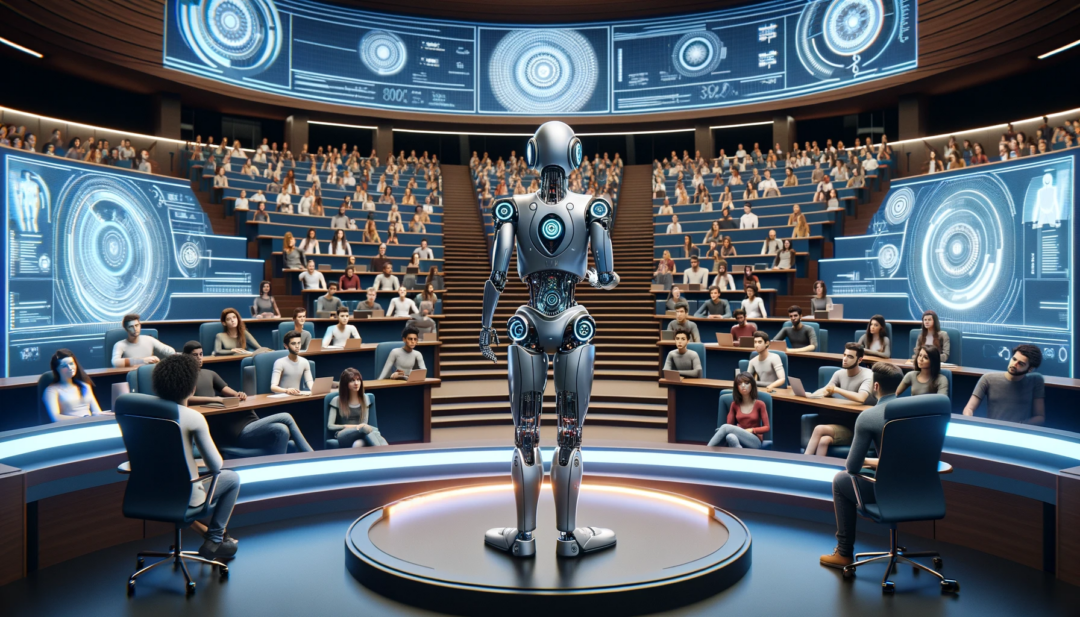Réunies autour d’un podcast, l’UNIL et la Maison d’Ailleurs font dialoguer recherche et science-fiction.
Fin du monde, guerres, cataclysmes. La fiction redouble d’efforts lorsqu’il est question de mettre en scène films à sensation et, plus largement, œuvres culturelles qui souhaitent faire vivre des émotions fortes au public. Ou qui questionnent la vie de tout un chacun. C’est encore plus vrai dans le domaine de la science-fiction, au cœur d’un nouveau podcast, coproduit par l’UNIL et la Maison d’Ailleurs, musée de la science-fiction, de l’utopie et des voyages extraordinaires.
Si ce monde vous déplaît, diffusé depuis mercredi 13 octobre et jusqu’à fin janvier 2022, propose dix rencontres avec chercheuses et chercheurs de l’UNIL, autour d’un classique du genre, selon leurs disciplines de prédilection. Parmi les thèmes : écologie, pandémie, totalitarisme ou encore censure. Autant de sujets questionnés par la culture depuis des siècles, que la réalité rattrape parfois.
« La science-fiction propose une esthétique qui permet de pointer ce qui nous dérange dans notre monde », raconte Marc Atallah, maître d’enseignement et de recherche à la Faculté des lettres, directeur de la Maison d’Ailleurs et instigateur du projet. « Les sujets choisis pour cette première saison sont des thèmes importants pour le genre, aussi bien au cinéma que dans la littérature ou à travers la BD. Et ils résonnent étroitement avec la réalité », complète le chercheur. Ce que confirment les propos des scientifiques invités.

Alerte virus
Mars 2020, la plupart des gouvernements mettent leur population sous cloche. Un nouveau virus est arrivé. Personne ne le connaît, les scientifiques du monde entier se penchent massivement sur la question. Ce qu’on sait : il se propage rapidement d’un humain à l’autre. De partout on entend qu’il s’agit de science-fiction. « Quand on prononce cette phrase au sujet de la pandémie par laquelle nous avons été frappés, on se réfère à l’imaginaire qui colore une large part de notre horizon culturel. Même celle qui n’est pas cataloguée de science-fiction », souligne Vincent Barras, historien de la médecine et professeur à la Faculté de biologie et de médecine. Ainsi des œuvres telles que Frankenstein ou La Peste d’Albert Camus.

Un lien donc évident entre une situation concrète et tangible et les scènes dépeintes dans la culture. « La fiction a comme effet, parmi d’autres, de nous faire réfléchir au réel. Parce que nous sommes constamment en train d’anticiper le réel qui nous viendra demain, de digérer celui qui nous est arrivé hier et celui dans lequel nous avons le nez aujourd’hui », constate Vincent Barras. À ceci près que la science-fiction opère, quant à elle, par des métaphores. Comme en témoigne Le dernier homme de Mary Shelley, narrant la prolifération d’un virus invisible à travers l’Angleterre. Une critique de la xénophobie qui se propage entre les hommes, à laquelle l’auteure a choisi de donner la forme d’une peste.
Reste un cas particulièrement intéressant : le virus en lui-même. Qui, selon le médecin, reprend certaines caractéristiques du vivant, sans en être un en tant que tel. Les virus seraient-ils donc les zombies ou morts-vivants qui résident en chacun de nous ? « Si j’étais un spécialiste de science-fiction, je dirais que oui. En tant qu’historien des sciences, je dirais plutôt qu’il s’agit du non-vivant, ou mieux un vivant non vivant. Au fond, le mort-vivant, c’est un peu le non-vivant au sein du vivant. »
Retrouver la terre
Avec l’émergence des vagues vertes à la fin des années 1960, la science-fiction a aussi fait de l’écologie l’un de ses thèmes de prédilection. En témoignent les nombreuses œuvres illustrant la fin cataclysmique du monde, frappé par les éléments les plus extrêmes. Avec un sous-genre en particulier : la « cli-fi », pour « climat-fiction ».
« Au-delà des cascades et de l’aspect sensationnel des films apocalyptiques, il faut dire que les auteurs sont plutôt forts, et que la base des scénarios, leur contexte sont plutôt bien réfléchis. Ce qu’on voit aujourd’hui peut effectivement nous rappeler certaines œuvres de science-fiction », concède Stéphanie Grand, maître d’enseignement et de recherche à la Faculté des géosciences et de l’environnement, spécialiste des sols.
Contrairement à la fiction en revanche, la chercheuse, également invitée de Si ce monde vous déplaît, refuse de basculer dans le catastrophisme. « Il y a beaucoup d’alarmisme dans les sciences de l’environnement. Et à juste titre, puisqu’il faut bien alerter l’opinion. Mais nous sommes encore loin d’avoir complètement dégradé la capacité productive de nos sols, au-delà d’un point de non-retour. Même si la dégradation des sols est bien réelle, en améliorant les pratiques et en mettant les moyens nécessaires, nous pouvons restaurer leur fertilité. Mais il faut le vouloir. »
Un alarmisme criant dans Soleil vert de Harry Harrison, au point que les ressources naturelles ont été épuisées par la surpopulation et la surexploitation de celles-ci et des sols par l’humain. Critique même pas voilée du capitalisme et du proche néolibéralisme, que nuance Stéphanie Grand. « L’existence de toute espèce est basée sur l’exploitation d’une ressource. C’est la chaîne trophique. Dans la nature, il y a des mécanismes de régulation, qui fonctionnent plus ou moins bien. On voit par exemple avec les grands prédateurs que l’équilibre avec les ressources est toujours fluctuant. Quand leur population n’est pas régulée, qu’elle se multiplie à outrance, elle ne trouve plus les ressources caloriques nécessaires quand survient un hiver rude. La population s’effondre, puis se remet à croître avec le surdéveloppement de ses proies. » Un cycle perpétuel entre croissance et effondrement dans lequel s’inscrit également l’humain. Qui demande aussi un cadre et une régulation pour éviter un effondrement catastrophique. Et pour ne pas faire de la science-fiction une réalité.