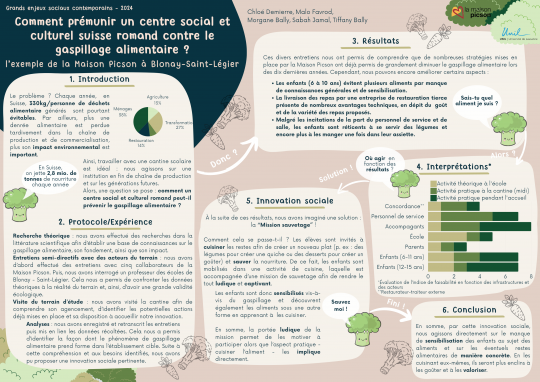Par Claudio Pianca
La thématique des hommes trans et de leur appropriation de la masculinité a toujours été accompagnée par un narratif qui accorde un rôle central à l’utilisation de la testostérone et des hormones masculinisantes. Le discours dominant se base principalement sur une division genrée qui décrit comme « masculin » tout ce qui peut être reconduit à la présence et aux effets de la testostérone (les individus, les comportements, …). Le 5 mars dernier, dans la salle 2121 du Géopolis, le doctorant de l’Institut d’ethnologie et d’anthropologie sociale de l’Université Aix-Marseille, Paul Rivest, nous a présenté son travail ethnographique sur le rapport des hommes trans à la testostérone et leur expérience avec l’appropriation de la masculinité. En nous offrant une nouvelle perspective qui requestionne le narratif dominant autour de cette thématique, il a mené une enquête de terrain auprès de différentes communautés trans françaises, en incluant une quarantaine d’individus ayant vécu une expérience de transition. Pour recueillir leurs récits, il a conduit plus de vingt entretiens, soit individuels, soit en focus groupe, et consulté plusieurs forums dans lesquels beaucoup de personnes trans échangent leurs expériences.
Le premier élément-clé de cette conférence requestionne le rapport de l’individu avec la prise des hormones masculinisantes. Car si l’on croit généralement que l’appropriation de la masculinité doit forcément passer par la prise de la testostérone, on croit aussi qu’elle en sera une conséquence directe. Le narratif autour de la prise des hormones leur attribue ainsi un rôle extrêmement dominant, jusqu’au point où ces dernières « assujettiraient » l’individu lui-même. Un homme trans serait donc considéré masculin s’il prend de la testostérone et si son comportement est concordant aux effets les plus reconnus de cette molécule (en particulier l’augmentation des pulsions sexuelles). Pendant sa conférence, Paul Rivest nous a cependant montré toutes les incongruences derrière à ce raisonnement. Tout d’abord, il faut savoir qu’il n’y a aucune étude scientifique qui confirme que la prise de testostérone est la variable régulatrice principale du désir sexuel, ce qui fait que la reconnaissance d’une hypothétique masculinité à travers les comportements sexuels n’aurait rien à voir avec la prise des hormones. Deuxièmement, plusieurs hommes trans ont partagé, lors des entretiens, comment la décision de suivre une thérapie hormonale porte en soi un travail de raisonnement, d’auto-perception et de questionnement constant de sa propre expérience psycho-physique qui va au-delà de la sphère sexuelle et de la gestion du désir. En ces termes, les hormones masculinisantes ne sont pas des « autoroutes » qui conduisent l’utilisateur vers un modèle de masculinité, mais plutôt des outils grâce auxquels les individus peuvent amplifier leur expérience de transition (surtout en faisant expérience des changements physiques) tout en restant très conscients de leur parcours. Ce n’est donc pas la testostérone qui dicte les règles et les temps d’appropriation de la masculinité, mais c’est l’individu qui évalue comment construire sa propre masculinité aussi grâce à la thérapie hormonale.

Ce n’est donc pas la testostérone qui dicte les règles et les temps d’appropriation de la masculinité, mais c’est l’individu qui évalue comment construire sa propre masculinité aussi grâce à la thérapie hormonale.
Un autre aspect très intéressant qui a été mentionné pendant la partie finale de la conférence (dédiée aux questions pour l’invité) concerne le concept de « masculinité ». Dans la plupart des sociétés occidentales, on tend à considérer comme masculin tout ce qui adhère au modèle de la masculinité hégémonique et de ses dynamiques de pouvoir sous-jacentes. Les mots des enquêtés de Paul Rivest remettent en question cette vision. Le parcours de transition a été pour eux non seulement une expérience de construction identitaire, mais aussi une expérience de construction de leur conception personnelle de masculinité. Certains d’entre eux n’ont donc pas l’intention de reproduire les codes de la masculinité hégémonique, mais bien de la réinterpréter comme quelque chose à accepter tout en se distanciant des dynamiques de pouvoir. Par exemple, en se rattachant au discours concernant la testostérone, le contrôle de l’utilisation des hormones devient une manière de faire l’expérience de la masculinité tout en refusant le modèle socialement partagé qui définit le « véritable homme » par une abondance de testostérone. Dans cette perspective, on « devient un homme » en dosant l’utilisation de la testostérone et en s’éloignant du modèle de la masculinité hégémonique.

le contrôle de l’utilisation des hormones devient une manière de faire l’expérience de la masculinité tout en refusant le modèle socialement partagé qui définit le « véritable homme » par une abondance de testostérone.
En conclusion, la conférence de Paul Rivest a été une occasion particulièrement intéressante non seulement d’approfondir ses connaissances concernant les expériences de transition, mais aussi de s’interroger sur les différentes conceptions de « masculinité ». Personnellement, je crois qu’aborder les thématiques de construction identitaire à travers la méthodologie qualitative (en particulier à travers les entretiens) nous permet d’intégrer au mieux le point de vue de l’autre dans nos réflexions et dans notre propre idée de la psychologie intra-individuelle, ou de nos représentations sociales des individus.
Références
Rivest, P. (2022). La santé sexuelle des hommes trans : entre problèmes de catégorisation et invisibilisation. Santé Publique, 34(HS2), 37–48.
Informations
| Pour citer cet article | Pour citer cet article Nom Prénom, « Titre ». Blog de l’Institut des sciences sociales [En ligne], mis en ligne le XX mois 2022, consulté le XX mois 2023. URL : |
| Auteur·ice | Claudio Pianca, étudiant de bachelor |
| Contact | claudio.pianca@unil.ch |
| Enseignement | Séminaire Sociologie des masculinités Par Sébastien Chauvin et Axel Ravier |