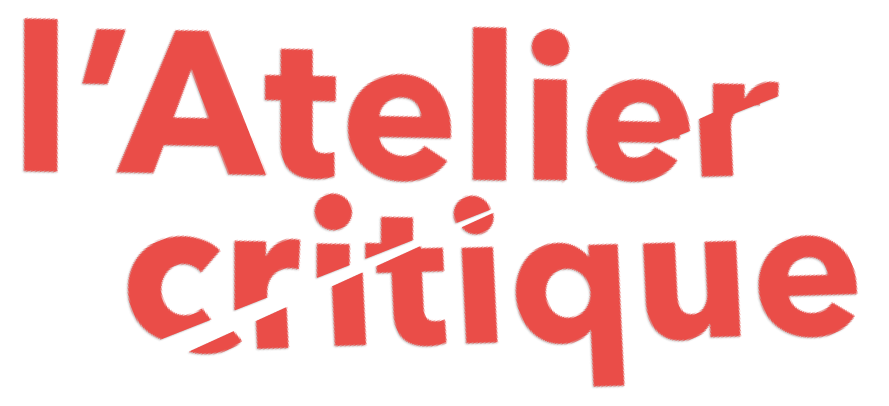Une critique sur le spectacle :
Comment retenir sa respiration / Texte de Zinnie Harris / Mise en scène et chorégraphie de Philippe Saire / Arsenic / du 8 au 19 novembre 2023 / Plus d’infos.

À l’Arsenic, Philippe Saire propose sa dernière mise en scène, basée sur le texte de Zinnie Harris. Célèbre notamment pour ses spectacles de danse, ses mises en scène, telles que Angels in America ou Orphelins, sont marquées par des réflexions sur la physicalité, ainsi que sur les liens entre intime et politique. Cette dernière mise en scène, forte de beaucoup de propositions différentes scénographiques et thématiques, aurait peut-être gagné à plus de simplicité. À moins que là ne se situent les enjeux…
Le spectacle démarre par un quiproquo entre deux personnes : une jeune femme, Dana, et un homme plutôt ambitieux, aimant la puissance et se définissant comme le diable. Il semble, par les clichés convoqués lors de la première scène, que nous avons là affaire à deux amants ayant couché ensemble pour la première fois après s’être rencontrés dans un bar. Mais, avant de partir, l’homme propose de l’argent à Dana en échange de leur relation sexuelle. Cette proposition met Dana très en colère, qui ne comprend pas comment l’homme a pu penser qu’elle était une prostituée. L’échange se termine sur un pari : l’homme affirme, à la façon d’une prémonition, que Dana finira par accepter son argent, tandis qu’elle le refuse obstinément.
À partir de ce nœud initial, l’histoire de la jeune femme n’est plus que descente aux enfers. Il n’est par ailleurs pas certain que l’expression de descente aux enfers ne soit qu’une image : cet homme s’est en effet présenté comme le diable. Ce dernier est d’ailleurs manifestement parti en laissant une marque étrange sur le corps de Dana. Inquiète, elle cherche à se renseigner sur les démons et fait ainsi la rencontre d’un bibliothécaire qui tente de l’aider par le biais de la littérature. Ces deux figures – l’amant et le bibliothécaire – interviennent de nombreuses fois, à des moments et en des lieux surprenants, au cours des péripéties auxquelles Dana est confrontée. Il est parfois difficile d’identifier concrètement la nature de ce qui nous est présenté : les deux figures quasi-mythologiques font-elles partie de l’imaginaire de Dana ou de la réalité ? Le diable est-il effectivement responsable de la descente aux enfers de Dana ? Le bibliothécaire est-il un guide (à la façon d’un ange) qui tente d’aider la jeune femme à sortir de ses difficultés ? À la fin, l’hypothèse de leur existence réelle paraît se vérifier. Néanmoins, la question se pose tout au long du spectacle et rend difficile la lisibilité des enjeux : le propos est-il psychologique, c’est-à-dire est-ce que les hommes ont en eux un diable et un guide ? Faut-il comprendre ces deux figures de façon allégorique, symbolique ? Ou alors le spectacle convoque-t-il simplement des figures surnaturelles ?
Cette difficulté à qualifier clairement les personnages participe à un effet plus grand qui peut déstabiliser les spectateurs : la surabondance. Si cette mise en tension du sens réel de ces figures est déjà en soi un enjeu fort, s’ajoutent à cela de nombreuses problématiques. Sont abordés successivement, selon les épreuves que traverse Dana, des enjeux sociaux (la prostitution, la pauvreté), politiques (la chute économique de l’Europe, la migration) et intimes (la perte d’un enfant pas encore né). L’histoire proposée n’est pas invraisemblable et les thématiques sont souvent amenées de façon fluide, mais la pluralité de celles-ci rend le propos du spectacle peu clair.
Ce sentiment de trop-plein est également provoqué par la pléthore de dispositifs techniques, avec notamment une utilisation appuyée de jeux de lumière. Un voyage en train est, par exemple, figuré par un rail sur la scène entourée de part en part de différents éléments (instruments de cuisine, entre autres). Ceux-ci sont illuminés et projettent des ombres contre le fond blanc, qui font illusion d’un paysage qui défile. Plus tard, un voyage en bateau est éclairé au moyen d’une source de lumière en fond de scène, sur laquelle on a posé un tissu, projetant des ombres qui donnent l’impression de vagues. Ou encore, lors d’une scène où Dana passe un entretien d’embauche, la salle est plongée dans le noir et elle est éclairée de dos par des projecteurs très puissants dirigés de fait vers le public. La scène est difficile à regarder : comme Dana, les spectateurs sont aveuglés et mis dans une situation de malaise. Cette pluralité de dispositifs techniques, ajoutée à l’abondance de thématiques et à la difficulté de situer certains personnages, rend le spectacle quelque peu opaque : que veut-il nous dire, nous faire voir ? Au cœur d’une esthétique explosive, sans temps de respiration (chaque moment de noir, entre les scènes, est occupé par de la musique très rythmée), les spectateurs peuvent sentir leur imaginaire et leur réflexion empêchés par cette stimulation incessante.
Peut-être est-ce là précisément le projet ? Une des dernières scènes est à ce propos signifiante : le bibliothécaire demande au diable quels livres il pourrait donner à Dana pour l’aider et ce dernier se lance dans un monologue dans lequel il accumule différents titres de livres, plus ou moins absurdes, plus ou moins anecdotiques. Ses propos sont par ailleurs accentués par un effet d’échos. Cette scène semble être un reflet de l’éclatement et de la superficialité propres à certains phénomènes actuels : la surinformation, les réseaux sociaux, le développement personnel, la surconsommation, etc. Rappelons d’ailleurs que le nœud initial se joue dans une dichotomie entre relation passionnée et relation tarifée, ce qui semble suggérer que le propos central du spectacle réside dans l’opposition entre deux visions du monde et des relations entre les hommes, l’une poétique et une autre plus froide et calculatrice. C’est peut-être par le trop-plein éblouissant, à entendre comme un miroir de nos sociétés modernes, que le spectacle tente de faire vibrer un propos politique critique vis-à-vis du xxie siècle. Ce qui peut être perçu comme un trop-plein aveuglant est peut-être à ressaisir en tant qu’allégorie d’un rapport au monde excessif et consumériste imposé par les sociétés capitalistes actuelles.