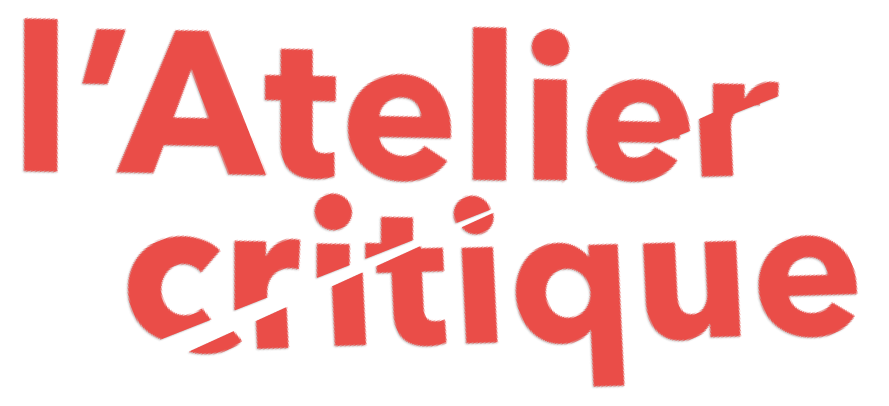Une critique sur le spectacle :
Le Jardin des délices / Conception et mise en scène par Philippe Quesne / Compagnie Vivarium Studio / Théâtre de Vidy (Lausanne) / du 26 septembre au 5 octobre 2023 / Plus d’infos.

L’adage veut que ce soit le chemin qui compte et non la destination. Plongé dans la pièce librement inspirée du tableau éponyme, Le Jardin des Délices, les spectateur·ices ne savent pas vers où l’on navigue et, pourtant, tandis qu’iels sont transporté·e·s par un groupe difficilement identifiable, le spectacle avance (ou passe).
Dans nos sièges, surplombés par les sur-titres en anglais, nous sommes les spectateur·ices d’un bus dont l’habitacle s’illumine et de ses occupant·es qui en sortent pour se regrouper autour d’un œuf géant paraissant sortir tout droit du tableau de Jérôme Bosch. Lors de ce moment d’exposition sans paroles, huit protagonistes, chacun·e se distinguant par un accoutrement différent – perruque singulière ou santiags –, prennent le temps de se présenter physiquement au public en descendant du bus chacun à leur façon. Ils se mettent en mouvement, relèvent le fond du décor camouflant ainsi la coulisse et ses fraises géantes – autre clin d’œil à l’œuvre de Bosch – et rajoutent quelques pierres au nid de l’œuf. Devant ce tableau mouvant silencieux, des questionnements surgissent. Manifestement, ces personnages forment une communauté, mais laquelle ? Société, secte, rencontre d’inconnu·es ou famille ? Quelle façon d’être ensemble est ici explorée ?
Pour les habitué·es du travail du metteur en scène, il n’y a rien de surprenant à se retrouver face à un groupe indéterminé. Quesne a habitué son public à découvrir de petites troupes exhibant et construisant, par leurs pratiques et leurs échanges, un écosystème. Le travail organique proposé par l’artiste ramène les spectateurs à leur rôle premier d’observateur. Plasticien de formation, Quesne réitère l’expérience que l’on peut avoir face à une toile. Pas d’adresse possible, pas d’interactions, seulement une exposition à l’œuvre. D’ailleurs, il s’aventure à reprendre ici non seulement les codes de l’expérience picturale, mais également le projet d’un triptyque – comme chez Bosch – en trois étapes. Le moment d’exposition à la découverte du monde postapocalyptique – décor martien, cailloux au sol et lumière jaune tamisée – laisse place à une deuxième partie ou les expériences s’accélèrent et se déploient pour se conclure dans un vacarme infernal accompagné de flammes projetées sur des panneaux d’affichage érigés sur scène.
Tout groupe trouve une part de son identité dans sa communication. Dans ces paysages où les affects reposent sur l’atmosphère, peu de place pour les dialogues. Ils se chevauchent, se répètent – vocalement mais également en changeant de supports. Un poème entier défile sur les panneaux lumineux. Il accompagne l’œil des spectateurs pendant un temps long, pendant que les huit protagonistes continuent leurs activités hétéroclites (danses, poses, récitations, musiques, …). Les prises de paroles ne trouvent pas d’audience sur le plateau : la polyphonie du plateau s’adresse uniquement aux spectateurs. Ces personnages renvoient l’image d’une expérience vécue très solitaire. On pourrait parfois se demander si la cacophonie n’est pas plus isolante que les silences premiers. Et lorsque l’une des figures féminines pose des questions sur des thèmes universellement sensibles (la mort, le deuil, les cauchemars, …), arrachant par leur incongruité, dans le contexte, des rires et de la sympathie, ses interrogations n’existent qu’en tant que telle et n’appellent aucune réponse.
Néanmoins, il y a des moments suspendus, où cet écosystème s’harmonise, s’entend et se répond. S’écoute et se parle, lorsque des musiques bercent la scène depuis son sein. Certains personnages au piano, d’autres à la voix, une guitare, un violoncelle,… Ces sons accompagnent parfois certains propos, parfois un court déplacement du bus, parfois le rangement de la scène pour un solennel final où les personnages sont collectivement installé-es dans le bus. Le travail musical remplit un rôle conciliateur au sein de cette communauté du bus. En outre, il expose le public à un travail collectif rassurant dans cette ambiance étrange, presque martienne. Ce trait propre à l’œuvre de Quesne rassemble l’humain autour de son aptitude à composer ensemble, alors que les paroles se perdent parfois – ou sont tout simplement ignorées.
J’ai été amené à qualifier ce groupe de « communauté du bus ». Cette troupe émerge, se retrouve, performe et s’éteint dans le véhicule. De fait, le jeu de lumière rend l’habitacle presque chaleureux malgré les teintes blanchâtres des néons. Cet effet de proximité est accentué par des dispositifs de surélévations des sièges laissant les visages très visibles et par le démontage d’un côté du bus en cours de spectacle. L’objet bouge, se transforme, accueille, permet au pianiste d’être bien assis, au présentateur de s’adresser à toute l’équipe et à un personnage d’aller sur son toit. Si les protagonistes initient leur parcours en déposant l’œuf géant au milieu et le reprennent en partant, en réalité, le spectacle débute et se termine réellement dans cet habitacle ; le bus, bien plus que l’œuf, rassemble.
Nous avons assisté à un « ovale » de parole, à la performance d’une moule géante, à de nombreuses positions rappelant des statues ou des postures du tableau de Bosch, tout en passant par le retour d’Adam et Eve et par une étape proche de l’Enfer bruyant et enflammé. Et pourtant, nous retournons dans le véhicule, en harmonie symphonique. Un laser fort lumineux, en forme de triangle, traversant la fumée, s’agrandit puis se réduit avant de disparaître dans un vrombrissant bruit de tonnerre.
Alors, cet amas d’individus forme un étrange mélange que nous observons dans un univers proche et simultanément lointain du nôtre. Cette communauté du bus s’ignore et s’écoute, se parle et s’en fiche et pourtant le temps est passé et nous avons été imprégnés par ces couleurs ambiantes. Le Jardin des Délices se conclut dans le noir et le silence après deux heures d’interactions incessantes qui ont laissé le temps et l’espace pour que se soulèvent nos interprétations ou nos questionnements propres.