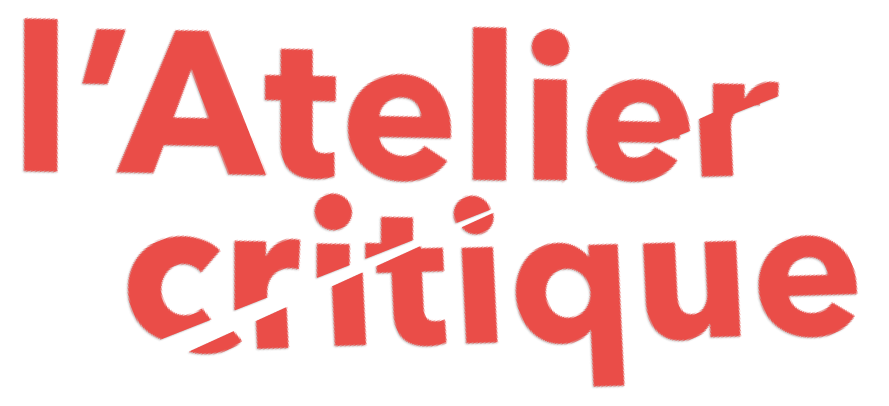Par Sylvain Grangier
Une critique sur le spectacle :
Résilience mon cul / Écriture, mise en scène et interprétation Joël Maillard / L’ Arsenic / Du 15 au 20 novembre 2022 / Plus d’infos.

Sur la scène de l’Arsenic, un micro sur pied, un synthétiseur et Joël Maillard. Ce dernier nous propose un pastiche de stand-up toujours sur le fil. Entre humour et anxiété, blague potache et sujets touchy, fragilité et clairvoyance, cynisme et feelgood, l’artiste vaudois propose un numéro d’équilibriste réussi.
Joël Maillard, c’est un clown triste – ou plus exactement, un clown inquiet – qui se présente devant nous. À travers une certaine fragilité, qu’il exploite comme vecteur d’humour, il nous transmet ses doutes sur le monde qui nous entoure. Cela transparaît dans son jeu, que ce soit par la finesse de ses ruptures, ou par ses multiples commentaires sur le spectacle lui-même. C’est ainsi que très vite il en vient à expliquer le titre : Résilience mon cul. La résilience, c’est la capacité à s’adapter, à se remettre d’un choc ou d’une catastrophe. Sauf que ce n’est pas tellement le sujet du spectacle : « Vous pouvez baisser votre horizon d’attente au niveau des pâquerettes » nous dit-il, lui qui n’a pas lu un seul quatrième de couverture de Boris Cyrulnik, qui a popularisé le concept. Son cul en revanche, il en parlera beaucoup plus. Comme lorsqu’il résume le message de l’église catholique à un pet dans son micro et qu’il commente son gag : « C’est artistiquement nul, c’est de la merde et en même temps, complète-t-il, il faut avoir l’honnêteté de dire que ça fait quelque chose. » Cette prise de distance immédiate évite de tomber dans la grossièreté gratuite, et laisse transparaître une lucidité ludique.
Ce type de commentaire est omniprésent : le spectacle s’autoréférence sans arrêt. Le comédien annonce par exemple clairement la structure du spectacle, en signalant les différentes parties de celui-ci. Mais ces commentaires méta-théâtraux vont plus loin. Ainsi, lorsqu’il nous demande si on a des questions, il complète : « Je sais que c’est très tôt dans le spectacle, mais c’est la seule fenêtre dans ma dramaturgie. » Ailleurs, il nous explique son gestus « comme on dit dans les écoles de théâtre », c’est-à-dire son geste pour exprimer « se faire du bien ». Une gestuelle qu’il utilise par ailleurs pour rendre visibles des éléments de mise en forme de son texte : il y a ainsi un geste pour exprimer l’italique, un autre pour les majuscules. On oscille ainsi en permanence entre commentaire et performance.
Cette oscillation se remarque aussi par le détournement récurrent des codes du stand-up. Joël Maillard moque ainsi par exemple le rituel « Est-ce que ça va ? » pour chauffer le public, puisqu’à la réponse positive et enjouée du public, il répond : « C’est pas vrai, c’est pas possible statistiquement [que tout le monde aille bien]. » Autre code du stand-up brocardé, l’adresse directe à un.e spectateur.ice en particulier. Ici, afin d’éviter toute « prise d’otage » pour reprendre ses mots, Joël Maillard prend le temps de faire lever la main aux personnes du public ne souhaitant pas être prises à parti. Dans le même esprit, à la fin du spectacle, une personne du public doit venir sur le plateau pour recevoir un cadeau, encore une fois sur une base purement volontaire. Ailleurs, il performe un « sketch » qui prend la forme d’un rêve qui vire au cauchemar dont il est impossible de se réveiller. Mais le sketch lui-même devient un cauchemar scénique, puisqu’il n’a pas de chute. Impossible donc de sortir du sketch : Joël Maillard tourne en rond, littéralement, autour de son pied de micro, en y enroulant petit à petit le câble. Et toujours en commentant : « Est-ce que quand il aura plus de mou il arrêtera ? Ou est-ce qu’il repartira dans l’autre sens en disant tout le contraire ? » Le tout avec un effet de distorsion sur la voix : d’ailleurs, le temps lui-même semble distordu dans cette séquence, non sans provoquer
un certain malaise, mais à tel point que cela en devient comique. C’est terriblement long, mais terriblement jouissif. Autre effet sonore : les chansons, accompagnées par un vieux synthé aux sonorités cheap et aux paroles là encore indécises et oscillantes. Par exemple, la dernière chanson, intitulée « J’encule pas », fait des allers-retours entre les sens figuré et littéral de l’acte de la sodomie dans le but de pouvoir proposer une critique du capitalisme.
En somme, le spectacle est toujours sur le fil, entre humour potache et commentaires méta-théâtraux, entre désespoir face au monde d’aujourd’hui et optimisme. Ce sont ces oscillations qui font tout le sel de cette création. Elles permettent de parler subitement des boîtes à bébé puis d’une invitation à un bonheur frugal en passant par le cynisme d’un appel écologique à l’euthanasie volontaire. Et comme c’est toujours sur le fil, l’humour aidant, ça passe tout seul. Comme un suppositoire.