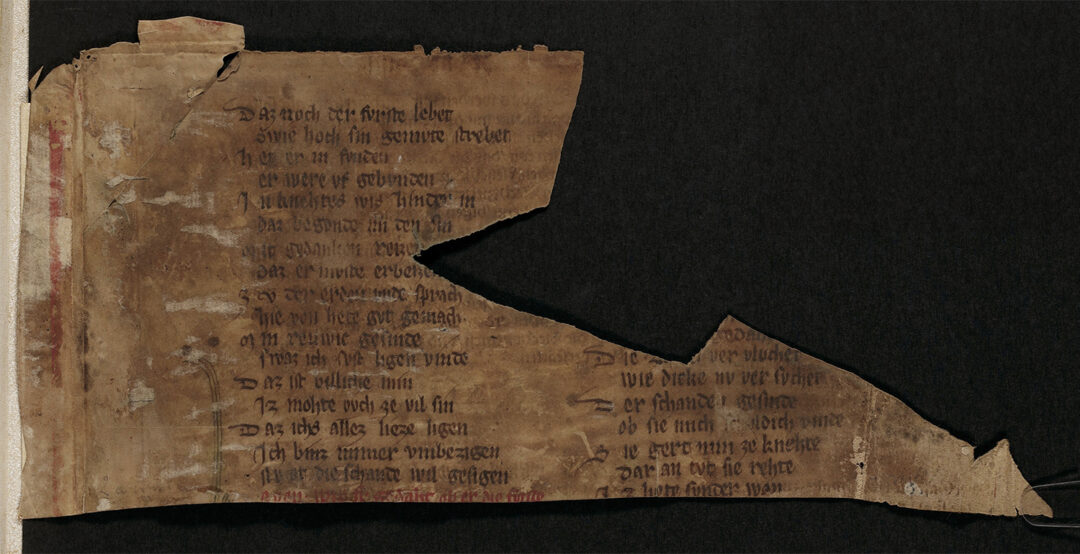Les sommets font encore et toujours rêver. Au point que le youtubeur Inoxtag a récemment sorti un film sur son périple sur le toit du monde. Mais cette quête des cimes n’est pas sans conséquences. Discussion avec deux scientifiques de l’UNIL.
De magnifiques montagnes enneigées, un pari fou, de l’entraide et une morale valorisant le dépassement de soi. Le film Kaizen d’Inoxtag a fait beaucoup parler de lui en fin d’année 2024 et a remis au centre de l’attention la conquête des cimes par les non-initiés. Au risque de l’asphyxie ? Le message du youtubeur français est pourtant clair : laisser la montagne telle qu’elle est et redescendre ses déchets.
Philippe Vonnard, chargé de cours à l’Institut des sciences du sport de la Faculté des sciences sociales et politiques de l’UNIL, étudie notamment le phénomène des déchets en lien avec les ascensions. L’occasion de préciser que cette problématique n’est pas nouvelle. En 1983, un article de L’Illustré, intitulé « La piste aux ordures », évoquait la décharge présente au camp de base de l’Everest. L’alpiniste italien Reinhold Messner, premier homme à avoir atteint les quatorze 8000 sans oxygène, y déplorait déjà cette pollution.
« Déclaration de Katmandou »
En 1982, l’Union internationale des associations d’alpinisme (UIAA), faîtière des clubs alpins, choisit le cinquantième anniversaire de sa naissance pour organiser, dans la capitale népalaise, une conférence sur le sujet. Cette réunion accouchera de la « Déclaration de Katmandou », visant à réduire l’impact des êtres humains sur la montagne et à préserver l’environnement et ses habitants.
Philippe Vonnard cherche à comprendre comment l’UIAA s’est intéressée à cette question. « Cette association a pour volonté de changer les comportements et sensibiliser ses membres. De plus, dès les années 70, il y a des campagnes « montagnes propres » menées par ses associations membres, comme le Club alpin suisse et le Club alpin italien. » Car l’alpinisme s’internationalise au cours du XXe siècle et les déchets avec. « Le Népal en est un exemple concret, relève le scientifique. Au début des années 60, on compte près de 6000 touristes par an. À la fin des années 80, 250’000. »
Selon le chercheur, plusieurs raisons expliquent la réaction de l’UIAA. « En parallèle à un changement d’attitude vis-à-vis de la présence humaine en montagne, ces années sont marquées par un développement du tourisme dans ces régions. De plus, on se trouve dans une période de transformation des équipements avec du matériel dont les composants sont plus problématiques quant à leur dégradation, en premier lieu le plastique. Et il ne faut pas penser que les choses se remplacent. Au contraire, les historiens et historiennes qui travaillent sur l’environnement ont montré qu’elles s’accumulent. S’il y avait remplacement, on pourrait peut-être limiter le problème. »
Impact environnemental

En dehors de ses recherches sur l’Union internationale des associations d’alpinisme, Philippe Vonnard, également membre actif du Centre interdisciplinaire de recherche sur la montagne (CIRM) de l’UNIL, s’intéresse au cas de la Summit Foundation, entité suisse qui sensibilise à la pollution en montagne et aux bonnes pratiques à adopter, tout en organisant des campagnes de ramassage, notamment dans les stations. « J’aimerais retracer l’histoire de la relation loisirs-déchets dans les régions de montagne en Suisse et, par ce biais, comprendre quelles sont les étapes, mais aussi les enjeux, qui mènent à la création de cette entité en 2001. »
Et le chercheur de rappeler : « Depuis la fin du XIXe siècle, avec un renforcement après la Deuxième Guerre mondiale, l’espace montagnard est devenu un terrain de jeu et la Confédération helvétique est à la pointe dans ce domaine. Un chiffre pour illustrer ce phénomène : à la veille des années 50, il y avait une quarantaine de ski-lifts en Suisse. Dans les années 90, on est autour de 5000. Et, selon les chiffres donnés par le Dictionnaire historique de la Suisse, la station de Verbier passe de quelque 5000 nuitées au début des années 50 à 300’000 en 2010. »
Philippe Vonnard élargit même le champ de la réflexion. « Si on est vraiment honnête, l’impact environnemental de toutes les pratiques sportives est incroyable et on serait sans doute surpris du résultat. Hormis quelques travaux sur les grands événements sportifs, peu d’études sont conduites sur le sujet. De fait, outre une certaine forme d’hypocrisie, voire de cynisme, il faut dire que nous ne sommes probablement pas conscients de tous les problèmes écologiques relatifs à ces activités. »

Tourisme de masse dans les massifs
Depuis la « Déclaration de Katmandou », rien de bien nouveau à l’ombre de l’Himalaya. Les déchets s’accumulent toujours et l’actualité en fait sporadiquement l’amer constat. Pour preuve ? Des morceaux de tentes épars, des sachets de repas lyophilisés délaissés, de vieilles bouteilles de gaz abandonnées, tel est le constat d’Inoxtag en arrivant au camp IV de l’Everest.
« Des campagnes de nettoyage sont pourtant organisées chaque année par les populations locales au début de la saison », constate Philippe Vonnard. En juin 2024, le responsable de cette collecte, major de l’armée népalaise, confiait d’ailleurs à l’AFP avoir ramené 11 tonnes de déchets. Mais, selon certaines estimations, pas moins de dix tonnes y sont abandonnées tous les ans. Il faut dire que dans ces environnements pour le moins hostiles à l’être humain ces expéditions sont difficiles à mener, sans compter le coût financier qu’elles comportent.
Décision de justice
Pour Philippe Vonnard, les choses ne vont pas en s’améliorant. « On est toujours dans cette tension entre développement économique et protection de l’environnement. La nature est surinvestie. Les loisirs s’inscrivent dans cette idée de croissance avec une démocratisation de la montagne. On pense que le tourisme va permettre d’améliorer le niveau de vie des populations locales. »
Et le scientifique de convoquer le film Les Bronzés font du ski, datant de 1979. « Bien qu’étant une représentation un peu surfaite de la réalité, c’est tout de même un bon révélateur de ces pratiques. Ce sont des citadins, issus de la classe moyenne en plein essor, se rendant sur les pistes lors d’un séjour dans une station d’hiver. Ils font de l’héliski et balancent leurs canettes, sans respect de la nature, se disant que, quand elles ressortiront de terre, ils ne seront plus là pour les voir. Et quand ils sont perdus, ils se délestent de leur matériel. »
Pourtant, les choses évoluent peu à peu. En avril 2024, la Cour suprême du Népal a ordonné au Gouvernement de réfléchir à la gestion des déchets et de réduire le nombre de permis octroyés pour l’ascension de ses sommets, sans toutefois fixer de quotas. En 2023, 478 permis avaient été délivrés pour la seule ascension de l’Everest. Cette décision de justice intervient 42 ans après la « Déclaration de Katmandou ». La marque d’une lente ascension vers la régulation.
Infrastructures surdimensionnées
Les Alpes n’échappent pas au tourisme. En Suisse, la question des résidences secondaires a été remise sur le tapis en 2012 avec la Lex Weber. Assistante-doctorante à l’Institut de géographie et durabilité de l’UNIL, Géraldine Overney a débuté sa thèse en septembre 2021. Elle s’intéresse au rôle des propriétaires de résidences secondaires dans la gouvernance des stations de montagne. En 2022, dans le cadre d’un mandat de l’État du Valais, elle a également travaillé avec Leïla Kebir et Christophe Clivaz, chercheuse et chercheur à l’UNIL, sur l’évolution des pratiques des résidents secondaires durant le Covid.
« Au moment de leur construction, les infrastructures concernant l’eau, les routes ou la gestion des déchets dans les stations ont été surdimensionnées pour les périodes de pic saisonnier. Il peut même y avoir parfois des difficultés d’élimination des eaux usées, quand la station est pleine. Cela représente des infrastructures considérables pour quelques semaines par an. »
Actuellement, un des enjeux est d’augmenter la part de lits chauds dans les stations helvétiques. Pourtant, Géraldine Overney a constaté que « dans le district d’Entremont 72% des propriétaires de résidence secondaire interrogés n’ont jamais mis leur bien en location ». Pourquoi ? « Les propriétaires aiment être flexibles, pouvoir venir au dernier moment, selon la météo. Certains n’ont pas non plus le besoin financier de louer. Comme la moyenne d’âge des personnes interrogées est de 63 ans, il est toutefois possible qu’au moment du changement de génération les pratiques évoluent. »
En outre, les résidents secondaires ne s’identifient pas aux touristes de passage. « Ils souhaitent être traités différemment. Certains aimeraient même s’investir davantage dans la commune. Il y a un manque dans la littérature sur la question des résidents secondaires et de leur implication », souligne Géraldine Overney.