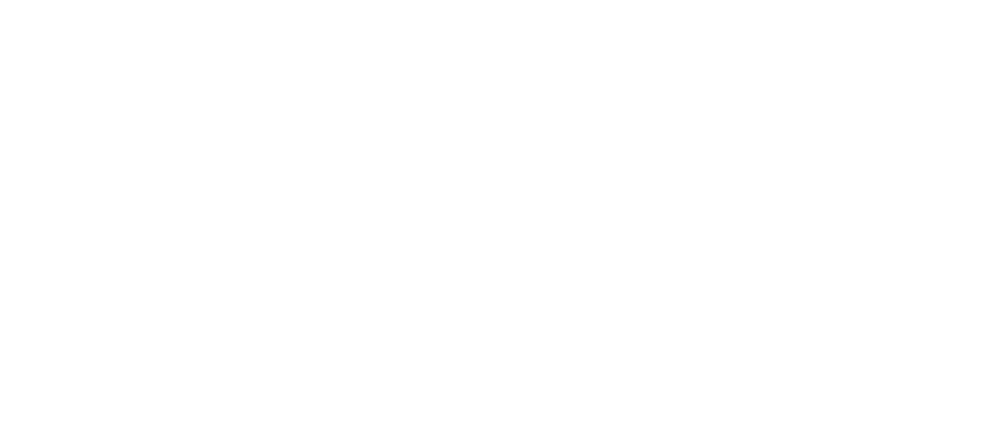Ce site est conçu comme une ressource évolutive mise à disposition des enseignant·e·s, des formateur·rice·s et des apprenant·e·s qui souhaitent disposer d’un appareillage critique renouvelé et efficace pour décrire et interpréter les récits. L’enseignement ciblé est celui du français, langue maternelle ou langue de scolarisation, principalement au niveau du secondaire.
L’onglet Résultats de recherches présente les résultats d’une enquête de terrain, menée en Suisse, en France, en Belgique et au Québec entre 2022 et 2024. Ce travail vise à documenter les pratiques enseignantes relatives aux théories du récit pour le niveau secondaire.
Le nuage de mots-clés ci-dessous conduit à un ou plusieurs articles, dans lesquels ces concepts sont discutés.
analepse allusive (2) analepse dramatisée (1) commentaire (1) curiosité (6) description (1) dialogue (1) focalisation (6) focalisation multiple (1) focalisation variable (1) intrigue (3) introspection (1) mise en intrigue (1) narrateur (1) narration (1) omniscience (5) ordre (1) perspective narrative (1) point de global (1) point de vue (1) point de vue externe (5) point de vue global (4) point de vue interne (6) point de vue local (6) savoir restreint (4) savoir élargi (3) scène (2) segmentation (1) subjectivité (1) suspense (6) séquence (1) séquences textuelles (1) virtualités (1)