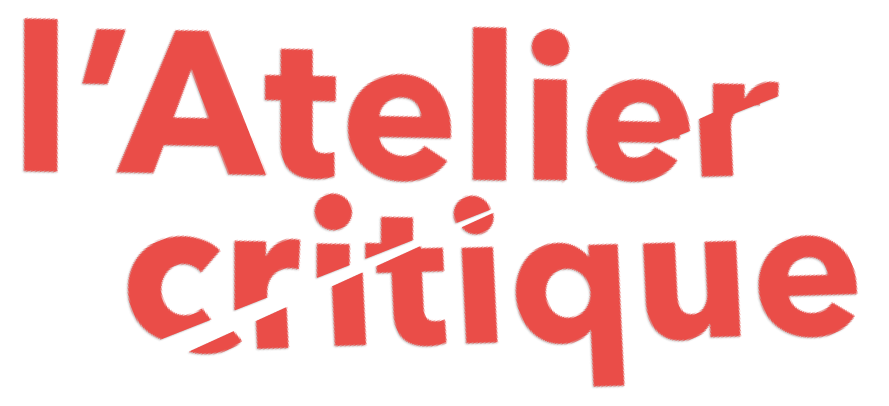Par Simon Falquet
Répétition / de Pascal Rambert / mise en scène Pascal Rambert / Théâtre de Vidy / du 6 au 9 octobre 2015 / plus d’infos

Le spectateur est souvent quelque chose de très simple. Depuis sa place, il suit des yeux le jeu des acteurs et n’a qu’une seule véritable exigence. Il faut qu’il puisse rentrer chez lui avec sa phrase ou son mot, un petit bout capté dans l’instant précis qu’il aura reconnu comme le coeur du propos. Il n’y a pas de place déterminée, ce cœur peut battre à l’ouverture, comme l’annonce d’un thème, ou dans un centre de symétrie au milieu du spectacle, ou bien souvent à la fin, en point culminant d’une longue ascension. Il y a un million de façons d’y venir. Le spectateur attend sur son siège, sa cane à pêche calée sous le bras, que dans le grand flux des paroles quelque chose morde. Dès qu’il y a résistance, il remonte la ligne et c’est un beau poisson qu’il peut ramener chez lui pour le souper.
Répétition de Pascal Rambert est un cauchemar pour les pêcheurs à la ligne. S’il s’agit de comprendre l’histoire, c’est en fin de compte très simple. Stan (Stanislas Nordey) le metteur en scène, Denis (Podalydès) l’écrivain, Audrey (Bonnet) et Emmanuelle (Béart) les comédiennes, formaient ensemble une structure harmonieuse et fertile. En couchant avec Denis, Emmanuelle rompt l’harmonie et lance les hostilités. Le spectacle commence avec la voix d’Audrey, le cri larmoyant qui accuse autour de lui. C’est un long monologue. Il y en aura quatre au total, chacun dira son texte à tour de rôle. Les discours mettent en tension quatre regards sur la vie qui ne se ressemblent pas. Le spectateur peut encore pêcher quelques leitmotivs : la passion chez Audrey, la vie intérieure chez Emmanuelle, l’abysse chez Denis, la fiction chez Stan.
L’histoire nous prend, à mesure que se répondent les personnages. Une histoire très simple. Mais l’histoire n’est qu’une eau courante. Ce que pêche le spectateur, c’est le poisson qui court à l’intérieur. Vous savez de quoi je parle. Cette réplique que tout préparait, qui justifie tout le reste, qui fasse enfin rugir le sens.
On sent qu’on touche à du sens. Tout est fait pour. Il y a du poids sur les mots, des lenteurs, des répétitions, des « toujours », des « tout », des « tous ». On se sent au centre, et on se sent appelés. Mais plus le temps passe, plus les points cruciaux se répètent. On se perd à collecter des vertiges, comme le requin se perd au milieu d’un banc de poissons. C’est ce qui rend difficile toute tentative de discours sur le sens du spectacle. Il n’y a pas une direction donnée, ce sont des forces opposées qui se compensent dans un équilibre fascinant. Ce résultat n’est pas le fait du texte seul. Il repose sur un miracle d’interprétation. En l’occurrence, les acteurs ne sont pas seulement doués, ils s’accordent aussi à merveille, chacun capable d’investir un territoire propre et d’y mener un jeu exigeant sans jamais piétiner les autres.
La rupture du groupe n’aura pas de suite. La suite, ils en parlent, mais rien ne sera résolu. Comme dans Clôture de l’amour, Pascal Rambert fait entendre le moment de la fracture. Il l’observe et l’interroge. Ce qu’il montre de la fracture, c’est à quel point elle est inévitable, nécessaire, et puis belle, spectaculaire. Les personnages ne luttent pas contre une mécanique universelle qui les dépasse, plutôt ils s’annulent entre eux, entrechoquent leurs systèmes de pensée. Il s’agit non pas de fuir ou de vaincre, mais de souffrir ses mots à fond, de les faire grandir et de les laisser envahir l’espace.
Un fond sonore diffus baigne les paroles dans une atmosphère envoûtante, brassée par le mouvement des néons larges au plafond. Les acteurs évoluent dans une salle de gymnastique orange et bleue. Ceux qui ne sont pas en train de parler se meuvent en silence et lentement. Ce sont des poses étranges. Accroupis, couchés, adossés au mur, s’habillant, se déshabillant. Ils semblent essayer des combinaisons. Leur visage est lisse et leur regard est loin ailleurs. Ils sont photogéniques. Chaque tableau qu’ils forment pourrait figurer sur le flyer du spectacle. Il n’y a qu’un échange très vague avec celui qui poursuit son monologue.
Le monologue est-il réel ? Il est peut-être pensé, peut-être rêvé. Peut-être imaginaire : une manifestation des différentes virtualités, leur réalisation sur la scène. Quelle place donner aux personnages silencieux ? Ils semblent piégés dans un monde de souvenirs. Mais ce monde est encore très dépouillé, les corps trop détourés. On pourrait dire de ces images qu’elles appartiennent à l’imaginaire du locuteur, ou peut-être de l’ensemble du groupe. Des projections sensibles, des possibles créés à partir de souvenir découpés, des restes de sensations. Mais les tableaux pourraient aussi venir de l’extérieur, du metteur en scène : faire voir ses personnages hors de leurs discours, les faire nous regarder, nous poser la question. Une construction artistique à partir d’impressions sur les personnages. L’espace trouble ouvre la parole prononcée sur un plan plus large, il porte l’écho vers une portée universelle. Les visages muets nous montrent ce que nous sommes. C’est dans leurs doutes, leur faiblesse, qu’ils sont photogéniques.
Aller plus loin serait s’étendre sur un sens à donner au mouvement d’ensemble du spectacle. Le poisson ne se laisse pas saisir. Les dernières paroles sont de Stan. Elles sortent plus que jamais de l’histoire et se confondent avec celles du metteur en scène. Il donne des pistes, sur le théâtre occidental, sur l’homme de maintenant, sur l’avenir. Puis les efface une par une, d’un coup de nageoire. Il tombe au sol, dernier à s’effondrer, et les ombres s’allongent. Dans la pénombre, une belle gymnaste vient tourner entre les corps tombés en jouant du ruban. L’image est simple, sourde, épiphanique. Le pêcheur tient peut-être là son poisson. Il tire sur la ligne et peut-être qu’il en fera une soupe.