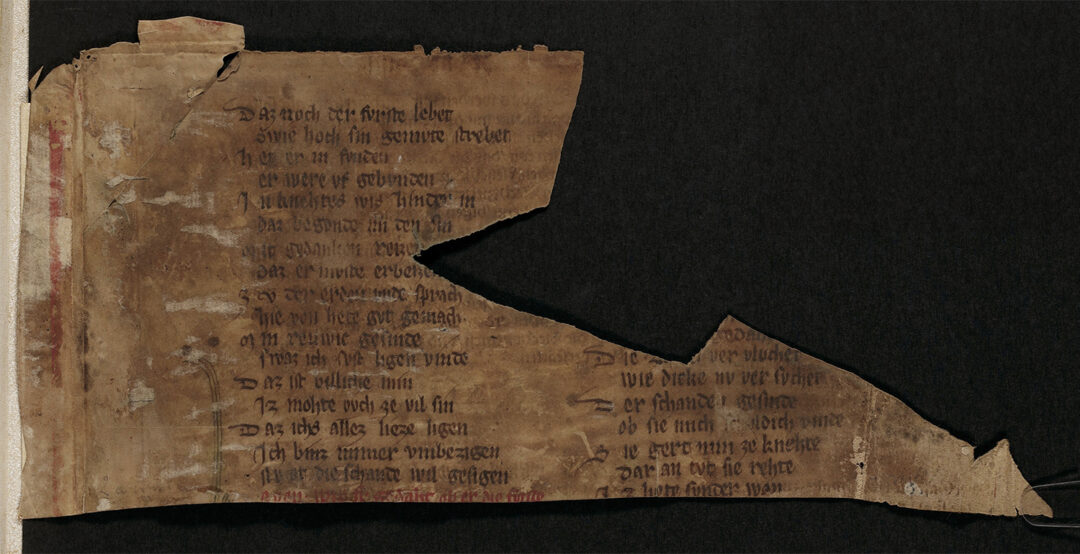Deux jours pour réfléchir à l’acte de création dans divers domaines, au-delà des peurs et de la lassitude engendrées par l’état d’urgence environnemental.
Avec Nathalie Dietschy (professeure assistante en section d’histoire de l’art) et Marco Costantini (directeur du mudac), la réflexion s’adosse à la création. Ils coorganisent (jeudi 23 mai à l’auditoire mudac-Photo Élysée et vendredi 24 à l’UNIL-Synathlon) un colloque international interdisciplinaire pour envisager différents gestes artistiques (pratiques et engagements) pour aller « Au-delà des douleurs de la Terre », qui donnent « matières à penser ».
La visioconférence inaugurale, très attendue, permettra d’écouter le philosophe australien Glenn Albrecht, auteur en 2020 du livre Les émotions de la Terre, où il introduit le concept de « solastalgie », une forme de nostalgie ressentie alors même que l’on vit chez soi. « Il évoque une absence de consolation face à la surexploitation de la nature, à la sécheresse persistante et autres conséquences du réchauffement climatique », souligne Nathalie Dietschy.
Des « solastalgies » créatrices ?
En différents points du globe, des personnes éprouvent ce sentiment de désolation, parfois nommé « écoanxiété », et Sarah Koller (qui enseigne l’écopsychologie à l’UNIL) parlera de la primordiale reconnexion de l’humain à son environnement. Avec Katharina Niemeyer (Université du Québec), on quittera le « mal du pays » pour envisager des « solastalgies créatrices ». Tandis que Julie Sermon (Lyon 2 et Manufacture) abordera la question des émotions et des modes d’action sous l’angle des arts vivants.
Un engagement photographique
« Notre colloque veut dégager des pistes interdisciplinaires pour penser ensemble ces changements, les accompagner, les révéler, les freiner, s’y adapter et surmonter l’inaction par les différents moyens de la création, la photographie, le théâtre, le design, le cinéma ou encore la littérature », relève Nathalie Dietschy, qui présentera elle-même des travaux photographiques suscités par la disparition toujours plus visible des glaciers alpins. À l’autre bout de la Terre, des artistes photographes documentent la déforestation amazonienne, et Danièle Méaux (Université Jean Monnet, Saint-Étienne) décrira leur engagement.
Designer pour un monde vivant
Avec Nicolas Roesch (fondateur de Zoépolis, laboratoire de recherche en design), on découvrira comment centrer le design sur le vivant. Marie-Ange Brayer (Centre Pompidou) réveillera l’animisme et le design vivant pour évoquer une nouvelle « coexistence à l’ère postanthropocène ». Citons encore une plongée aux vertus politiques dans la science-fiction contemporaine avec Colin Pahlisch (Faculté des lettres) et une exploration cinématographique guidée par Teresa Castro (Paris 3) autour de quelques films, dont Le Monde du silence (Cousteau et Malle, 1956) ou The Plow That Broke the Plains (Pare Lorentz, 1936), étrange objet documentaire sur la bataille (trop…) mécanisée du blé dans les grandes plaines de l’Ouest américain, touchées par une impitoyable sécheresse qui fit fuir nombre de fermiers confrontés à ces conditions extrêmes…
D’une saisissante actualité, la thématique gagne donc à être vue aussi avec un certain recul. À noter qu’un atelier doctoral CUSO prolongera ce colloque en interrogeant les relations de l’artiste et du scientifique avec des objets d’emblée politiques.