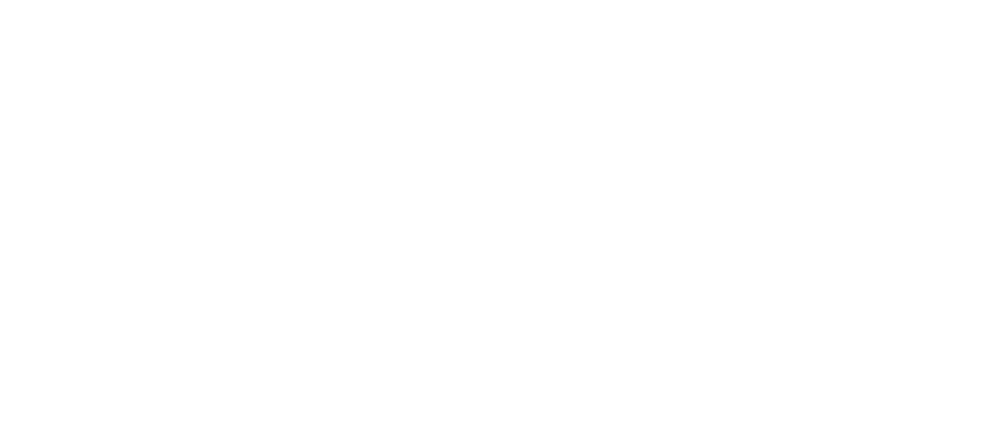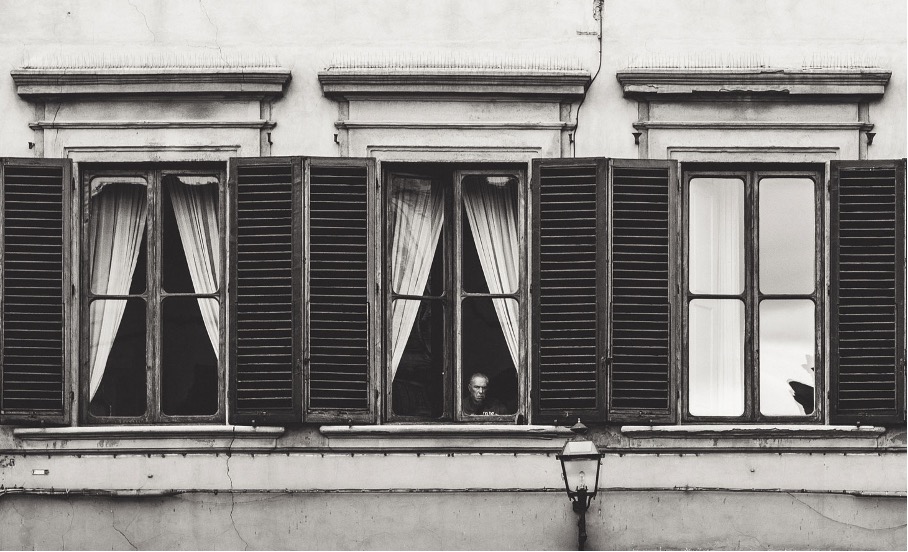- De quoi s’agit-il ? — Le récit verbal n’est pas composé uniquement de passages racontant des actions, mais aussi de descriptions, qui permettent de construire la scène sur laquelle se déroule l’action, et de dialogues, qui dramatisent les événements en donnant directement la parole au personnages, comme s’ils s’exprimaient sur cette scène imaginaire. Enfin, on rencontre parfois des sortes de digressions par lesquelles le narrateur ou l’auteur commente les événements et, parfois, en élargit la portée en soulignant le caractère exemplaire de ce qui est raconté.
- Intérêt pour l’élève — Il est important d’arriver à combiner description, narration et dialogue pour arriver à se représenter la scène imaginaire que raconte de récit, mais il faut aussi prêter attention aux commentaires intégrés dans ce récit, qui orientent notre jugement sur ce qui est raconté. Si on veut soi-même être capable de construire des histoires, il faut aussi maitriser les spécificités langagières et les combinaisons efficaces de ces quatre séquences textuelles fondamentales.
- Intérêt pour l’enseignant·e — La distinction des différents types de séquences textuelles qui composent la matière narrative permet de mettre l’accent sur la spécificité linguistique du récit verbal et sur la fonction respective des différents passages qui le composent (narrations, descriptions, dialogues, digressions ou commentaires). Outre ces quatre séquences, qui mettent en évidence l’hétérogénéité compositionnelle du récit verbal, une attention portée sur les digressions auctoriales, où domine souvent le présent de vérité générale, permet d’attirer l’attention sur l’exemplarité de l’histoire. Ainsi, le récit déborde du cadre de la fiction pour impliquer auteurs et lecteurs.
On peut décomposer les récits littéraires en quatre types de séquences:
- Les passages narratifs, ou narrations, racontent les actions accomplies par les personnages ;
- Les passages descriptifs, ou descriptions, donnent des informations sur les lieux, les personnages et le monde dans lequel ils évoluent ;
- Les passages dialogués, ou dialogues, présentent, en style direct, les paroles échangées entre les personnages ;
- Les passages digressifs, digressions ou commentaires, consistent en des réflexions énoncées par le narrateur, qui peuvent prendre la forme de jugements, d’explications, de remarques. Parfois, le narrateur peut complètement dévier de son histoire pour parler de quelque chose qui n’a rien à voir.
Pour faciliter le repérage de ces différentes séquences, il faut distinguer clairement le récit, au sens général du terme, des passages proprement narratifs au sein de ce récit. En effet, la plupart des récits se composent également de descriptions, de dialogues et de digressions. Le repérage des différents prototypes textuels est fondé sur des indices plus ou moins faciles à repérer.
Parfois, ces quatre types de séquence sont clairement distincts, et même souvent séparés graphiquement par le découpage du texte en paragraphes. Parfois au contraire, ils sont plus mélangés ou ils alternent rapidement dans le même paragraphe, de phrase en phrase, voire au sein de la même phrase.
Ainsi que l’explique Jean-Michel Adam (1984) les séquences peuvent aussi, occasionnellement, s’enchâsser les unes dans les autres. C’est surtout le cas pour le dialogue, qui peut servir de cadre enchâssant pour un récit, avec ses propres passages narratifs, descriptifs, dialogués ou commentés.
Dans les récits où une perspective interne domine, les différentes séquences ont tendance à se fondre dans la conscience du personnage, ce qui tend à les rendre moins facilement discernables. La narration peut simplement suivre le fil des pensées, comme une série d’événements mentaux, et les descriptions filtrée par les sens du personnages peuvent se mêler à des pensées et des commentaires. La description est souvent motivée (par exemple chez Zola) par son inscription dans l’acte de perception d’un personnage, ce qui produit un effet de légère narrativisation, puisque le temps continue à s’écouler, mais la fonction descriptive reste généralement clairement dominante.
Narration
Les passages narratifs se remarquent généralement à la présence de verbes d’action placés au premier plan du récit (c’est-à-dire exprimés généralement au passé simple ou au passé composé, éventuellement au présent narratif ou « historique »), souvent accompagnés d’adverbes temporels marquant la saillance (soudain, soudainement, tout à coup, etc.) ou l’enchaînement chronologique et causal (ensuite, alors, etc.). Sur un plan thématique, la narration renvoie à une succession d’événements inscrits dans une temporalité linéaire et rattachés au développement de l’histoire principale.
Exemples:
Alors la petite marquise se leva, tira les verrous, tourna la serrure, souleva la portière et montra sa tête.
Maupassant, Le Signe
Et il me pousse; il referme la porte, et comme je demeurais, épouvantée, en face de lui, il m’embrasse.
Maupassant, Le Signe
Description
Les passages descriptifs, généralement dominés par l’imparfait (parfois le présent), permettent de construire une représentation des éléments statiques du monde raconté (lieux, espaces) et des personnages. Il faut ajouter que la description peut aussi renvoyer à des éléments dynamiques, mais répétitifs ou routiniers, qui fonctionnent comme un cadre pour les événements singuliers racontés par les passages narratifs. Ainsi que l’explique Jean-Michel Adam:
Les récits ne peuvent se passer d’un minimum de description des acteurs, des objets, du monde, du cadre de l’action. Les données descriptives, qu’il s’agisse de simples indices ou fragments descriptifs plus longs, semblent avoir pour fonction essentielle d’assurer le fonctionnement référentiel du récit et de lui donner le poids d’une réalité. Paradoxalement, le récit ne peut se passer de la description qui ralentit toujours le cours des actions (même si, au cours de ces pauses, le récit est souvent en train de s’organiser).
Adam, 1984 : 46-47
Exemples:
C’était une vieille couturière qui venait une fois par semaine, tous les mardis, raccommoder le linge chez mes parents. Mes parents habitaient une de ces demeures de campagne appelées châteaux, et qui sont simplement d’antiques maisons à toit aigu, dont dépendent quatre ou cinq fermes groupées autour.
Maupassant, Clochette
Tu connais bien mon appartement, Tu sais que mon petit salon, celui où je me tiens toujours, donne sur la rue Saint-Lazare, au premier: et que j’ai la manie de me mettre à la fenêtre pour regarder passer les gens.
Maupassant, Le Signe
Dialogues
Les dialogues dans un récit reproduisent les paroles échangées entre les personnages. Dans certains cas, le même dispositif formel permet de reproduire les paroles intérieures, c’est-à-dire les pensées des personnages. Dans un roman classique, la présence de dialogues est souvent marquée visuellement par un changement de paragraphe et/ou par des indications typographiques explicites : en français, ce sont souvent les guillemets (« … ») ou les tirets cadratins (—). Sur un plan linguistique, on peut aussi remarquer la présence de l’appareil formel de l’énonciation, dont l’ancrage déictique est situé dans le plan du monde raconté. Les dialogues incluent parfois l’imitation d’effets d’oralité, en jouant notamment sur l’expressivité du discours (interjections, phrases nominales, dislocations, clivées, etc.).
Exemples:
« Qu’est-ce que vous faites là-haut, Sigisbert? »
Maupassant, Clochette
Sentant qu’il serait pris, le jeune instituteur, affolé, répondit stupidement:
« J’étais monté me reposer un peu sur les bottes, monsieur Grabu. »
Elle grogna: « Qu’est-ce que vous demandez? »
Maupassant, Le Marquis de Fumerol
— Vous êtes madame Mélanie?
— Oui.
— Je suis le Comte de Tourneville.
— Ah bon! Entrez.
On peut enfin rattacher à ce prototype différentes indications, précédant ou suivant les énoncés des personnages, qui permettent de définir l’identité des locuteurs, l’alternance des tours de parole ou la forme des discours, avec certains traits syntaxiques spécifiques, comme l’inversion du sujet quand l’indication est incluse dans le dialogue (p.ex. « s’exclama-t-elle » ou « murmura-t-il »). Bien que se fondant partiellement dans la narration, on peut aussi rattacher à cette catégorie les discours indirects et indirects libre, ce dernier exprimant souvent les pensées des personnages en conservant certains traits de l’oralité (les tournures expressives en particulier). Le discours narrativisé est, quant à lui, comme son nom l’indique, complètement intégré dans les séquences narratives.
Exemple:
Nous ne nous étions vraiment rencontrés que plus tard, à la fermeture de la boutique. Je l’avais abordée. Je m’étais dit que je n’avais pas le choix. Je me permets de vous adresser la parole, lui avais-je dit en la rattrapant sur le trottoir, car je n’ai pas le choix.
Christian Oster, Mon grand appartement
Digression / Commentaire
La digression (ou commentaire) est liée à la parole du narrateur, souvent identifiable comme portant les opinions de l’auteur. Ele peut prendre les formes les plus diverses. Elle peut servir de commentaire à ce qui est raconté, de manière à en expliciter les enjeux ou à en généraliser la portée, comme elle peut se dégager de manière plus forte des enjeux de la représentation narrative, manifestant la liberté du narrateur ou de l’auteur de s’éloigner de son récit.
Elle se distingue surtout, de manière négative, par sa référence à des contenus qui sortent du cadre de la fiction, même s’ils s’y rattachent la plupart du temps par des liens explicatifs, analogiques ou fondés sur une généralisation du cas particulier que constitue l’histoire racontée. Lorsque nous lisons, dans Anna Karénine, « toutes les familles heureuses le sont de la même manière, les familles malheureuses le sont chacune à leur façon », Tolstoï introduit un commentaire qui nous permet de généraliser la portée des événements auxquels se réfèrent les passages narratifs, descriptifs et dialogiques de son roman. La forme est souvent proche de l’aphorisme, avec un usage fréquent du présent à valeur intemporelle (présent gnomique) et des articles définis à valeur générique, comme dans « L’homme est un loup pour l’homme ».
Il est fréquent, comme dans les exemples ci-dessous, de voir les digressions directement associées à des passages narratifs, qu’elles commentent.
Exemples:
Mme de Grangerie se mit à pleurer, versant ces jolies larmes claires qui rendent plus charmantes les femmes…
Maupassant, Le Signe
Et, prenant la main de son amie, elle la posa sur sa poitrine, sur cette ronde et ferme enveloppe du cœur des femmes, qui suffit souvent aux hommes et les empêche de rien chercher dessous.
Maupassant, Le Signe
Le marais, c’est un monde entier sur la terre, monde différent, qui a sa vie propre, ses habitants sédentaires, et ses voyageurs de passage, ses voix, ses bruits et son mystère surtout. Rien n’est plus troublant, plus inquiétant, plus effrayant, parfois, qu’un marécage.
Maupassant, Amour
Effets de l’introspection dans les séquences textuelles
Les passages dans lesquels la représentation de la subjectivité des personnages domine (cf. point de vue) peuvent s’inscrire dans différents types de séquences, tout en rendant leur repérage plus difficile. La représentation subjective peut prendre la forme d’une narration d’événements mentaux (un enchaînement de pensées), de commentaires ou de digressions émanant d’un personnage (et pas du narrateur, ni de l’auteur) ou c’est la description qui passe souvent par le filtre des perceptions d’un personnage. Dans les cas les plus saillants, la représentation de la pensée du personnage peut se matérialiser de manière très semblable à une parole qui serait échangée dans un dialogue. En cas de représentation directe d’un monologue intérieur, on retrouve toutes les traces formelles utilisés pour reproduire les dialogues: tournure orales, usage de guillemets. Cependant les verbes introducteur passent du registre de la parole (dit-il, affirma-t-elle) à celui de la pensée (pensa-t-elle, se dit-il). On trouve aussi des pensées reproduites sous forme indirecte (il se dit qu’il était heureux) ou indirect libre (comme elle était heureuse).
Exemple de pensées sous forme de séquence narrative:
Un instant il mesura ce qu’il aurait voulu faire et être – il avait recommencé à manger sans rien dire – et il le compara à cet homme qu’il avait vu la nuit précédente.
Alice Rivaz, L’homme et son enfant
Exemple de perception subjective dans une séquence descriptive suivie d’une digression:
Tout à coup, je remarque que, de l’autre côté, il y a aussi une femme à la fenêtre, une femme en rouge; moi j’étais en mauve, tu sais, ma jolie toilette mauve.
Maupassant, Le Signe
Exemple de pensée reproduite d’abord comme un commentaire, puis comme un monologue intérieur:
D’ailleurs, cette fois-là, cette peur qu’il avait de rencontrer sa créancière le frappa lui-même une fois dans la rue.
Dostoïevski, Crime et châtiment
« À quelle grande chose je vise, et de quelle bêtise j’ai peur ! » pensa-t-il avec un sourire étrange.
Pour entrer dans les débats
Le modèle le plus connu définissant les séquences textuelles à un niveau intermédiaire entre la phrase et le texte pris dans sa globalité est l’approche développée par Jean-Michel Adam dans le domaine de la linguistique textuelle :
La séquence est une structure relationnelle préformatée qui se surajoute aux unités syntaxiques étroites (phrases) et larges (périodes), c’est un « schéma de texte » située entre la structuration phrastique et périodique microtextuelle des propositions et celle, macrotextuelle, des plans de texte. Les séquences sont des structures préformatées de regroupement typés et ordonnés de paquets de propositions. Le rôle de la linguistique textuelle est d’explorer et de théoriser ce niveau intermédiaire (mésotextuel) de structuration, sans négliger le jeu complexe des contraintes intraphrastiques, interphrastiques et transphrastiques, discursives et génériques.
(Adam 2017 : 25)
Par rapport à ce modèle, la typologie proposée se distingue sur trois points, explicités dans Baroni (2020). Le premier point consiste dans la définition étroite de la séquence dite « narrative ». Cette dernière, quand elle est une séquence de niveau « mésotextuel » au sein d’un récit, ne se réalise pas sous la forme d’un schéma quinaire, lequel ne peut se réaliser qu’à l’échelle supérieure de la planification discursive. On l’identifie plutôt par l’usage de certains tiroirs verbaux (notamment le passé simple dans un roman « classique »), d’organisateur temporels et logiques (marquage de la consécution et de la causalité) et de procès renvoyant à une suite d’actions singularisées.
L’autre point consiste à associer les intrusions auctoriales ou narratoriales au paradigme de la digression, suivant en cela une tradition critique bien implantée dans le champ des études littéraires (cf. Sabry 1992 ; Montalbetti & Piégay-Gros 1994 ; Bayard 1996 ; Dawson 2016). L’existence de ces travaux justifie, dans ce contexte, l’usage de ce terme à la place des prototypes de l’explication et de l’argumentation, dont la différenciation n’est pas toujours aisée ou pertinente dans le contexte du récit littéraire.
Le troisième point consiste à montrer que les possibilités d’enchâssement d’une séquence dans une autre ne sont pas semblables suivant les séquences envisagées. Une narration, une description ou un dialogue peuvent évidemment se fondre dans la prise de parole d’un personnage (ce qui correspond fondamentalement au procédé de l’enchâssement narratif), mais l’intégration dans les autres types de séquence ne sont pas sans effet sur la forme des éléments enchâssés. Par exemple un passage narratif peut éventuellement intégrer un échange de paroles entre des personnages, sans jouer sur une alternance avec une séquence de dialogue, mais alors, cette référence se transforme en discours narrativisé. Quant à la description, elle peut être plus ou moins dynamique, notamment quand elle est enchâssée dans l’acte perceptif d’un personnage, mais elle ne peut pas, en elle-même, intégrer un dialogue ou une action, sauf à les transformer également en éléments décoratifs intégrés au cadre de l’action. Autrement dit, chaque prototype séquentiel induit une certaine forme linguistique, à l’exception du dialogue, qui se remarque d’abord par des marques d’entrée et de sortie dans le discours direct d’un personnage, lequel peut ensuite utiliser la langue à sa guise en effaçant plus ou moins le contexte énonciatif dans lequel il s’exprime.
Références
Adam, Jean-Michel (2017). La Linguistique textuelle. Introduction à l’analyse textuelle des discours, Paris, Armand Colin.
Baroni, Raphaël (2023) « Des virtualités du monde de l’histoire à la mise en intrigue : une alternative au schéma narratif », Pratiques, n° 197-198.
Baroni, Raphaël (2020) « La séquence ? Quelle séquence ? Retour sur les usages littéraires de la linguistique textuelle », Poétique, n° 188, p. 259-278. DOI : https://doi.org/10.3917/poeti.188.0259
Bayard, Pierre (1996), Le Hors-Sujet. Proust et la digression, Paris, Minuit.
Dawson, Paul (2016), « From Digressions to Intrusions: Authorial Commentary in the Novel », Studies in the Novel, n° 48 (2), p. 145-167.
Montalbetti Christine & Nathalie Piégay-Gros (1994), La Digression dans le récit, Paris, Bertrand-Lacoste.
Rabatel, Alain (2008), Homo Narrans, Limoges, Editions Lambert-Lucas.
Sabry, Randa (1992), Stratégies discursives : digression, transition, suspens, Paris, EHESS.
Fiche de synthèse
Téléchargez ici la fiche de synthèse (secondaire 2, lycée, gymnase).