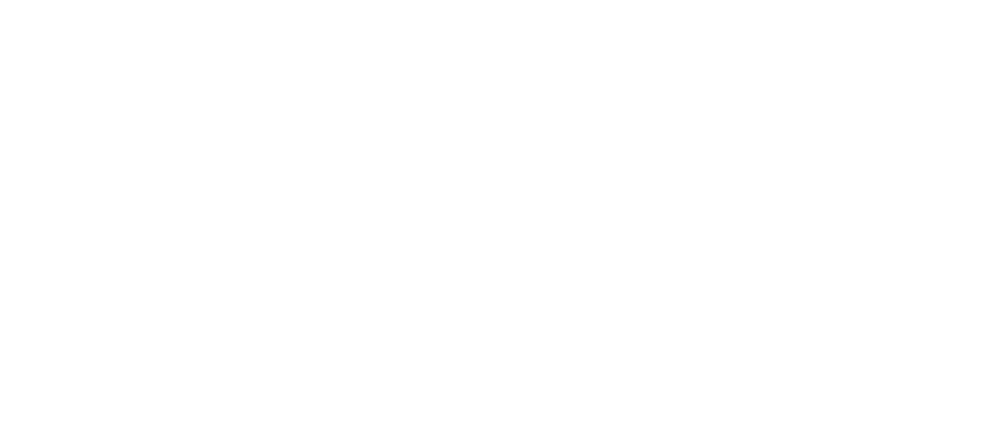- De quoi s’agit-il? — Mettre en intrigue un récit consiste à nouer une tension pour donner envie au lecteur ou à la lectrice de progresser vers un dénouement. La tension se noue quand on commence à se poser des questions sur l’histoire qui est racontée et elle se dénoue quand le récit donne des réponses. Il y a deux manières de nouer une intrigue : a) quand on se pose des questions sur la manière dont les événements vont évoluer, on ressent du suspense ; b) quand le récit est mystérieux et qu’on se pose des questions sur ce qui se passe ou sur ce qui s’est passé, on éprouve de la curiosité. Une bonne intrigue ménage aussi des surprises, car elle ne doit pas être trop prévisible.
- Intérêt pour l’élève? — Découvrir comment on peut nouer et dénouer de la tension dans un récit permet de réfléchir sur les aspects qui rendent l’histoire intéressante. Même la meilleure histoire peut être ennuyeuse si l’écrivain ou l’écrivaine ne sait pas créer du suspense, de la curiosité ou des surprises. Nouer et dénouer une tension donne du rythme au récit et structure ce que les scénaristes appellent des « arcs narratifs ».
- Intérêt pour l’enseignant·e ? — Le travail sur la mise en intrigue permet de prendre du recul par rapport à une histoire qui nous captive, justement dans les termes de cette captivité. On se donne le temps et les outils pour comprendre les mécanismes qui nous rivent au récit. À cet effet, la mise en intrigue renvoie à tous les moyens par lesquels un récit suscite un intérêt pour le développement de l’histoire, alors que lorsqu’on se contente du schéma narratif pour avoir un regard général, on s’attache à la chronologie des événements sans tenir compte de la progression narrative. Ce travail permet de partir de questions simples (que se passe-t-il à ce point de l’histoire ?) pour aborder ensuite des mécanismes narratifs parfois complexes (portant par exemple sur la vitesse ou l’ordre du récit, la restriction ou l’élargissement local du savoir, etc.).
Tous les récits racontent une histoire (c’est-à-dire mettent en scène une séquence d’action ou d’événements), en revanche, on ne peut pas affirmer que tous les récits nouent une intrigue. Certains récits visent à expliquer des événements plutôt qu’à intriguer leur public. Quand le récit possède une intrigue, la narration plonge le public au cœur des événements, de sorte qu’il devient possible d’explorer les virtualités actionnelles, d’expérimenter les obscurités et les incertitudes d’un événement, d’exercer son aptitude à anticiper le développement de situations instables.
Il ne faut donc pas confondre la séquence des événements racontés et sa mise en intrigue. Il y a mise en intrigue quand les événements racontés visent à intriguer le public. L’intrigue se noue quand l’histoire suscite l’intérêt, renforce le désir de progresser dans la lecture jusqu’à un dénouement. Quand l’intrigue est nouée, le public est invité à se poser des questions concernant les événements racontés : qu’est-il arrivé ? que se passe-t-il ? comment l’histoire finira-t-elle ? comment le récit va-t-il se dénouer ?
Comme le montre l’exemple suivant, imaginé par François Truffaut, l’art de nouer une intrigue tient non seulement à l’intérêt de l’action, qui contient généralement des conflits ou des buts difficiles à atteindre, mais également à la capacité de l’auteur (ou du réalisateur) de susciter une sorte de tension narrative en dramatisant l’événement, c’est-à-dire en insistant sur l’incertitude de son déroulement jusqu’au dénouement :
Un personnage part de chez lui, monte dans un taxi et file vers la gare pour prendre le train. C’est une scène normale à l’intérieur d’un film moyen. Maintenant, si avant de monter dans un taxi, cet homme regarde sa montre et dit : « Mon Dieu, c’est épouvantable, je n’attraperai jamais mon train », son trajet devient une pure scène de suspense car chaque feu rouge, chaque croisement, chaque agent de la circulation, chaque panneau indicateur, chaque coup de freins, chaque manipulation du levier de vitesse vont intensifier la valeur émotionnelle de la scène. (Truffaut 1975 : 16)
Dans le langage courant, on entend souvent l’expression : « C’était ennuyeux, il n’y avait pas d’intrigue ! ». Dans cette phrase, on comprend que l’intrigue est liée à l’intérêt du récit, à sa capacité de susciter de la curiosité ou du suspense, qui produisent l’attente d’un dénouement, et de ménager des surprises (des rebondissements, etc.). On s’intéresse ici à l’effet que le récit est susceptible de produire sur le lecteur, à la tension narrative qui est comme un arc tendu vers une résolution inconnue. Les scénaristes parlent souvent d’arcs narratifs pour décrire cette structuration du récit sous la forme d’une alternance tension-résolution. L’intrigue peut être ainsi définie comme la structuration dynamique d’un récit fondé sur un nœud, qui crée de la tension narrative, et d’un dénouement, qui a pour fonction de résoudre cette tension.
Différence entre suspense et curiosité
Comme l’explique Tzvetan Todorov, il existe deux formes de récit policier très différentes, qui reposent sur des effets fondamentalement opposés, mais qui peuvent fusionner dans certains cas :
On se rend compte ici qu’il existe deux formes d’intérêt tout à fait différentes. La première peut être appelée la curiosité ; sa marche va de l’effet à la cause : à partir d’un certain effet (un cadavre et certains indices) il faut trouver sa cause (le coupable et ce qui l’a poussé au crime). La deuxième forme est le suspense et on va ici de la cause à l’effet : on nous montre d’abord les causes, les données initiales (des gangsters qui préparent de mauvais coups) et notre intérêt est soutenu par l’attente de ce qui va arriver, c’est-à-dire des effets (cadavres, crimes, accrochages).
Todorov, 1971 : 60
On peut généraliser le propos de Todorov et considérer qu’il existe en effet deux manières fondamentales de nouer une intrigue :
| Type de nœud textuel | Narration d’un évènement dont l’issue est incertaine (p.ex. un conflit, une quête…) | Narration incomplète d’un événement (énigmes, secrets…) |
| Type d’activité cognitive | Pronostic hypothèses portant sur le développement ultérieur ou le résultat final de l’événement | Diagnostic hypothèses visant à expliquer l’événement actuel ou passé à partir d’indices |
| Type de tension narrative | Suspense | Curiosité |
Pour déterminer la manière dont l’intrigue se noue, il suffit de se demander quelles sont les questions que le public est invité à se poser à un moment donné du développement du récit.
Suspense : Dans le premier cas, une complication vient perturber une situation ordinaire et les actions qui suivent ouvrent différentes virtualités que le lecteur ou la lectrice peut envisager sous la forme de pronostics incertains. L’effet de suspense est alors renforcé par le respect au moins partiel de la chronologie de l’histoire, ce qui nous rapproche du plan des personnages impliqués dans les événements. Souvent, le suspense est obtenu en signalant un danger imminent, dont les personnages n’ont pas forcément conscience. Le lecteur se demande alors : que va-t-il se passer ? va-t-il y arriver ? comment cela va-t-il finir ? etc.
Curiosité : Dans le second cas, le respect de la chronologie est rarement respecté. Le lecteur est confronté à une représentation incomplète d’événements qui suscitent sa curiosité. Une fois le dénouement dévoilé, il devient possible, en fouillant le passé du récit, d’en combler les lacunes jusqu’à ce qu’une compréhension suffisante de la situation narrative puisse être reconstruite. Le recours à ce procédé est une façon assez classique de nouer une intrigue dans les premières pages d’un récit ou pour le genre des enquêtes policières. Dans ce cas, le lecteur peut tenter d’anticiper le dénouement en formulant des diagnostics à partir d’indices disséminés dans le récit. Le lecteur se demande alors : que s’est-il passé ? quel est le secret que dissimule ce personnage ? qui est le coupable ? etc.
Surprise : un troisième intérêt narratif est fondé sur la nécessité de l’intrigue de rester suffisamment originale et imprévisible pour déjouer les pronostics et les diagnostics des lecteurs et produire des effets de surprise. Les retournements imprévus (les « coups de théâtre ») et les surprises qu’ils engendrent soulignent la nécessité de renouveler continuellement nos modèles de prévision pour s’adapter à un monde évolutif. Ces effets ont donc une importance majeure sur la manière dont les récits contribuent à élargir les cadres d’expérience. Les reconfigurations peuvent porter sur des savoirs littéraires (la prévisibilité des genres) ou sur des savoirs plus généraux (attentes concernant les fonctionnement sociaux ou psychologiques).
Dramatisation de l’action par le discours narratif
L’intensité de la mise en intrigue s’appuie aussi sur des variations de rythme, d’ordre et de perspective narrative. Les pauses descriptives ou digressives ainsi que les sommaires sont rarement des passages tendus, alors que les scènes, qui mettent en avant des séquences d’action et des dialogues, sont marquées par une plus forte dramatisation des événements, souvent au profit d’une intensification de la curiosité et du suspense. Le dénouement de la curiosité entraine quant à elle la plupart du temps le recours à des analepses, dramatisées ou non. Une bonne façon de susciter de la curiosité au début d’un récit consiste à jeter le lecteur ou la lectrice au cœur des événements et d’exposer rétrospectivement le contexte nécessaire pour comprendre ce qui se passe.
Par ailleurs, la restriction du savoir ou son élargissement sont souvent exploités pour renforcer respectivement la curiosité ou le suspense :
- Quand un personnage détient un secret ou formule un plan mystérieux, il suscite de la curiosité ;
- Quand nous sommes informés d’un danger qu’il ignore, cela renforce le suspense.
Enfin l’usage d’un point de vue interne permet souvent d’expliciter les virtualités narratives qui donnent son relief à l’intrigue. Cela permet aussi de mettre en évidence les incertitudes et les inquiétudes éprouvées par les personnages, ce qui renforce souvent la tension par empathie ou identification.
Phases de l’intrigue
Les éléments fondamentaux de l’intrigue sont le nœud et le dénouement. Le nœud se définit comme un lieu important du récit où un élément de l’histoire vise à intriguer le lecteur, c’est-à-dire à produire de la tension narrative (suspense ou curiosité). Le dénouement se définit quant à lui comme le lieu de la résolution de cette tension, c’est-à-dire comme une réponse aux questions engendrées par le nœud. D’autres éléments optionnels que l’on rattache à l’intrigue sont l’exposition, les péripéties, le climax et l’épilogue, ainsi que les cliffhangers et les fins ouvertes.
- Exposition : On peut aussi parler de phase d’exposition pour décrire la partie de l’intrigue qui vise à poser les éléments essentiels de l’histoire. Généralement, cette phase est marquée par une dominance de la curiosité, notamment lorsque nous sommes directement plongés dans le cours de l’action, et nous recevons progressivement des éléments d’explication. Une fois les éléments essentiels de l’intrigue connus, la tension s’oriente généralement vers le suspense, la question étant de savoir comment le ou la protagoniste va parvenir à se sortir d’une situation difficile.
- Nœud : dans cette phase où la tension se noue, nous sommes amenés à nous interroger sur certains éléments importants de l’histoire, qui sont présentés comme incertains ou énigmatiques, ce qui suscite le désir d’en savoir plus, et donc de progresser vers un dénouement attendu.
- Péripéties : dans cette phase, nous progressons vers la résolution mais sans que la tension ne se dénoue. Au contraire, elle tend à augmenter à mesure que l’on s’approche du dénouement. Le retardement de la résolution se fait généralement par l’insertion de mini-intrigues enchâssées dans l’intrigue principale, chaque péripétie devant être dénouée pour reprendre la progression. Cette phase vise donc à entretenir la tension, et même à la faire monter jusqu’à un point culminant appelé climax.
- Dénouement : dans cette phase, des réponses sont apportées aux questions que nous nous posions, l’incertitude est ainsi résolue et la tension est dénouée.
- Épilogue : La phase finale est parfois définie comme un épilogue, où le sens global de l’intrigue est discuté et fait souvent l’objet d’une évaluation morale, alors que la tension est déjà résolue.
- Cliffhangers et fins ouvertes : Il faut noter également qu’il existe des récits non dénoués. Dans ce cas, la fin demeure ouverte et nous sommes amenés à trouver nous-même des réponses aux questions laissées en suspens par le récit. Quand une fin ouverte se trouve à la fin d’un chapitre ou d’un épisode de série, et qu’il s’agit d’attendre une suite annoncée, on parle de cliffhanger.
Hiérarchies des « arcs narratifs »
Il est souvent possible de déterminer une intrigue principale et des intrigues secondaires ou subsidiaires. Dans les séries, notamment télévisées, ces différentes intrigues sont appelées des « arcs », qui sont articulés aux différentes charnières du récit : il y a l’arc global, qui couvre l’ensemble de la série, mais il y a aussi des arcs subsidiaires qui structurent chaque saison, chaque épisode, et différentes séquences au sein des épisodes. L’alternance des chapitres dans un roman peut aussi offrir des articulations pour un enchâssement des intrigues et des sous-intrigues, chaque segment du récit trouvant une conclusion relative tout en faisant progresser l’arc narratif principal.
Pour entrer dans les débats
L’intrigue est souvent confondue avec les notions de séquence ou de schéma narratif ou quinaire, comme s’il s’agissait de synonymes. Il y a cependant de bonnes raisons de différencier l’intrigue, au sens étroit du terme utilisé ici, des différentes manières de formaliser la trame de l’histoire, qui se sont développées dans le sillage de la morphologie de Vladimir Propp (1970 ; Adam 1997). Boris Tomachevski (1955) ne confond d’ailleurs par les niveaux narratifs qui correspondent à la fabula (histoire) et au sujet (récit) avec leur mise en intrigue, dispositif visant à créer une tension dans la lecture qu’il désigne avec le terme интрига emprunté au français.
Le schéma narratif représente la structure globale des événements racontés. Cette structure – qui montre l’important structurelle d’une complication venant perturber une situation initiale et finissant par déboucher sur une résolution et une situation finale – peut évidemment servir de matière pour la mise en intrigue d’un récit, dans la mesure où elle peut servir à nouer puis à dénouer un suspense, mais les deux manières d’aborder la séquentialité narrative sont très différentes (Baroni 2023). En effet, le schéma narratif est autonome de sa fonction discursive, la forme d’une histoire étant déterminée, d’un point de vue interne, par l’ordre chronologique et causal des événements racontés, sans préjuger de ses fonctions externes. Il implique les personnages de l’histoire qui prennent part aux événements racontés, mais pas la communication entre l’auteur et le lecteur.
À l’inverse, la mise en intrigue est un dispositif qui doit être pensé à la fois sur un plan rhétorique et esthétique : elle a pour fonction de donner naissance un intérêt narratif qui repose sur une organisation spécifique de la double séquence de l’histoire et de sa mise en discours (Sternberg 1992). Beaucoup de récits qui se nouent par un effet de curiosité reposent ainsi sur une exposition lacunaire ou retardée de certains éléments de l’histoire, ce qui induit une introduction ultérieure d’informations concernant le passé des événements, de sorte que la mise en intrigue s’écarte notoirement de l’ordre chronologique de la séquence narrative (voir Baroni 2023).
Par ailleurs, la séquence narrative est déterministe (elle se réalise toujours de la même manière), tandis que la mise en intrigue est probabiliste : sa fonction est d’ouvrir un réseau de virtualités dans le fil de la lecture (Dannenberg 2008 ; Kukkonen 2020) pour orienter une progression (Phelan 1989) aimantée par le désir d’un dénouement (Brooks 1984), dont la fonction est de résoudre les incertitudes nouées par le nœud de l’intrigue. Il faut enfin ajouter que les rouages de l’intrigue dépendent de la forme du discours narratif autant que de l’histoire, la tension n’étant jamais entièrement déterminée par la seule nature des événements racontés, mais aussi par la manière, plus ou moins intrigante, de les mettre en récit (Baroni 2017). Comme le résume Villeneuve:
Le Littré, le Larousse et le Quillet accordent à l’intrigue la vertu de créer du suspense et d’éveiller la curiosité du lecteur-spectateur. C’est sur ce plan que se démarque pour la peine le couple nœud-dénouement. Les complications, les enchevêtrements, les combinaisons d’événements sont intimement liés au pouvoir de séduction qu’exerce l’intrigue sur le lecteur ou le spectateur. Grâce à ce second plan, on comprend mieux la spécificité du premier [celui des actions]. On saisit pourquoi la confusion règne entre l’action et l’intrigue. Une fois de plus, la notion d’intrigue permet de lier la fable au discours, la puissance formelle aux effets de lecture, l’action aux effets rhétoriques, pour ne pas dire à la rhétorique des formes.
Villeneuve 2003: 46-47
Sur le plan des activités scolaires, séquence narrative, tension et mise en intrigue sont des outils qui ne servent par les mêmes finalités. La séquence narrative est un outil qui sert à résumer un récit ou, pour les activités de production écrite, elle structure la phase de l’inventio, durant laquelle l’élève élabore les lignes principales d’une histoire susceptible de fournir la matière première d’un récit que l’on jugera complet et bien organisé. À l’inverse, la mise en intrigue invite à interpréter les nombreux dispositifs narratifs mobilisés par un auteur ou une autrice pour susciter du suspense, de la curiosité ou des surprises, pour plonger le public dans un labyrinthe de virtualités dont l’importance éthique et la valeur esthétique est souvent proportionnelle à la dramatisation des événements. L’approche par la tension narrative peut aussi servir de guide dans le processus de rédaction qui correspond aux phases de la dispositio et de l’elocutio, en aidant à chercher la meilleure manière de raconter l’histoire en orientant l’attention du lecteur sur le caractère imprévisible ou mystérieux des événements et en suscitant le désir d’un dénouement complet, ou au contraire ouvert.
Références
Adam, Jean-Michel (1997), Les Textes: types et prototypes, Paris, Nathan.
Baroni, Raphaël (2007), La Tension narrative. Suspense, curiosité et suprise, Paris, Seuil.
Baroni, Raphaël (2014), « Les rouages de l’intrigue dans l’atelier de Ramuz : la tension expliquée », Études de Lettres, n° 295, p. 109-131.
DOI : https://doi.org/10.4000/edl.614
Baroni, Raphaël (2013), « Didactiser la tension narrative : apprendre à lire ou apprendre comment le récit nous fait lire ? », Recherches & Travaux, n° 83, p. 11-23.
DOI : https://doi.org/10.4000/recherchestravaux.649
Baroni, Raphaël (2023), « Des virtualités du monde de l’histoire à la mise en intrigue : une alternative au schéma narratif », Pratiques. Linguistique, littérature, didactique, n° 197-198. URL: https://journals.openedition.org/pratiques/12755
Baroni, Raphaël (2017), Les Rouages de l’intrigue, Genève, Slatkine érudition. Ouvrage en accès libre, URL : https://serval.unil.ch/resource/serval:BIB_91F2FABBCF53.P001/REF
Brooks, Peter (1984), Reading for the Plot: Design and Intention in Narrative, Cambridge, Harvard University Press.
Dannenberg, Hilary (2008), Coincidence and Counterfactuality. Plotting Time and Space in Narrative Fiction, Lincoln, University of Nebraska Press.
Kukkonen, Karin (2020), Probability Designs. Literature and Predictive Processing, New York, Oxford University Press.
Phelan, James (1989), Reading People, Reading Plots: Character, Progression, and the Interpretation of Narrative, Chicago, University of Chicago Press.
Propp, Vladimir (1970), Morphologie du conte, Paris, Seuil.
Sternberg, Meir (1992), «Telling in time (II): Chronology, Teleology, Narrativity», Poetics Today, n° 13 (3), p. 463-541.
Todorov, Tzvetan (1971), «Typologie du roman policier», in Poétique de la prose, (dir.), Paris, Seuil, p. 55-65.
Tomachevski, Boris (1965), «Thématique», in Théorie de la littérature, T. Todorov (dir.), Paris, Seuil, p. 263-307.
Truffaut, François (1975), Le Cinéma selon Hitchcock, Paris, Seghers.
Villeneuve, Johanne (2004), Le Sens de l’intrigue, ou la narrativité, le jeu et l’invention du diable, Québec, Presses Universitaires de Laval.
Fiche de synthèse
Téléchargez ici la fiche de synthèse (secondaire 2, lycée, gymnase).