Le Bleu de Madeleine
d’Anne Luthaud / mise en scène Anne-Marie Marquès / Le petit théâtre de Lausanne / du 9 au 13 octobre 2013 / Critiques par Suzanne Balharry et Roxane Cherubini.
9 octobre 2013
Par Suzanne Balharry
Haut en couleurs
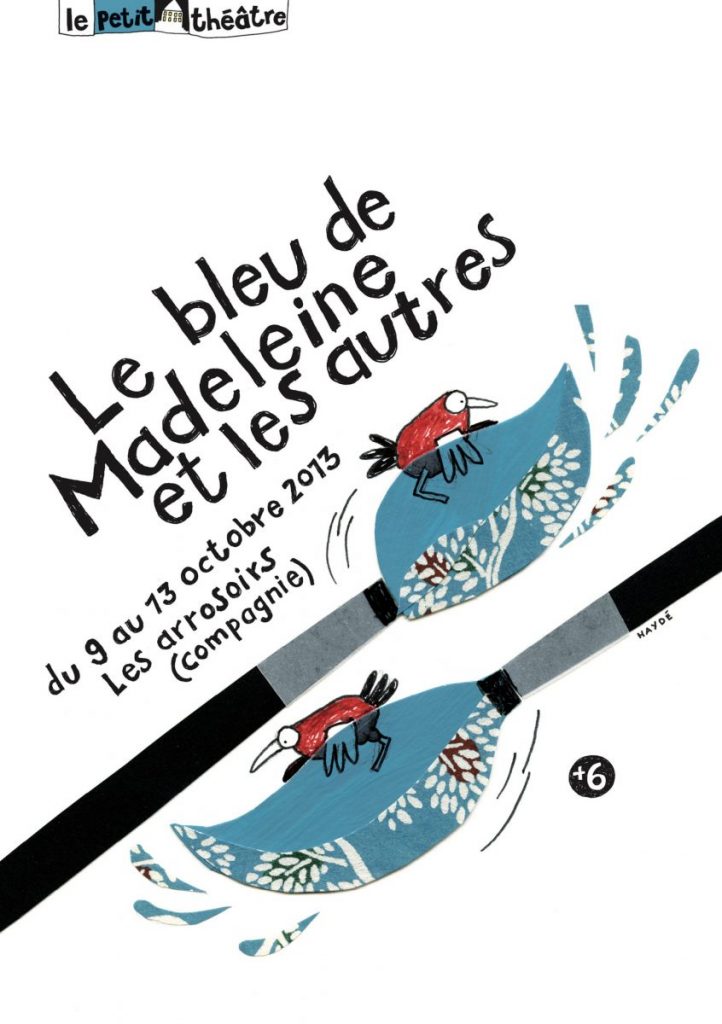
Sur l’écran géant, l’image de deux actrices bondissant en costumes futuristes est projetée en direct. Ainsi s’achève Le Bleu de Madeleine et les autres. Un voyage à travers les couleurs qui déploie un arc-en-ciel de formes artistiques mais dont, ce soir-là, on est malgré tout ressortis un peu déroutés.
Dans un premier temps, ce spectacle soutient bien sa nomination aux Molières 2007 dans la catégorie jeune public. Il raconte l’histoire d’une petite fille appelée Madeleine qui cherche le plus beau bleu. A travers la peinture, il explore la composition de la matière et des couleurs. On est peu à peu plongé dans un univers paisible qui nous enchante par des images parfois drôles et parfois pleines d’émotion.
La pièce se joue d’abord au premier plan sur la scène, qui représente l’atelier de deux artistes peintres. Une des deux est jouée par la metteuse en scène Anne-Marie Marques, qui raconte l’histoire de Madeleine telle qu’elle a été écrite par l’auteure Anne Luthaud. Le texte aborde la façon dont les couleurs évoquent des images et habitent notre vocabulaire, aussi bien dans nos expressions que dans des tableaux connus tels que La vue de Delft de Vermeer, dont parle Proust dans le cinquième tome d’A la recherche du temps perdu. Le spectacle offre donc, en plus de l’atmosphère douce, un enseignement sur le langage et l’art.
Pendant que les actrices jouent, l’histoire du spectacle se projette également sur un second plan. Il s’agit d’un grand écran où simultanément est diffusée la création des images peintes, tracées par la comédienne et peintre Jeanne Ben-Hammo. Sur cette toile en contre-champ, l’artiste trace les traits avec un rythme qui donne l’impression qu’ils ont une sonorité. Les deux actrices nous plongent ainsi dans un dialogue, l’une employant les mots et l’autre la peinture, qui devient un élément dramaturgique.
Mais le spectacle n’est pas seulement un beau voyage à travers les couleurs. Après avoir exploré la peinture, la langue et l’art avec poésie, la mise en scène de la compagnie française Les Arrosoirs, fondée en 2002, prend une dimension beaucoup plus ample et s’achève dans un enchaînement d’effets visuels. On voit les actrices se changer en costumes futuristes et bondir en se recouvrant de peinture. Leurs mouvements sont simultanément projetés sur l’écran dans un défilement rapide d’images, dont l’effet a peut-être été perturbé par un problème technique le soir de la représentation à laquelle nous avons assisté. Si cette dernière scène a captivé les enfants, elle a fait également perdre son fil à la pièce. Le Bleu de Madeleine et les autres, joué du 9 au 13 octobre au Petit Théâtre de Lausanne, est une belle illustration de la création à travers plusieurs formes simultanées d’art, entre littérature, peinture, cinéma, et musique, même si, ce soir-là, on en est sortie déconcertée.
9 octobre 2013
Par Suzanne Balharry
9 octobre 2013
Par Roxane Cherubini
Le Bleu de Madeleine ou la dilution du sens
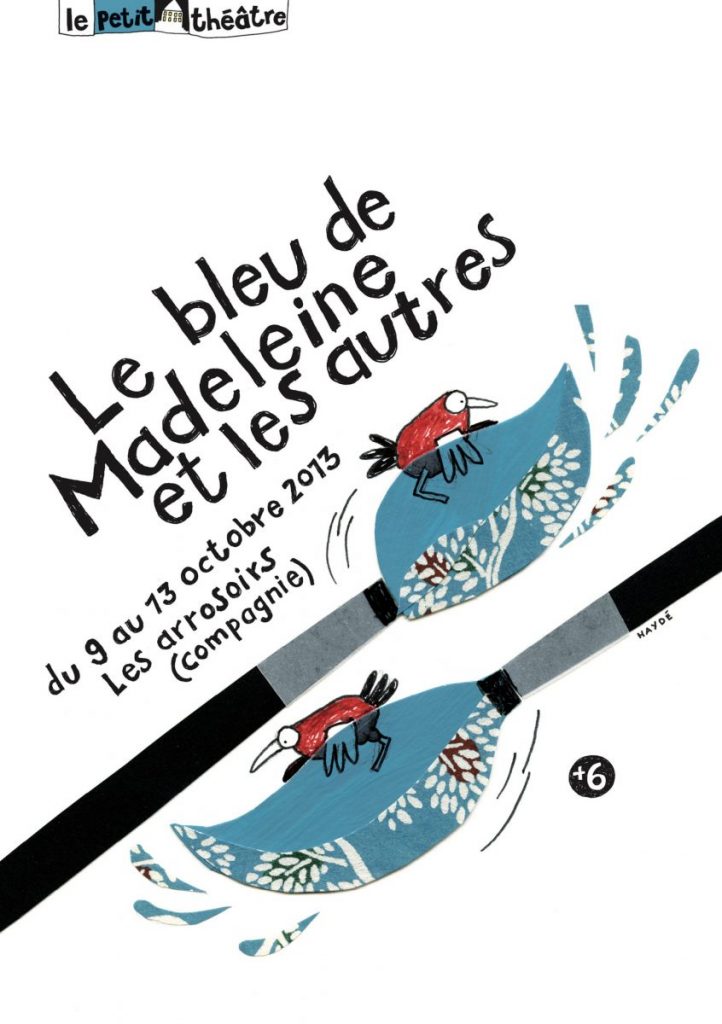
La pièce jeune public Le Bleu de Madeleine et les autres, dirigée par Anne-Marie Marques et jouée au Petit Théâtre à Lausanne en octobre dernier, marie avec grand art la peinture et les mots. Seule ombre au tableau, l’ajout superflu de mouvements et de sons, qui font perdre de sa consistance à la pièce.
Plusieurs gouttes de peinture d’un bleu roi qui plongent et se répandent majestueusement dans l’eau – fumée visuelle teintant le discours de la comédienne à la recherche du plus beau bleu dans la mer. L’image est belle et met en évidence la force d’un spectacle qui mêle le verbe à la couleur. Sur le plateau, une peintre crée sur un chevalet côté jardin ou sur une toile blanche côté cour. Les supports sont filmés par une caméra mobile, projetant sur un immense écran, au fond de la scène, les fresques simultanées de l’artiste. Les nuances se superposent et s’effacent sur ce grand tableau en constante évolution, qui matérialise les paroles de Madeleine au rythme de ses mots. Celle-ci désire saisir l’essence des couleurs primaires autour de trois questions qui cadencent la pièce, « Quel est le plus beau bleu ? », « Quel est le nom du rouge préféré de mon petit frère ? » et « Comment fait-on le jaune ? ».
Anne-Marie Marques aurait pu se contenter de cette alliance entre deux arts qui trouvent une complémentarité poétique sur le tissu cinématographique. L’ambition principale est cependant parasitée par des éléments trop externes au brassage visuel et scriptural. La musique, entre une composition de Mozart et le son entrecoupé de fritures d’une radio, ne s’unit pas harmonieusement au texte récité ni aux esquisses réalisées, essentiellement focalisés sur la recomposition des couleurs élémentaires. Le son paraît dès lors plus combler les vides des transitions que seconder et enrichir pertinemment le sens de la pièce. Quant à la danse sur laquelle s’achève le jeu, elle est également étrangère au propos principal. Les deux comédiennes, qui ont su résoudre les interrogations de Madeleine, explosent de joie et font frétiller leur corps dans une sorte de transe instinctive, qui s’oppose à leur démarche réfléchie de conceptualisation du bleu, du rouge et du jaune.
Mise en scène de la couleur, « Le Bleu de Madeleine et les autres » aurait gagné à ne pas se disperser dans des formes trop distinctes entre elles. Les créations d’Anne-Marie Marques évoquent toutes la force d’un théâtre pluridisciplinaire. Mais la dernière venue aurait dû se limiter à l’union entre écriture, peinture et projection pour renforcer sa portée, au lieu d’intégrer de la musique et de la danse. Par là, la pièce exprime malheureusement les pièges d’un mariage artistique infondé.
9 octobre 2013
Par Roxane Cherubini

