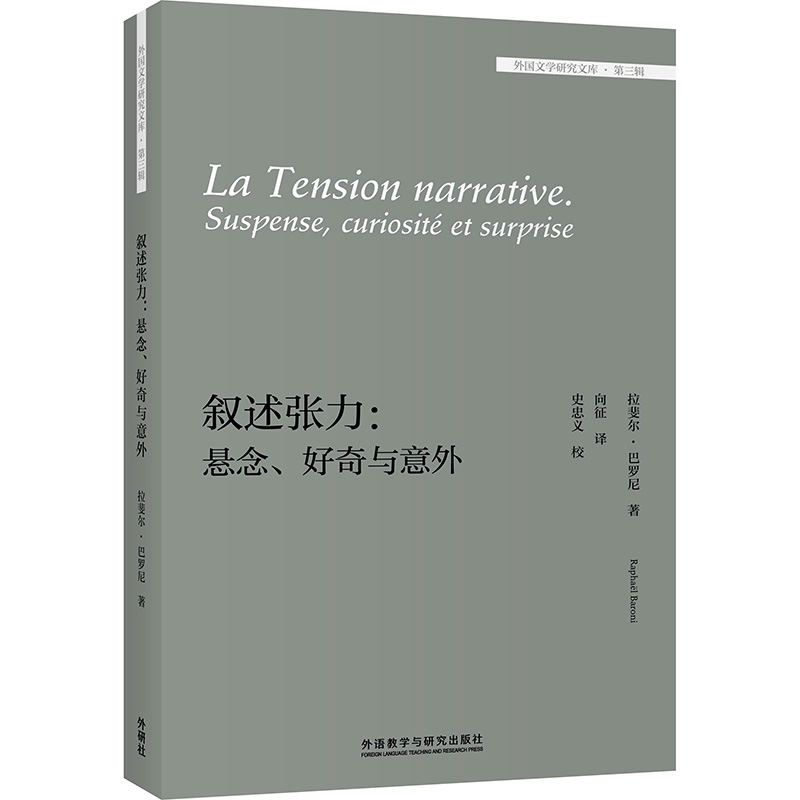L’interrogation qui préside au nouveau numéro de Fabula-Littérature Histoire Théorie est aussi simple qu’abrupte : que faisons-nous avec les fictions et aux fictions elles-mêmes lorsque nous débattons d’elles ?
Chimène pouvait-elle épouser Le Cid ? La Princesse de Clèves a-t-elle bien fait d’avouer à son mari qu’elle était aimée d’un autre homme ? Pourquoi Cendrillon ne s’est-elle pas rebellée plus tôt ? Meursault était-il raciste ? Hercule Poirot a-t-il commis une erreur sur l’identité du meurtrier ? Les Lannister devaient-ils absoudre Ned Stark ? Don José pouvait-il épargner Carmen ? Néo aurait-il dû se soumettre à la prophétie de l’Oracle ? Peut-on accepter d’entrer dans les raisons de Humbert Humbert et faut-il faire lire Lolita aux adolescent.e.s d’aujourd’hui ? Horace devait-il s’abstenir du meurtre de Camille ? Fallait-il vraiment que Dumbledore cache la vérité sur le destin d’Harry ? Manon a-t-elle sincèrement aimé Des Grieux, et le récit du chevalier est-il toujours bien honnête ? Faut-il blâmer Charles de la mort d’Emma ?
De quelle nature sont nos jugements sur les fictions ? À quelles opérations se livre-t-on pour simplement en parler et très régulièrement en débattre ? Car la fiction n’est pas seulement l’objet d’une expérience individuelle vouée à rester silencieuse : elle est aussi ce dont on parle avec d’autres lecteur.trice.s ou spectateur.trice.s, ce qu’on partage à condition d’en débattre, de confronter des opinions et de soumettre un jugement à la discussion. Mais de quoi discourt-on au juste lorsqu’on s’interroge sur la conduite d’un être de papier, qu’on débat d’une situation fictive ou qu’on revient sur un dénouement arbitraire ? Dans nos échanges les plus quotidiens sur les fictions, peut-on seulement départager les propositions qui portent sur l’œuvre de celles qui portent sur le monde fictif, et les jugements sur la situation fictionnelle des jugements sur le monde réel ? Si le débat s’accompagne toujours d’une intervention sur la fiction, quels sont les enjeux éthiques ou politiques d’une telle ingérence ?
Les multiples querelles et controverses dont les fictions ont fait l’objet en Occident ont été largement étudiées par l’histoire littéraire, notamment en ce qu’elles nous instruisent sur les représentations du monde réel et les pratiques esthétiques à travers le temps. Le débat sur la fiction mérite toutefois d’être constitué comme objet théorique.