This publication is also available in :
English
Dans cette série d’interviews, nous vous proposons les réflexions de notre communauté de recherche sur les pratiques de terrain et leur évolution. Sur ce sujet, vous pouvez aussi lire :
- Vers plus d’inclusivité sur le terrain : un guide en gestation
- Vers une paléontologie plus inclusive et plus éthique
- Histoire de fossiles : témoignage d’un domaine en transition
- Enquête à Madagascar – ethnographie de terrain dans un paysage rural
- L’éthique de la recherche de terrain – partage d’expérience

Christian Kull s’intéresse à la gestion de l’environnement dans les paysages ruraux. Il a travaillé en Tanzanie, au Kenya, en Inde, au Vietnam… Mais c’est à Madagascar qu’il a réalisé ses Master et doctorat. Il a eu un coup de cœur pour les paysages des hauts plateaux de ce pays, mélange de forêts, de terrasses, de petites exploitations.
Il nous raconte comment il mène sa recherche de terrain en ethnographie.
Christian Kull est géographe. Ses travaux visent à éclairer les enjeux environnementaux globaux de notre époque. La gestion de l’environnement est une question centrale, car elle a des implications sur le bien-être humain, la prospérité économique et la durabilité. Ancré dans les disciplines scientifiques de la Political ecology, des Études du développement et des Humanités environnementales, Christian Kull cherche à mettre en lumière les racines profondes des problèmes environnementaux et des conflits qui les accompagnent, en explorant leur genèse historique, idéologique et politico-économique. Il a travaillé dans les pays les plus démunis, pour comprendre les dynamiques de gouvernances et des interventions étrangères.
Christian Kull a été président de la CER-GSE lors de son lancement en 2020 et il a contribué à sa mise en place. Dans cet entretien, il nous parle de ses travaux au long cours sur les feux de brousse et les plantes invasives.
Avec quels partenaires travaillez-vous ?
J’ai un intérêt particulier pour les acteurs et actrices locaux. J’essaie de comprendre comment les gens gèrent l’environnement qui les entoure, pourquoi planter ceci ou cela, couper des arbres, brûler la végétation… Et comment ces pratiques interagissent avec la politique nationale, mais aussi internationale.
J’interagis donc surtout avec les paysan·ne·s, mais aussi les personnes du monde rural – ceux qui ont un travail administratif, le pasteur (les églises y jouent un rôle important), l’enseignant·e de l’école locale – et au niveau plus global, avec des agents de l’état et des ONG, des gens dans l’aide bilatérale et à l’université.

Comment s’est fait le premier contact avec les personnes que vous voulez interroger ?
Maintenant, j’entreprends presque toujours un projet en partenariat avec l’université locale, notamment avec leur école d’agronomie, foresterie, et environnement, mais aussi avec le département de géographie. Pour mon master, c’était totalement différent : j’ai acheté un billet d’avion sans savoir si le professeur à qui j’avais écrit une lettre manuscrite l’avait bien reçue. Dès mon arrivée, j’ai toqué aux portes des personnes de l’Université de Tananarive que je ne connaissais qu’à travers leurs articles.
Ils m’ont présenté à un étudiant, Arsène Rabarison, que j’ai alors engagé comme aide de terrain, car je ne parlais pas encore malgache. Arsène m’a aussi aidé dans mon apprentissage : un apprentissage de la vie rurale, comment se comporter, un apprentissage des réseaux, comment trouver des logements, etc.
Les familles paysannes sont accueillantes. Dans les hameaux, on trouve toujours quelqu’un pour offrir à manger et un endroit où dormir. Le lendemain, ils envoient parfois un enfant pour vous montrer le chemin pendant quelques heures.
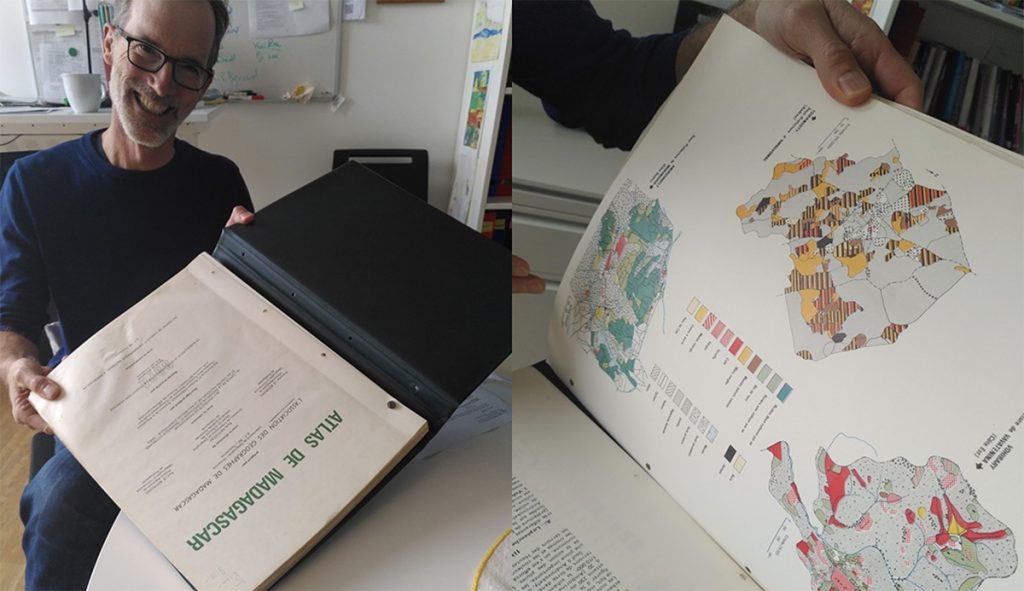
Avez-vous besoin d’autorisation pour aborder vos questions de recherche ?
Je traite surtout au niveau local, avec la mairie de la région. Mais j’ai aussi une lettre de l’université. Pour les administrations locales, c’est déjà un passeport si quelqu’un de la capitale a validé le projet.
Quand je travaillais à l’université de Monash à Melbourne (Australie), je devais suivre une procédure éthique plus bureaucratique, guidée par les défis de la recherche médicale, et visant à éviter les abus passés envers les aborigènes – qui ont souffert d’une recherche fondée sur l’exploitation. À Madagascar, j’ai toujours réussi à argumenter pour avoir un consentement oral et adapté aux traditions locales (où on inclut des formules pour remercier Dieu…). Les paysans ont apprécié cet effort, je crois ! Pour eux, signer un papier, c’est plutôt inquiétant, et ils ne savent pas toujours bien lire, l’oral est donc privilégié.
Le formulaire éthique prôné par mon université de thèse aux États-Unis ou par les universités australiennes reposait sur le postulat que nous seuls sommes en situation de domination et de pouvoir par rapport aux locaux dans ces échanges. Même si j’ai aussi observé que parfois la figure du chercheur suscite encore un trop grand respect « postcolonial », je critique cette perspective. Je choisis une procédure de consentement oral pour des raisons pragmatiques, mais aussi par conviction. Je considère que les personnes que j’interroge disposent également d’une forme de pouvoir, et je n’ai donc pas besoin de leur signature pour formaliser notre interaction. Et je l’observe aussi : si elles ne veulent pas répondre, elles contournent les questions avec aisance, elles mentent… j’ai confiance en elles ! Le point clé avant un entretien est de dire ce que je fais, que je ne vais pas utiliser leur nom et qu’elles peuvent choisir de ne pas répondre.

Comment gérer les questions délicates, qui peuvent mettre les gens en difficulté ?
J’ai travaillé sur les feux, qui sont une pratique souvent illégale. Mais je ne demande jamais directement qui a allumé un feu. Je dirais plutôt : « Tu as vu avant-hier, il y a eu un feu là-haut. Pourquoi ? ». Et on ne me répondra jamais « j’ai allumé le feu pour cette raison » ; mais par exemple « je soupçonne que celui qui a allumé, l’a fait pour cela ».
Dans ma recherche, j’avance ainsi en rassemblant des observations, par réseau de suspicion ou triangulation. Je construis petit à petit un argument comme je mènerais une enquête. La façon malgache de parler est aussi assez indirecte, il faut savoir décoder !
Comment protéger les données sur des pratiques illégales, comme le feu ? Avez-vous besoin d’assurer l’anonymat des sources ?
Les questions sur lesquelles je travaille avec mes partenaires et mon équipe ne sont pas hautement sensibles, et encore une fois, les preuves sont indirectes puisque personne ne dit « j’ai allumé ce feu » ou « c’est moi qui ai défriché cette forêt illégalement ».
Cependant, dès le début, on sépare les informations récoltées du vrai nom de leur émetteur. Et aucun fichier ne contient les deux éléments, empêchant ainsi des recoupements. Au besoin, un fichier de correspondance existe, mais séparé, et protégé par un mot de passe (le nom du fichier ne doit pas non plus être évident quant à la nature de son contenu !).
Pendant mon doctorat, dans mon cahier, il n’y avait pas les vrais noms. « Goatee » désignait quelqu’un qui devait avoir une petite barbe. J’ai baptisé « Ruedi » un paysan qui me rappelait mon oncle du même nom…

Quels conseils donnez-vous aux jeunes chercheurs et chercheuses avant de partir sur le terrain ?
Je réfléchis avec eux aux guides d’entretien, mais le terrain est vraiment un moment d’apprentissage. J’ai confiance en eux. Il faut oser tester des choses, voir ce qui fonctionne et ajuster au besoin.
Au bachelor, les étudiant·e·s s’initient à la recherche qualitative et apprennent à construire une enquête. Ils ont donc de bonnes bases, de bons manuels aussi. Mais tout cela est théorique… jusqu’au moment où tu es face à quelqu’un que tu veux interviewer !
Comment approcher des gens pour qu’ils soient d’accord de parler de leurs pratiques ? C’est une démarche sociale, où le sourire, la façon de se présenter vont importer autant que la connaissance des codes culturels (ce qui est acceptable, ce qui ne l’est pas). Parfois, c’est d’expliquer sa démarche qui va être déterminant, parfois c’est d’avoir convaincu le maire au préalable. Mais heureusement, à Madagascar comme ailleurs, les gens aiment parler de leur vie, dès lors que quelqu’un s’y intéresse.
En master, on essaie aussi d’exposer les étudiant·e·s à un contexte qui leur est « exotique ». Il faut que ça soit justifié au niveau budgétaire et en termes d’impact climatique, mais ce sont des moments d’apprentissage essentiels.
Y a-t-il des erreurs à ne pas commettre quand on construit un entretien ?
Un sujet qui m’est cher est celui des espèces invasives. Au début, certains étudiant·e·s posent des questions qui contiennent déjà la réponse : « Qu’est-ce que vous pensez de ces espèces envahissantes ? » Si on pose la question comme ça, les forestiers ou paysans vont essayer de nous faire plaisir, et dire que ces espèces les « envahissent »… Si on leur demande, « Que pensez-vous de l’eucalyptus, leurs points forts et faibles ? », on aura d’autres réponses. Par la suite seulement, on pourra aller plus loin : « Est-ce que vous avez entendu dire qu’elles sont envahissantes ? Qu’est-ce que ça veut dire pour vous ? » Ce n’est pas la même conversation.

Comment se sont développées vos relations avec les personnes locales ?
Pour mon doctorat, j’ai décidé de passer 4 mois et demi d’immersion culturelle et de cours de malgache intensifs. Tous les après-midis, je prenais mon vélo et j’allais pratiquer avec les paysan·ne·s des échanges basiques (« vous cultivez du riz ? »). Puis, j’ai vécu 10 mois dans un village. Rester sur le terrain si longtemps vous permet d’apprendre beaucoup sur le contexte dans lequel les questions spécifiques se situent. C’est pour moi inestimable, et c’est le seul moment dans une carrière où l’on a la liberté de faire cela. Petit à petit, on comprend les réseaux, les histoires d’amitié, de famille, de clan, de religion, toutes ces choses tellement opaques au début. C’est ce que nos étudiant·e·s n’ont pas toujours le temps de faire maintenant.
L’approche ethnographique demande du temps. C’est assez différent des interactions de recherche plus formalisées qu’on enseigne davantage maintenant.
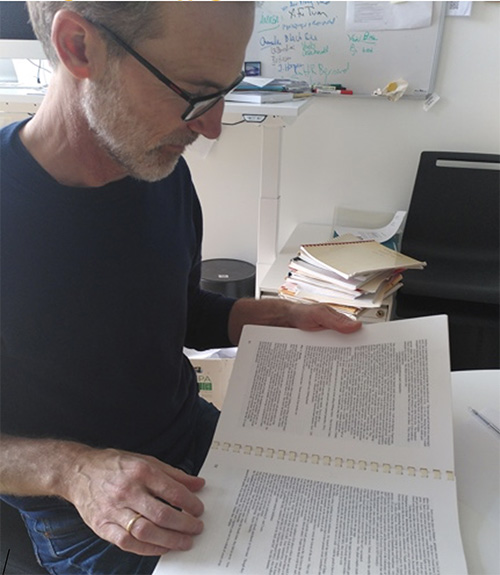
Pour aller plus loin

Christian Kull est expert dans la recherche sur les feux de brousse et de forêt, un phénomène qui a un impact majeur sur la dynamique du carbone, la biodiversité et les services écosystémiques. Dans un projet SNIS (Réseau suisse pour les études internationales), il cherche actuellement à identifier les politiques de gestion des incendies les mieux équilibrées, pour répondre aux besoins des communautés locales et aux enjeux du climat. Avec des partenaires des université Swansea (U.K.), Antananarivo (Madagascar), Eduardo Mondlane (Mozambique), mais aussi des South African National Parks et de l’UN Food and Agriculture Organization Madagascar, il se focalise sur des points chauds de biodiversité de Madagascar et d’Afrique australe.
Il a aussi contribué à faire avancer notre compréhension des mouvements d’espèces invasives et de plantes, la déforestation et le reboisement, les aires protégées et les transformations agraires à la déforestation et le reboisement, et aux transformations agraires.
Retrouvez le profil, le blog et les publications de Christian Kull.
Laisser un commentaire