Nouveau blog sous: https://ecotoxicologie.fr/blog-ecotoxicologues-pollution
Textes parus dans un blog sur le journal Le Temps, entre 2018 et 2021.
Un petit dernier pour la route…
Je ne vais pas faire durer le suspense…ceci sera mon dernier article après presque 4 ans de rendez-vous réguliers.
Une certaine lassitude? Je dois avouer que oui.
Malgré vos nombreux commentaires toujours intéressants et pertinents, souvent encourageants, j’ai souvent l’impression de mettre en évidence des problématiques pour lesquelles il y a peu de volonté de changer les choses.
Pire, depuis un an et demi, le nez dans le guidon, on recule sur de nombreux points qui semblaient acquis en terme de risque des polluants.
Comme celui des biocides.
Encore récemment, des auteurs américains ont alerté sur l’utilisation d’ammoniums quaternaires, des bactéricides, dans les désinfectants utilisés maintenant au quotidien, ainsi que sur l’administration systématique d’antibiotiques aux malades atteints du covid-19, ceci malgré l’absence de signes d’infections bactériennes. Selon eux, cela va augmenter le risque de développement de résistances bactériennes dans les prochaines années.
Or selon l’OMS, “la résistance aux antibiotiques constitue aujourd’hui l’une des plus graves menaces pesant sur la santé mondiale, la sécurité alimentaire et le développement”.
Toute femme qui a déjà eu une infection urinaire en a peut-être fait l’expérience. Si il suffisait de prendre un antibiotique il y a 20 ans, il arrive maintenant qu’on doive en changer en cours de traitement. Et les médecins doivent parfois faire des cultures pour déterminer la souche de bactérie responsable et vérifier sa résistance à l’antibiotique choisi.
Dans l’environnement aussi, la question de la résistance aux antibiotiques se pose. Car ces mêmes substances biocides et antibiotiques vont se retrouver dans les eaux via les eaux usées ou les eaux de ruissellement. De même que les bactéries résistantes. Est-ce que ces polluants vont induire des résistances dans l’environnement? Est-ce que les bactéries résistantes survivent dans les eaux? Est-ce qu’elles peuvent transférer leurs gènes à d’autres bactéries? etc…Autant de questions ouvertes qui n’ont pour l’instant pas de réponses.
Or actuellement les médias, tout à leur décomptes, ne s’intéressent que peu aux thématiques environnementales. Le rapport du GIEC paru en août, pourtant très alarmant, n’a fait la une de la presse qu’un ou deux jours.
Le reportage de Temps Présent, du Rhône au Léman, du poison dans notre eau potable, diffusé en juin 2021, n’a fait l’objet d’aucun relais médiatique ou politique. Et pourtant, il met clairement en évidence l’impact des décharges et effluents industriels sur la qualité et le futur de nos ressources en eaux.
Je vous avoue que c’est décourageant.
J’ai cependant décidé de conclure cette série d’articles sur une note positive.
Dans les années 1990, les pêcheurs constataient que les populations de truites dans les rivières avaient drastiquement diminué. Selon l’OFEV: “en 1980, on pêchait encore 1,2 million de truites dans les eaux suisses. On n’en pêchait plus que 400 000 en 2001”.
En 1998 est donc lancé le projet Fischnetz, un projet interdisciplinaire regroupant plusieurs institutions et hautes écoles suisses.
Treize hypothèses sont formulées pour expliquer ce déclin. Parmi elles, la question de la toxicité des substances chimiques que l’on retrouve dans les eaux.
En 2005, à la fin du projet, aucune conclusion claire. Manque d’habitats naturels, pollution des eaux, maladies infectieuses et changements climatiques, toutes ces causes interagissent certainement pour entrainer ce déclin.
A la suite de ce constat, deux principales mesures ont été décidées: la renaturation des cours d’eau et la diminution des rejets polluants.
Pour le premier point, les bases légales ont été posées en 2011. Ainsi “l’objectif de la Confédération est de mettre en œuvre des mesures de renaturation permettant de rétablir des ruisseaux, des cours d’eau et des lacs semi-naturels et auto-régulés dotés d’une dynamique qui leur est propre et de la faune et flore caractéristique”.
Pour le deuxième point, la Confédération a décidé de s’attaquer en premier lieu aux rejets de stations d’épurations (STEP). En effet, les nombreuses études existantes montrent que nombres de substances chimiques utilisées au quotidien (médicaments, détergents, cosmétiques, etc…) passent au travers des STEP.
Or les STEP n’ont pas été conçues pour traiter ces substances chimiques. Elles ont été construites pour éliminer la matière organique, l’azote et le phosphore. Certaines substances médicamenteuse se retrouvent donc aux mêmes concentrations à l’entrée et à la sortie de la STEP.
La révision de l’Ordonnance sur la protection des eaux est acceptée en 2015. Une centaine de STEP devront donc “traiter les micropolluants”.
Il existe différentes méthodes pour y arriver. Celles retenues pour être appliquées à grande échelle sont principalement le charbon actif (qui piège les molécules comme un filtre) ou l’ozonation (l’ozone, molécule très réactive, casse les substances chimiques). Avec l’ozonation cependant, le risque est de créer des substances de dégradation problématiques, ce qui explique que cette technique est complémentée par un filtre.
En Suisse romande, la première STEP équipée a été celle de Penthaz, en 2019.
Avec succès.
Le bilan de l’épuration des STEPs vaudoises 2020 montre que ce nouveau traitement permet de réduire de 95% la concentration totale des 42 substances recherchées. De plus, les concentrations sont aussi 20 fois inférieures aux concentrations des STEPs qui rejettent le plus de substances chimiques.
D’autres STEPs romandes et suisses, telle celle de Vidy à Lausanne, vont également progressivement être équipées de ces traitements.
Une très bonne nouvelle pour les eaux. Pour les écosystèmes aquatiques, mais également pour notre eau potable!
Voilà pour ce dernier point de situation.
A ce stade, j’aimerais vous remercier, lectrice, lecteur, fidèle, occasionnel ou de passage.
Le nombre de vues sur mon blog, vos commentaires, m’ont encouragée, m’ont fait réfléchir. Ce qui fût toujours stimulant.
Je vous souhaite de traverser cette période troublée le mieux possible.
J’espère vous recroiser au hasard d’écrits ou de conférences.
Nathalie Chèvre
Références:
ANSES. 2020. Antibiorésistance et environnement. Rapport d’expertise collective.
Mahoney et al. 2021. The silent pandemic: emergent antibiotic resistances following the global response to SARS-CoV-2. iScience 24. https://doi.org/10.1016/j.isci.2021.102304
L’accès au savoir n’est pas négociable
Il y a deux semaines, nous nous préparions à accueillir à nouveau les étudiants à l’Université, en présentiel complet, avec le respect des mesures sanitaires en vigueur.
Nous avions même réfléchi comment les motiver à revenir sur le campus après plus d’une année et demi à distance.
Mercredi passé, le couperet tombe, avec les annonces du Conseil Fédéral. Et dans la foulée, les Universités romandes décident que le pass Covid est obligatoire pour accéder aux cours en présentiel.
Soyons honnêtes, cela signifie que seuls les étudiant(e)s vacciné(e)s auront accès au cours. Car qui irait se faire tester tous les 2-3 jours pendant des mois ? Sachant que les tests seront bientôt payant? Personnellement je ne le ferais pas.
Dont acte.
N’en déplaise aux personnes qui adorent ranger les gens dans des catégories, il n’y a pas que les complotistes, ou antivax comme aiment les surnommer les médias, qui ne veulent pas ou ne peuvent pas se faire vacciner.
Ce n’est pas à moi de juger de leurs choix. Mon rôle est d’enseigner au plus grand nombre.
Nous avons face à nous des défis environnementaux considérables.
Le dernier rapport du GIEC sorti en août 2021 est sans appel. Nous nous devons de mettre en place, dans les prochaines années, des solutions innovantes pour réduire les émissions de CO2.
Dans mon domaine plus spécifiquement, il n’est plus discutable que la pollution que nous engendrons a des effets sur l’environnement, mais également sur notre propre santé. Ici aussi il va falloir se retrousser les manches et brasser les cerveaux pour trouver des solutions.
Au-delà de ça, il est maintenant reconnu que l’accès aux réseaux sociaux a permis l’émergence de pseudo-savoirs, alimentés par des croyances bien plus que par des faits.
En tant qu’universitaires, notre rôle, tel que je le considère, est de donner accès à un savoir transparent et basé sur des faits, ceci au plus grand nombre. Il est aussi de permettre aux étudiants de développer leur sens critique, ceci en confrontant leurs idées avec leurs pairs et avec leurs enseignants.
Enseigner, ce n’est pas enregistrer des cours que les étudiant(e)s pourront voir en ligne. Cette dernière année et demi me l’a montré.
Je n’ai pas encore pris toute la mesure des décisions qui ont été prises la semaine passée. Mais elles heurtent profondément mes valeurs d’enseignante.
Si les étudiant(e)s qui le souhaitent ne peuvent pas avoir accès à mes cours en présentiel, ce que je qualifie d’un enseignement de qualité, il me faudra trouver d’autres solutions innovantes pour que mon enseignement leur soit accessible.
Perfluorés omniprésents…et tant d’inconnues
J’avais déjà écrit un article sur les composés perfluorés en février 2019, leur présence ayant été démontrées jusque dans les neiges de l’Himalaya.
Je voulais y revenir de manière un peu plus approfondie car il s’agit là d’une pollution dont on commence seulement à entrevoir les conséquences à long-terme.
D’abord pour rappel, les molécules perfluorées sont composées d’une longue chaîne de carbones à laquelle sont liés un nombre plus ou moins important d’atomes de fluor.
La figure ci-dessous présente les molécules de PFOS et de PFOA. Qui sont actuellement les mieux documentées.
Ces molécules sont très stables dans l’environnement. Certains chercheurs pensent même que certaines d’entre elles ne se dégradent pas du tout. Leur émission dans l’environnement contribue donc à leur accumulation dans les écosystèmes.
Ces propriétés de persistance ont amené les membres de la Convention de Stockholm à intégrer le PFOS et le PFOA en 2009. Pour rappel, cette convention régule les composés organiques persistants au niveau mondial, tel le DDT (voir article de mai 2018).
Il existe plus de 4500 molécules perfluorées, chacune avec des propriétés de comportement dans l’environnement et de toxicité différentes.
L’histoire de leur développement est classique. La figure ci-dessous, publiée par l’agence environnementale américaine, la résume.
Hypothèse invalidée
Les chercheures et chercheuses se trompent…souvent. Et ce n’est pas grave.
C’est même plutôt normal: on émet une hypothèse, on la teste…et on la valide…ou pas.
Un peu comme quand on cherche un endroit inconnu sans carte. Si deux chemins s’offrent à nous, on va en tester un. Si c’est le mauvais, on revient sur ses pas pour tester l’autre.
Bon, c’est un peu schématique.
En effet, les domaines de la science sont très larges et il y a des milliers de chemins possibles. Il est donc tout-à-fait logique que certains n’aboutissent pas.
Je vous donne un exemple qui est arrivé dernièrement lors d’un travail de master. Une étudiante a mené une recherche sur deux étangs en milieu agricoles. Ces deux étangs avaient une biologie différente selon le Centre suisse de protection des amphibiens et des reptiles (Karch): dans un cas, la population d’amphibiens était assez élevée, dans l’autre pas.
L’étudiante a donc fait l’hypothèse que l’exposition aux polluants, notamment aux pesticides, pourrait expliquer cette différence.
Au final, très peu de pesticides, et surtout en concentrations très faibles, ont été détectés dans les deux étangs, en 2020 et 2021. L’hypothèse de départ est donc invalidée.
En terme environnemental, c’est une bonne nouvelle: les deux étangs contiennent peu de pesticides. En terme de recherche, c’est décevant.
Car malheureusement, la publication des résultats négatifs est quasi impossible. Si la recherche menée n’aboutit pas sur une nouvelle découverte, les journaux scientifiques ne l’accepte que très rarement.
C’est encore plus vrai depuis l’avènement des réseaux sociaux. Il faut des recherches « sexy » qui font le scoop et peuvent être reprises par les journaux grands publics.
On observe ainsi depuis quelques années une course à la publication. Et la tentation est forte de publier très vite, quitte à passer outre la nécessaire discussion entre experts.
Car même en cas de résultats positifs, il est important que les études soient soumises à la critique des paires. C’est même une des tâches centrales de la science comme le soulignait un excellent article dans Horizons, le journal du Fonds National Suisse de la Recherche, paru ce mois de juin 2021 (La confiance doit se gagner). La critique est un gage de qualité.
Il existe en effet des biais de recherche. Si vous posez une hypothèse, vous allez essayer de la valider. Donc vous allez, sans mauvaises intentions, mettre en place une méthodologie qui vous permettra de le faire. Ce qui n’est pas objectif quand on y réfléchit.
Parfois même, malgré des résultats peu probants, les auteurs d’étude valident leurs hypothèses, voyant, dans les quelques tendances qui se dessinent, des évidences. C’est quelque chose que je remarque régulièrement dans les travaux de masters. L’étudiant pose une hypothèse, décrit des résultats intéressants mais insuffisants pour valider son hypothèse, mais conclut quand même que celle-ci est correcte.
C’est humain. On a tous envie d’avoir raison, que notre hypothèse soit la bonne.
Il est donc important que d’autres chercheurs, qui travaillent d’une autre façon, puisse valider…ou invalider/critiquer les résultats des chercheurs et chercheuses.
Cette discussion critique entre experts se passe en arrière plan des publications (c’est le fameux processus de peer-review) ou encore lors des conférences internationales.
Or, depuis quelques années, on observe une tendance à amener cette critique mutuelle sur la place publique. Et la pandémie que nous vivons a encore amplifié le phénomène.
Certes, il est important que les chercheurs communiquent sur leurs recherches. Surtout sur des sujets d’actualités comme par exemple le changement climatique, la pollution ou encore le Covid-19. D’ailleurs je serais assez mal placée pour critiquer cette communication grand public tenant moi-même ce blog.
Mais je pense qu’il est nécessaire d’être très clairs sur les limites de nos recherches…qui n’ont pas réponse à tout.
Un bon exemple pour moi sont les modèles. J’utilise des modèles pour prédire le risque que présente les substances chimiques sur les écosystèmes.
Or les statisticiens ont l’habitude de dire que « tous les modèles sont faux ». Une citation attribuée à Georges Box. Qui rajouterait: « mais certains sont utiles ».
Il me paraît donc extrêmement important, lorsque l’on montre les résultats d’un modèle, de bien définir les limites.
Un exemple issu de mes recherches.
Il est possible de prédire le risque que présentent les pesticides et les médicaments détectés dans le Léman comme on le lit sur la figure ci-dessous. Ce risque devrait est inférieur à 1 pour protéger l’écosystème lacustre.

Figure 1: Risque du mélange des pesticides et médicaments détectés dans le Léman de 2004 à 2011. Les pesticides nommés sont de source industrielle (Gregorio et Chèvre 2014).
On observe sur la figure ci-dessus que le risque dépasse fréquemment la valeur critique de 1. En conséquence, le mélange pesticides/médicaments pourrait avoir un impact sur l’écosystème du Léman. Ce risque est principalement dû à 4 herbicides, de source majoritairement industrielle. Il a diminué lorsque les industries ont réduit leurs rejets dès 2006 pour passer sous la valeur de 1, à l’exception de 2011 où un rejet industriel a eu lieu.
Cependant il faut mentionner que:
1) les valeurs d’effets utilisées pour les calculs se basent sur des espèces de laboratoire,
2) seules les substances déjà recherchées dans le Léman ont été prises en compte (il y a en a bien d’autres).
Ces deux points montrent que nos résultats sous-estiment certainement le risque.
Mais:
3) le modèle utilisé pour le calcul de risque du mélange est une modèle qui décrit le « pire » scénario.
Ce point montre que nos résultats sur-estiment certainement le risque.
La conclusion de tout cela n’est pas, pour moi, que les modèles sont inutiles. Ils peuvent nous aider à comprendre l’impact de la pollution sur l’environnement, dans les limites de ce qu’on peut leur faire dire.
La confiance en la science semble avoir diminué ces dernières années (Langan et al. 2019). Il semble donc crucial que les chercheurs et chercheuses communiquent sur leurs résultats. Mais il me semble tout aussi crucial de communiquer sur les limites des recherches, de même que sur les débats ou les controverses, qui peuvent avoir lieu sur ces recherches.
Références:
Fisch F. 2021. La critique mutuelle est nécessaire. Horizons. Le magazine suisse de la recherche. No 129.
Gregorio V, Chèvre N. 2014. Assessing the risks posed by mixtures of chemicals in freshwater environments. Case study of Lake Geneva, Switzerland. Wires Water: doi: 10.1002/wat2.1018
Langan et al. 2019. Empirically Supported Out‐of‐the‐Box Strategies for science communication by environmental scientists. Integrated Environmental Assessment and Management 15: 499-504.
Seemann-Ricard J. 2021. Risk assessment of pesticides for amphibians in temporary ponds. The cases of Lavigny and Mollens, Switzerland. Travail de Master en Sciences de l’Environnement. Université de Genève.
PE pour Perturbateur Endocrinien
J’ai reçu passablement de questions suite à mon dernier post « Tous perturbés« .
En effet, les mots « perturbateurs endocriniens » inquiètent. C’est normal. On pense immédiatement au changement de sexe des poissons ou à la baisse de la fertilité masculine.
Or il faut bien admettre que si les termes « perturbateurs endocriniens » sont largement utilisés dans la presse et par le public, les scientifiques ne sont pas vraiment d’accord sur ce qu’est un perturbateur endocrinien.
Bien sûr, il y a l’exemple bien connu de l’ethynylestradiol contenue dans les pilules contraceptives. Cette hormone féminine de synthèse a été un des premier exemple concret de perturbation hormonale dans l’environnement. A des concentrations aussi faibles que quelques ng/l, cette substance est capable d’inhiber le développement de caractéristiques mâles chez les poissons.
Cet effet est de type « clé-serrure ». C’est-à-dire que l’hormone de synthèse va se lier aux récepteurs à oestogènes et induire un effet hormonal. C’est d’ailleurs ce que l’on attend de la pilule contraceptive qui va bloquer l’ovulation.
Mais c’est un effet indésiré chez le poisson mâle. Car là aussi, l’hormone synthétique va se lier à des récepteurs « féminins » et empêcher le développement des caractéristiques masculines.
Cependant, le système hormonal est bien plus complexe qu’un système clé-serrure.
Il y a d’abord une multitude d’hormones. On connaît les hormones sexuelles, oestrogènes, progestérone, testostérone. Mais il y a aussi les hormones tyroïdiennes, essentielles pour la croissance, l’adrénaline et le cortisol qui interviennent en cas de stress, la dopamine, l’hormone du plaisir, etc…
Il y aussi une multitude d’organes et de glandes qui s’occupent de créer, véhiculer, transcrire ou éliminer ces hormones. L’hypothalamus, la tyroïde, les surrénales, les ovaires et les testicules, pour ne citer qu’eux.
A ce stade, difficile de donner une définition d’un perturbateur hormonal. Est-ce une substance qui va agir sur un organe, qui produira alors plus, ou moins, d’hormones? Est-ce une substance qui va empêcher les hormones d’agir?
Tout récemment, un groupes d’experts en endocrinologie issus de différents pays européens, asiatiques et américains, ont publié une liste de 10 critères pour caractériser les perturbateurs endocriniens. De manière similaire à ce qui se fait pour définir des substances cancérigènes.
Les voici:
1.La substance interagit avec ou active un récepteur hormonal. C’est le système clé-serrure décrit ci-dessus. Il est bien connu pour les substances qui miment les oestrogènes (phtalates, bisphénol A) ou la testostérone. Il y a beaucoup moins de recherche, si ce n’est pas du tout pour les autres hormones.
2. La substance empêche l’hormone d’interagir avec le récepteur. Certains médicaments jouent ce rôle dans le cas de cancers hormono-dépendants. Comme le tamoxifen. Il bloque les récepteurs aux oestrogènes dans le cas de certains cancer du sein.
3. La substance altère l’expression des récepteurs hormonaux. L’hormone se fixe bien au récepteur, mais rien ne se passe. Il semble que certains phtalates ou que le bisphenol A puisse avoir ce mode d’action.
4. La substance altère la chaîne de transmission. Le signal est bien donné par le récepteur, mais il est bloqué quelque part. A nouveau, il semble que le bisphenol A engendre ce mode d’action. A ce propos, il faut noter qu’une substance peut agir à différents niveaux et donc remplir plusieurs critères de la liste.
5. La substance induit des modifications épigénétiques. Au contraire d’une substance cancérigène, elle ne modifie pas les gènes, mais leur expression. Cette modification peut être transitoire, mais peut aussi se transmettre de la mère à l’enfant. C’est un phénomène naturel qui permet aux individus de s’adapter rapidement à leur environnement.
L’exemple le plus connu d’effet épigénétique « toxique » a été observé avec le distilbène. Ce médicament a été donné à de nombreuses femmes enceintes pour éviter les fausses-couches pendant la grossesse dans les années 1960/70. Il s’est avéré que les filles de ces femmes ont développé des malformations utérines et que beaucoup étaient stériles. S’il semble que cet effet distilbène s’efface à la troisième génération (actuellement adulte), il semble que d’autres types de malformations, par exemple cardiaques, aient été observées chez cette troisième génération.
Floriane Tisserand, doctorante dans notre laboratoire, travaille sur l’effet épigénétique d’un insecticide, le diazinon, sur les daphnies, des microcrustacés d’eau douce. Elle expose 3 générations de daphnies à cet insecticide à différents stades d’évolution. Les expériences sont en cours. Je vous en reparlerai à l’occasion.
6. La substance altère la synthèse des hormones. Dans ce cas, la synthèse de l’hormone ne se fait pas correctement ou pas du tout. C’est l’effet du perchlorate, un sel utilisé pour de nombreux usages, comme les explosifs et les munitions, et que l’on retrouve un peu partout dans l’environnement. Notamment dans les eaux. Il agit sur la synthèse des hormones tyroïdiennes.
7. La substance altère le transport des hormones au travers des membranes cellulaires. Certaines hormones comme les hormones « sexuelles » sont lipophiles et donc traversent les membranes de manière passives. D’autres ont besoin d’être aidées. Il semble ainsi que l’anti-corrosif imidazoline joue un rôle sur le transport de l’insuline.
8. La substance altère la distribution ou la circulation des hormones. Le bisphenol A, encore lui, réduit la circulation de la testostérone chez les rats mâles, de même que l’insecticide malathion. Un organophosphoré de la même famille que le diazinon que nous étudions au niveau de l’épigénétique.
9. La substance altère le métabolisme des hormones et leur destruction. Car il faut bien sûr que les hormones soient éliminées après avoir agit dans l’organisme. Sinon celui-ci serait sur-stimulé. Mais il ne faut pas non plus qu’elles soient éliminées trop rapidement. De nombreuses substances ont ce mode d’action, notamment certains PCBs.
10. Enfin, la substance altère le comportement des cellules qui produisent ou répondent aux hormones. Ainsi, l’oxybenzone, un filtre chimique anti-UV que l’on trouve dans de nombreux cosmétiques, augmente la production de cellules mammaires chez les souris portantes ou allaitantes. Et ceci encore de nombreuses semaines après l’exposition.
Nous sommes arrivés au bout de cette longue liste. Bravo à ceux qui ne sont pas découragés.
On constate donc que les mécanismes d’action des perturbateurs endocriniens sont complexes. Et que de nombreux perturbateurs endocriniens n’ont certainement pas encore été identifiés.
Tout récemment, au début de cette année, des auteurs ont montré sur la base d’une revue de littérature que l’herbicide glyphosate remplissait 8 des 10 critères mentionnés. Et devrait donc être classé comme perturbateur endocrinien au côté du bisphénol A, des phtalates, des PCBs, etc.
Mais tous ces critères sont définis pour l’être humain. Et s’ils peuvent s’appliquer pour les vertébrés, ce n’est pas le cas pour les invertébrés ou pour les plantes.
Ainsi les daphnies, les microcrustacés sur lesquels travaillent Floriane Tisserand, ont des pseudo-hormones. Qui n’ont pas la même sensibilité que les hormones humaines. Ce ne sont pas les mêmes récepteurs, ni les mêmes hormones.
De plus, de nombreuses espèces de l’environnement émettent des kairomones. Ces composés, émis dans l’air, dans l’eau, ou le sol, transmettent des informations entre individus de même espèce, ou de différentes espèces. Par exemple des informations sur un prédateur ou une proie. Chez la daphnie, les kairomones peuvent induire des effets sur la croissance ou même la reproduction.
C’est d’ailleurs ce type d’hormones qui sont utilisées dans la lutte par confusion en agriculture bio et non bio. Des hormones synthétiques sont diffusées pour que les insectes mâles ne trouvent pas les femelles. A ma connaissance, il n’y a pas d’études sur les insectes non cibles.
On est donc bien loin d’avoir compris les effets endocriniens que peuvent engendrer les substances chimiques sur les espèces de l’environnement, inclus l’être humain.
Je vais donc finir ce post de la même manière que beaucoup de précédents. Dans le doute et au vu du peu de connaissances que l’on a, il est vraiment important de réduire l’émission des substances chimiques dans l’environnement. Et donc l’exposition aux substances chimiques des espèces vivantes.
Cela passe par des aspects technologiques (traitement des effluents de station d’épuration), des gestes au quotidien (utilisation des cosmétiques, des désinfectants). Mais surtout par des décisions politiques fortes. Par exemple la mise en place d’une réglementation forte lors de la mise sur le marché des substances chimiques, mais également flexibles pour les retirer dès que nécessaire.
Référence:
Merrill et al. 2020. Consensus on the key characteristics of endocrine-disrupting chemicals as a basis for hazard identification. Nature Reviews, endocrinology. 16 (45-57). https://www.nature.com/articles/s41574-019-0273-8
Munoz et al. 2021. Glyphosate and the key characteristics of an endocrine disruptor: a review. Chemosphere 270. doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.128619
Tous perturbés?
La semaine dernière, une étude menée conjointement par la RTS et le magazine Bon à Savoir, montrait que les enfants romands étaient largement contaminés par des perturbateurs endocriniens.
Cette étude est un coup de sonde. L’urine de 33 petits et jeunes romands a été analysée pour y chercher différents composés dont le bisphénol A ou les phtalates.
Sans surprise, tous les enfants avaient des taux plus ou moins élevés de perturbateurs endocriniens dans leur urine. Et nul doute qu’il en irait de même si on analysait notre propre urine.
Cela confirme une fois de plus que nous baignons dans une soupe chimique. Et que les substances auxquelles nous sommes exposés quotidiennement peuvent entrer dans notre corps, que ce soit par notre alimentation, par la respiration ou par la peau.
Mais revenons un peu en arrière. Que sont ces fameux perturbateurs endocriniens?
Cette notion est apparue pour la première fois au début des années 1990. C’est la chercheuse Theo Colburn qui met en lumière ces substances qui perturbent le fonctionnement du système hormonal.
Certes, les substances elles-mêmes ne sont pas nouvelles. Par exemple le fameux DDT, l’insecticide qui a fait l’objet du livre Silent Spring de Rachel Carson, en fait partie. En 1990, il est déjà interdit dans les pays occidentaux.
Mais ce que montre Theo Colburn, et les chercheurs de l’époque, c’est que ces substances peuvent mimer les hormones. En clair, elles prennent leur place et induisent des effets « non voulu » par le corps lui-même.
Exposés à des stades clés de développement, par exemple pendant la phase de différentiation sexuelle lors de la gestation, les individus peuvent développer des caractéristiques à la fois mâles et femelles. Cela a été montré notamment chez les poissons.
Les perturbateurs endocriniens peuvent agir comme des hormones sexuelles, mais également comme des hormones tyroïdiennes. Ou encore ils peuvent avoir une action sur différentes glandes à l’origine de la production d’hormones, réduisant ou augmentant leur production.
En 1996, Theo Colburn va en faire un livre, « Our stolen future » (notre futur volé), qui pose notamment la question des effets sur la fertilité humaine, à long terme, de ces fameux perturbateurs endocriniens.
Car ce que remettent aussi en question ces substances, c’est le principe de Paracelse.
Depuis le début des études toxicologiques, les chercheurs sont partis de l’hypothèse que la dose faisait le poison. Le fameux principe de Paracelse. En clair, plus l’exposition de l’individu est élevée, plus l’effet est important.
Or les perturbateurs endocriniens bousculent cette hypothèse. Il semble en effet qu’ils puissent exercer des effets toxiques à de très faibles doses. Parfois même les effets à très faibles doses sont plus importants que ceux observés à une dose plus élevée. La dose ne fait plus le poison.
La conséquence de cette observation, c’est qu’il n’est plus possible de fixer des valeurs seuils en dessous desquels l’exposition est dite sans effets. Et donc que toute exposition à des perturbateurs endocriniens peut être problématique.
En continuant ce raisonnement, cela signifie que les substances reconnues comme perturbateurs endocriniens doivent être interdites.
Pas si simple.
D’abord, les agences gouvernementales semblent peu enclines à reconnaître cette nouvelle relation entre la dose et les effets. Ainsi au début du mois de février 2021, l’Endocrine Society, qui regroupe 18’000 spécialistes du système hormonal, critique sévèrement l’EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments) pour la non prise en compte de cette relation dans un projet de rapport sur les substances chimiques (via Le Monde).
Ensuite la définition des perturbateurs endocriniens fait débat. Après plus de 10 ans de tergiversations, l’Union européenne accouche enfin d’une définition en 2017.
Reste que cette définition est très contraignante. En effet, pour être déclaré « perturbateur endocrinien », il faudra démontrer, entre autre, que la substance a un mode d’action qui altère une ou des fonctions du système hormonal. Mais surtout, il faudra démontrer que les effet toxiques observés à l’échelle de l’individu sont une conséquence directe de ce mode d’action.
Or il est très compliqué de faire un lien entre le mode d’action (par exemple la liaison de la substance avec un récepteur hormonal) et des effets observés (par exemple une baisse de la fertilité). Ce qui laisse la place ouverte aux controverses.
De plus cette définition ne considère que l’être humain, et non les espèces de l’environnement.
On est donc bien loin d’avoir des outils pour légiférer sur les perturbateurs endocriniens.
Alors que faire?
Comme déjà mentionné plusieurs fois, si on ne peut échapper aux substances chimiques, on peut cependant tenter de diminuer son exposition. En faisant attention à son alimentation, aux cosmétiques utilisés, aux détergents, etc…
L’émission « On en parle » a consacré son guichet de mercredi 10 février aux questions des parents dont les enfants ont été testés. Avec des pistes de solutions.
Reste que le citoyen lambda, vous, moi, ne pouvons pas faire grand chose pour éviter l’exposition via notre veste, traitée avec des perfluorés, ou notre canapé, traité avec des retardateurs de flamme organophosphates. Ces traitements ne sont pas déclarés.
Il faudrait donc faire des choix politiques forts pour avancer dans ce domaine.
Peut-être une bonne nouvelle? L’Union européenne, dans sa stratégie pour un monde sans pollution chimique, semble décidée à s’attaquer aux perturbateurs endocriniens.
Dossier à suivre.
La curiosité des grenouilles
L’écotoxicologie est une discipline relativement récente. Les premiers tests d’écotoxicité datent des années 1970. Il y a donc un peu plus de 50 ans de développements méthodologiques. Ce qui est finalement très peu si on veut tenter de caractériser les risques que présentent les substances chimiques pour toutes les espèces de l’environnement.
Dans un premier temps, l’écotoxicologie s’est inspirée de sa grande sœur, la toxicologie, qui se focalise sur l’être humain.
Ainsi les tests développés et appliqués pendant des années se concentraient sur des effets comme la mortalité ou encore la reproduction, voir la croissance des individus.
Cependant, certaines études ont montré que ces paramètres n’étaient pas suffisants pour décrire les effets complexes des polluants.
Ainsi, des chercheurs ont mis en évidence que le cuivre pouvait affecter le système olfactif des poissons à des concentrations que l’on peut détecter dans l’environnement. Ils font l’hypothèse que cette perturbation de leur odorat pourrait empêcher ces poissons de reconnaître leur prédateurs.
Cela paraît anodin, mais si les poissons ne reconnaissent plus leurs ennemis, ils se feront alors tuer plus facilement, ce qui peut amener à des diminutions drastiques de certaines populations.
Cet exemple montre que s’intéresser à la survie ou à la reproduction d’une espèce sous l’influence d’une substance toxique ne suffit pas.
Mais pour bien choisir les paramètres à étudier, il faut connaître les stratégies de survie et de reproduction des espèces. Ce que l’on appelle les traits de vie biologiques. Parmi eux, la manière de se nourrir.
Ainsi certains essais focalisent sur la vitesse d’alimentation des gammares, ces petites sentinelles des cours d’eau. D’ailleurs déclarés « Animal de l’année 2021 » par Pro Natura. Ce paramètre, très sensible, peut même être mesuré avec des individus exposés dans des cages pour évaluer les effets de la pollution sur le terrain.
Trouver les bons paramètres à mesurer implique de se rapprocher de l’écologie, la science qui étudie les interactions entre les espèces et leur milieu.
Si pendant longtemps, écotoxicologie et écologie se sont ignorées, des rapprochements commencent à se faire.
Dans notre laboratoire, nous nous intéressons par exemple aux grenouilles.
Selon l’IUCN, 40% des amphibiens sont sur liste rouge, menacés d’extinction, soit bien plus que les mammifères.
Différents facteurs expliquent cet état de fait: l’anthropisation des milieux, les changements climatiques, mais également les substances chimiques comme les pesticides ou les antibiotiques que l’on trouvent dans les milieux humides.
Les amphibiens, comme les grenouilles, ont une peau très perméable qui les rend sensibles aux polluants. D’autre part, de par leur mode de vie, ils sont exposés dans l’eau pendant la phase larvaire, puis par l’air et le sol pendant la phase adulte.
Pour que les populations de grenouilles puissent se développer, les individus doivent être capables de se disperser sur le territoire, afin d’aller chercher de la nourriture, de se reproduire et de pondre. Mais le but le plus important de cette dispersion est, selon les écologues, d’augmenter le flux de gènes. C’est-à-dire d’éviter la consanguinité et d’augmenter la diversité génétique, afin d’augmenter la capacité de réponse aux stress environnementaux (prédation, changements climatiques, perte de l’habitat, pollution). Enfin, cette dispersion permet aussi de coloniser de nouveaux milieux.
Cette capacité de dispersion est donc un paramètre très important pour la survie des espèces.
Les écologues ont défini un paramètre permettant de mesurer cette dispersion, la « curiosité » ou la « hardiesse ». Plus un individu est curieux/hardi, plus il aura tendance à partir loin de son lieu de naissance et donc plus grande sera la chance qu’il puisse trouver un partenaire génétiquement différent.
Cette curiosité peut se tester en laboratoire.
On crée une arène avec une petite chambre fermée en son centre. On place la petite grenouille dans la chambre pendant quelques minutes. Puis on ouvre la chambre.
Le comportement de la grenouille est ensuite filmé. On regarde ainsi le temps avant que la grenouille ne bouge, la distance parcourue dans l’arène, ou la surface couverte pendant un certain laps de temps.
On peut ensuite comparer le comportement de grenouilles qui ont été exposées à une ou des substances chimiques, avec celui de grenouilles non exposées. Cette comparaison permettra de mettre en évidence un effet négatif du/des polluants, si il existe.
Beaucoup plus sensibles que des tests sur la survie ou la reproduction, ces essais peuvent être effectués avec des concentrations environnementales. En effet, les tests classiques, sur la survie ou la reproduction, nécessitent souvent, pour voir des effets, d’utiliser des concentrations élevées, bien au dessus de celles que l’on détecte dans l’environnement.
Ces recherches, à l’interface entre l’écologie et l’écotoxicologie, sont donc particulièrement importantes pour mieux définir les risques des substances chimiques, et finalement définir des normes environnementales.
Merci à Laurent Boualit, doctorant dans notre labo, pour sa relecture attentive et pour m’avoir fait mieux connaître les amphibiens.
Références:
Agatz A, Brown CD. 2014. Variability in feeding of Gammarus pulex: moving towards a more standardised feeding assay. Environmental Science Europe 26: 15.
Beyers DW, Farmer MS. 2001. Effects of copper on olfaction of colorado pikeminnow. Environmental Toxicology and Chemistry 20. 907-912.
Une désinfection sans risque?
La désinfection des mains fait partie des gestes barrières dans la protection contre la pandémie actuelle. Le but n’est pas ici de remettre en cause ce principe que j’applique moi-même chez nous lors de chaque maladie (gastro, grippe ou autre).
Par contre j’aimerais discuter des désinfectants qui peuvent être utilisés. Et des risques que certains peuvent poser.
Mais d’abord à quoi cela sert-il d’en utiliser?
Un désinfectant sert à détruire les pathogènes: virus et bactéries principalement.
De loin, les bactéries sont les plus difficiles à éliminer. Elles sont capables de développer tout une série de mécanismes pour s’adapter et devenir résistantes à une ou plusieurs substances chimiques. Et donc avec le temps, ces substances ne sont plus efficaces.
C’est le problème de plus en plus d’antiobiotiques. De nombreuses bactéries sont devenues multi-résistantes et il n’y a plus beaucoup de médicaments qui peuvent venir à bout de certaines souches d’Escherichia coli ou de staphylocoque doré. L’OMS parle de l’entrée dans une ère post-antibiotiques.
Les désinfectants utilisés pour combattre les bactéries doivent donc contenir des substances chimiques très efficaces, voir il doivent les combiner.
Pour éliminer un virus, tel que le Covid 19, c’est plus simple. Il s’agit de dissoudre la couche de graisse qui le protège. Ce pourquoi un bon lavage des mains avec un savon gras est suffisant. L’alcool est également efficace.
Malheureusement, les désinfectants que l’on trouve sur le marché ne sont pas dédiés uniquement à la lutte contre les virus. Ils contiennent donc fréquemment des substances très puissantes dont les effets sur l’homme et sur l’environnement ne sont pas anodins. Surtout si ils sont utilisés très fréquemment comme actuellement.
Voici deux exemples.
Prenons d’abord la familles des sels d’ammoniums quaternaires. Ils sont beaucoup utilisés comme tensioactifs, mais également comme biocides désinfectants.
Certaines molécules contiennent du chlore, comme le chlorure de benzalkonium (ADBCA). Bactéricide, il a également une activité spermicide, ce qui fait qu’il est utilisé dans certaines crèmes contraceptives.
Un petit tour dans les commerces environnants m’a montré que beaucoup de désinfectants proposés à l’entrée des magasins contiennent du chlorure de didecyldimethylammonium (DDAC), un autre de ces sels, toujours chloré.
Or les sels d’ammoniums quaternaires sont sous la loupe des chercheurs depuis quelques années déjà. On les soupçonne fortement d’être des perturbateurs hormonaux. En 2014, des chercheurs de Virigina Tech montrent que la fertilité des souris est affectée par l’ADBCA et le DDCA. Trois ans plus tard, la même équipe montre que ces substances provoquent des malformations chez les bébés souris.
C’est inquiétant. D’autant que leur utilisation augmente. C’était déjà le cas avant la pandémie, puisque les sels d’ammoniums quaternaires ont remplacé, dans les cosmétiques, une autre substance problématique, le triclosan (nous y reviendrons).
Mais ces sels sont encore beaucoup plus utilisés depuis mars 2020.
Une étude menée en 2020 par l’Université de l’Indiana aux Etats-Unis a analysé la poussière d’appartements dans lequels une désinfection plus ou moins poussée était effectuée. La quantité de sels d’ammoniums quaternaires était proportionnelle à leur utilisation. Avec une médiane de 1300 ng/g de poussière (somme de 18 sels communément utilisés). Les plus hautes concentrations se trouvant dans les appartements « les plus désinfectés ».
Or la poussière est une voie non négligeable d’exposition chez l’homme. Notamment pour les petits enfants qui sont souvent au niveau du sol.
Autre molécule. Je vous ai parlé plus haut d’un autre biocide, le triclosan. Il s’agit d’un organochloré, comme le DDT qui a fait l’objet du livre de Rachel Carson et qui a conduit aux premières réglementations sur les pesticides.
En 2017, le Temps titrait sur les dangers du triclosan. Perturbateur endocrinien, il est également mis en cause dans les cas d’inflammation du côlon pouvant déboucher sur des cancers.
Alors que son usage était en diminution, le triclosan est revenu en force avec la pandémie. Certains produits contiennent jusqu’à 10mg/ml de triclosan, mais ils devraient être réservés à un usage médical.
C’est d’ailleurs un des problème. Des produits à usages médicaux se retrouvent à être utilisés au quotidien par tout un chacun. Qui n’est pas forcément au fait des risques que ces substances peuvent poser pour la santé.
Et l’environnement dans tout cela?
Toutes les substances que nous appliquons sur la peau ou sur les surfaces finiront dans l’air ou dans l’eau. Il serait donc intéressant de monitorer le triclosan ou les sels d’ammoniums quaternaires dans les eaux usées pour voir si leurs concentrations ont augmenté depuis les derniers mois.
Pour l’instant je n’ai pas vu d’études dans ce sens.
En terme de risque, ces substances présentent les mêmes dangers pour les espèces de l’environnement, notamment les vertébrés, que pour la santé humaine. S’agissant de perturbateurs hormonaux, ils peuvent avoir des effets sur la fertilité.
Alors que faire? D’un côté on nous recommande fortement de nous désinfecter les mains fréquemment, et d’un autre côté, beaucoup de produits désinfectants contiennent des substances qui ne sont pas sans danger pour la santé et l’environnement, à long-terme.
Personnellement, j’ai choisi de me laver les main avec un savon gras simple si c’est possible. Si ce n’est pas possible, j’ai toujours un flacon de désinfectant simple, à base d’alcool, que j’utilise lorsque je dois désinfecter mes mains ou celles de mon fils.
Je pense cependant qu’il faudrait des règles beaucoup plus claires sur les désinfectants à usage régulier, notamment pour ceux qui sont utilisés dans les écoles et dans les crèches.
Des désinfectants sans substances problématiques existent. Ils devraient être privilégiés dans les lieux qui accueillent des personnes sensibles comme les enfants. Il en va pour moi de leur santé à long-terme.
Et l’environnement s’en portera également mieux.
Référence:
Zheng G. 2020. Indoor exposure to desinfecting chemicals during the Covid-19 pandemic. Remote SETAC Conference USA.
L’Europe annonce son ambition d’un monde « sans pollution chimique »
C’est une nouvelle qui est passée complètement inaperçue. Et pourtant, c’est une bonne nouvelle!
Le 14 octobre, la Commission européenne a adopté une nouvelle stratégie pour tendre vers un environnement exempt de substances chimiques.
Plus concrètement cette stratégie « stimulera l’innovation en faveur de produits chimiques plus sûrs et plus durables et renforcera la protection de la santé humaine et de l’environnement contre les produits chimiques dangereux. Elle prévoit notamment d’interdire l’utilisation des produits chimiques les plus nocifs dans les produits de consommation tels que les jouets, les articles de puériculture, les cosmétiques, les détergents, les matériaux en contact avec des denrées alimentaires et les textiles, sauf s’ils se révèlent essentiels pour la société, et de veiller à ce que tous les produits chimiques soient utilisés de manière plus sûre et plus durable ».
Certes, il s’agira maintenant de mettre en place des outils concrets et pratiques pour atteindre le but affiché. Mais néanmoins l’ambition est là.
De plus, la Commission européenne reconnaît l’effet des mélanges et déclare qu’il doit être considéré comme tel. Après 20 ans de tergiversations autour de sa prise en compte dans les législations, il est grand temps.
En 2006 déjà, l’Union européenne révolutionne la mise sur le marché des substances chimiques en imposant aux producteurs d’évaluer le risque, humain et environnemental, des substances chimiques qu’ils mettent sur le marché.
Cette démarche inverse le fardeau de la preuve. Ce n’est plus au scientifique de prouver, après coup, qu’une substance est à risque. C’est le producteur qui doit montrer qu’elle ne l’est pas.
C’est la directive REACH.
Ce fût un travail titanesque puisque 30’000 substances, sur les 120’000 sur le marché en Europe, devaient être ainsi évaluées.
Malheureusement, 14 ans après, force est de constater que REACH n’a que partiellement atteint son but.
Comme je l’avait écrit en juillet 2019, les données fournies par les industries sont souvent incomplètes, voir incorrectes. De plus, certains industriels ont réussi à contourner la directive et à laisser sur le marché des substances problématiques, sur la base du principe d’exception. Vous pouvez lire à ce propos l’excellent livre d’Henri Boullier « Toxiques Légaux » (ou voir son interview).
Avec cette nouvelle stratégie, la Commission européenne remet l’ouvrage sur le métier.
En effet, selon les chiffres publiés par le Monde, « 300 millions de tonnes de substances chimiques sont produites en Europe chaque année, dont 74% sont considérées comme dangereuses pour la santé et/ou l’environnement par l’Agence européenne de l’environnement ». Ce sont les phtalates, parabènes, bisphénol-A, etc.
Espérons donc que la Commission se donnera les moyens de ses ambitions.
D’autant qu’avant son annonce, cette stratégie a fait l’objet d’intenses débats.
Sans étonnamment, c’est la Direction générale du marché intérieur et de l’industrie qui s’y est le plus fermement opposée. Il faut dire que l’industrie chimique est la quatrième plus grande industrie de l’Europe et qu’elle emploie 1.2 millions de personnes.
Mais plus bizarrement, la Direction générale de la Santé était également fortement opposée à cette stratégie.
Selon l’ONG Bureau européen de l’environnement, rapporté dans Actu Environnement, « une relation malsaine entre la DG santé et la direction générale en charge de l’industrie a été encouragée par l’ancien patron de la Commission Jean-Claude Juncker qui a subordonné la première à la seconde ».
C’est donc une affaire à suivre.
Si on revient à la stratégie elle-même, un point est intéressant. L’idée est promouvoir des substances chimiques plus sûres dès la conception. Ou plus clairement, de prendre en compte tout le cycle de vie de la molécule, de sa conception à sa dégradation. C’est le concept de « chimie verte« , qui a été beaucoup discuté au tournant de siècle, mais qui n’a été que très peu appliqué.
Et la Suisse dans tout cela?
Comme nous ne faisons pas partie de l’Europe politique, rien ne nous contraint à adopter la même stratégie.
Les exemples du passé nous montre que nous sommes en général observateurs. Nous ne prenons, dans nos législations, que très partiellement les nouvelles réglementations européennes sur les substances chimiques. Ou alors tardivement.
Un exemple. Alors que l’Union européenne a interdit le bisphenol-A dans les biberons en polycarbonate dès 2011, la Suisse a attendu 2017.
Autre exemple, le dioxyde de titane (E171) est interdit depuis janvier 2020 en France comme additif alimentaire, et les députés européens se mobilisent pour faire de même en Europe. Mais ce n’est pas un débat en Suisse.
Espérons cependant que l’ambition de l’Union européenne d’un monde « sans pollution chimique » puisse inspirer la Suisse.
La généalogie des substances chimiques
Depuis plus d’une année, les journaux parlent régulièrement du chlorothalonil, un fongicide classé « peut-être cancérigène » par le Centre international de recherche sur le cancer.
Malgré que de multiples sources d’eau soient polluées en Suisse, l’eau potable ne présente pas forcément de risque pour la santé. C’est le sens du message du Conseil fédéral du 14 septembre 2020: « Un dépassement de la concentration maximale autorisée en métabolites du chlorothalonil ne représente pas de danger imminent pour la santé. Il s’agit surtout de respecter la valeur maximale afin de garantir à titre préventif la protection de la santé. »
C’est à y perdre son latin. Pourquoi donc le risque serait-il minime alors même que les dépassements de la norme sont importants?
En fait, ce n’est pas le chlorothalonil qui pose problème dans les sources d’eau potable, mais ses métabolites. En effet, l’Office fédérale de la Santé Publique a décidé de classer ces métabolites comme « pertinentes » en 2019.
Qu’est-ce que cela veut dire?
Comme le chlorothalonil est peut-être cancérigène, on ne peut pas exclure que ses métabolites ne le soient pas. Et donc, les sources où elles dépassent la norme de 0.1 microgramme par litre, fixée pour l’eau potable, doivent être soit fermées, soit l’eau doit être diluée.
Le chlorothalonil lui-même ne dépasse pas les normes.
Si on feuillette la dernière édition du « Statistique de poche » publié par l’Office Fédérale de la Statistique, on s’aperçoit que le cas du chlorothalonil n’est pas unique. La grande majorité des substances détectées en lien avec l’agriculture sont des métabolites ou « produits de dégradation » (en bleu).

Figure 1: OFS. 2020.
Faut-il alors s’en inquiéter?
Revenons un peu en arrière pour bien comprendre ce qu’est une métabolite.
Les substances chimiques dont on entend parler: glyphosate, bisphenol A, chlorpyriphos, parabènes, sont ce que l’on appelle les substances actives. Ce sont elles qui vont donner au produit (pesticide, plastique, cosmétique, etc…) les propriétés que l’on recherche.
Mais une fois dans l’environnement, ces substances ne sont pas stables. Elles vont être modifiées. Par exemple sous l’effet des rayons UV du soleil ou en réagissant avec d’autres composés chimiques.
La dégradation la plus importante est liée à la métabolisation par les organismes vivants, notamment les bactéries.
Nous-même nous métabolisons les substances chimiques que nous ingérons. Ainsi certains médicaments ne sont présents sous forme « parente » qu’à 1 ou 2% dans les urines. Le reste l’est sous forme de métabolites. Chez nous, c’est principalement le foie qui fait ce travail.
En se transformant, les substances chimiques perdent des éléments. La molécule devient souvent de plus en plus simple.
De ce fait, plusieurs substances parentes peuvent donner les mêmes produits de dégradation. Ce qui rend le traçage difficile.
Une substance-mère peut donc donner naissance à 5, 10, voir 20 métabolites. Suivant les conditions environnementales, la biologie présente, etc. Il n’est donc pas étonnant que l’on détecte beaucoup plus de métabolites que de substances parentes.
La question qui se pose est de savoir si ces métabolites sont aussi toxiques que la substance initiale.
Et c’est là que les choses se corsent. Car comme souvent, les données d’écotoxicité et de toxicité manquent.
Souvent, les métabolites sont moins toxiques que les substances parentes. C’est le cas des substances de dégradation de l’atrazine, un herbicide du maïs interdit en Suisse.
Le schéma ci-après montre les chaînes de dégradation possibles en fonction des bactéries présentes. 9 métabolites sont possibles.
L’atrazine étant un inhibiteur de la photosynthèse, nous avons testé 4 métabolites principales sur la croissance des algues. Elles étaient 20 à 100 fois moins toxiques que l’atrazine lui-même.

Figure 2: Chaînes de dégradation possibles de l’atrazine (Eawag).
Mais parfois, la métabolite est plus toxique que la substance parente.
C’est le cas des nonylphénols.
Les nonylphénols polyéthoxylés sont largement utilisés comme tensioactifs dans l’industrie. Or dans l’environnement, ces longues chaînes de carbones se fragmentent pour donner des métabolites, les nonylphénols. Ceux-ci sont assez stables, mais surtout ils sont bioaccumulables et reprotoxiques. Ce qui a amené à leur interdiction en Europe dans les années 2000. Mais ils sont encore largement utilisés dans d’autres régions du monde.
En 2004, Boxall et ses collègues chercheurs ont fait le bilan de ce que l’on savait (et que l’on ne savait pas) sur les métabolites. Ils concluent du manque important de données existantes et donnent des pistes pour les recherches à mener dans le futur.
En particulier, il faudrait perfectionner les outils de tri existants pour mettre rapidement en évidence les métabolites qui pourraient être plus toxiques que les substances parentes. Par exemple sur la base d’un examen de la structure chimique.
Il faudrait aussi tester les effets des mélanges, sur le long terme, des substances parentes et des métabolites.
Plus de 15 ans après ce texte, la recherche n’a pas beaucoup avancé. Un de frein est la difficulté de prédire la dégradation des substances chimiques, dégradation qui dépend fortement des conditions environnementales et des microorganismes présents.
Il est aussi souvent impossible de se procurer les métabolites pour les tester. Elles n’existent pas sur le marché.
C’est un large pan des molécules chimiques présentes dans l’environnement qui est pour l’instant ignoré, tant au niveau du devenir que des effets toxiques.
Il est donc urgent de développer des méthodes fiables pour évaluer dans quelle mesure les métabolites, par exemple celles du chlorothalonil, sont réellement pertinentes!
Référence:
Boxall et al. 2004. When synthetic chemicals degrade in the environment. Environmental Science and Technology 38. 368A-375A.
Que se passe-t-il dans les cimetières?
Récemment, quelques articles discrets se sont fait l’écho d’un phénomène de plus en plus problématique: les corps ne se décomposent plus dans les cimetières.
Ou plutôt ils se décomposent beaucoup, beaucoup plus lentement qu’il y a 50 ans.
Au point que dans certains cimetières, on se voit dans l’obligation de créer des étages. En enterrant les corps d’abord très profonds. Puis en superposant les suivants. Dans d’autres cas, des sociétés proposent d’ajouter des substances chimiques pour accélérer la décomposition. Ce fût le cas en Norvège au début des années 2000.
Parmi les causes qui peuvent expliquer ce phénomène, deux d’entre elles ont retenu mon attention:
- la pollution des sols
- notre alimentation et notre médication
La décomposition dans les sols est principalement le fait des organismes vivants. Des bactéries et des champignons en premier lieu. Mais également des insectes et autres espèces présentes dans la terre.
Or de nombreuses substances chimiques peuvent ralentir l’activité de ces organismes. Elles peuvent même les détruire.
On pense bien sûr en premier lieu aux pesticides, substances développées pour avoir une action toxique sur les espèces considérées comme « nuisibles ».
Les cimetières sont de grands consommateurs de pesticides. Avant que la Ville de Lausanne ne devienne une ville sans pesticides, l’utilisation la plus importante était dans le cimetière du Bois-de-Vaux. Près de 700kg par an.
Les utilisations principales étaient le désherbage et la lutte contre les pucerons.
Un anecdote m’a été racontée par un jardinier: lors de l’arrêt de l’utilisation des pesticides, plusieurs personnes se sont plaintes de la qualité du sol dans les allées. Leur semelles y adhéraient. Pourquoi? Sans insecticides, les pucerons étaient revenus sur les tilleuls et les rosiers. Leur miellat tombait sur les dalles, les rendant collantes.
Un point intéressant à souligner, les cimetières entretenus « au naturel » sont devenus des zones de grande diversité biologique en ville.
Or malheureusement les pesticides reviennent dans les cimetières par la petite porte. En effet, depuis quelques années, le moustique tigre a fait son apparition en Suisse. Vecteur de maladies comme la dengue, il est surveillé de près par les biologistes et les autorités cantonales.
Il se reproduit dans les eaux stagnantes en quelques heures. Une coupelle d’eau suffit à son bonheur.
Les vases et autres soucoupes qui se trouvent dans les cimetières constituent un milieu de ponte très intéressant pour le moustique tigre. Ils sont changés de manière irrégulière et se remplissent d’eau à la moindre pluie.
D’aucuns proposent donc de traiter ces milieux avec des insecticides…un triste retour en arrière.
Un autre facteur pourrait également jouer un rôle dans le ralentissement de la décomposition des corps. Ce que notre corps contient au moment de la mise en bière.
En effet, tout au long de notre vie, nous consommons des aliments qui contiennent des conservateurs. Et nous utilisons de nombreux cosmétiques avec ces mêmes conservateurs. Ainsi les fameux parabènes que l’on trouve dans les crèmes, les shampoings, mais également dans les médicaments. Les E214 à E219.
Bien sûr, une partie de ces substances sont éliminées par le corps. Mais une petite partie peut aussi s’accumuler dans les graisses, les cheveux, les organes du corps.
Or ces conservateurs sont pour la plupart des bactéricides. Même si aucune étude n’a été menée sur le sujet, il ne serait pas surprenant que les bactéries du sol aient plus mal à décomposer des corps qui contiennent ce type de substances.
Autres composés problématiques, les médicaments. Et notamment les antibiotiques qui sont développés pour tuer les bactéries.
Une enquête suisse menée en 2017 montre qu’une personne sur deux prend des médicaments chaque semaine.
Selon cette étude: « le recours aux médicaments a nettement progressé au fil du temps: si, en 1992, 38% de la population âgée de 15 ans et plus consommaient au moins un médicament au cours d’une période de sept jours, cette part atteignait 50% en 2017. Les femmes prennent plus souvent des médicaments que les hommes (55% contre 45%). La part des personnes consommant des médicaments augmente avec l’âge et atteint 84% chez celles de 75 ans et plus ».
La quantité de médicaments ingérée est donc très importante chez les personnes âgées. Un directeur d’établissement médico-social me parlait de 5 à 10 substances par jour distribuées à ses pensionnaires.
On peut se demander si ce cocktail de médicaments ne pourrait pas jouer un rôle dans la plus longue conservation des corps dans les sols?
Certes, ce sujet peut prêter à sourire. On peut imaginer de futurs archéologues, dans 500 ou 1000 ans, découvrant des tombes pleines de momies. Et imaginant que nous avions, en 2020, des techniques de conservation très sophistiquées…
Mais au-delà de l’anecdote, je pense que cette observation faite dans les cimetières nous pousse à réfléchir aux effets sur notre santé des multiples substances chimiques que nous ingérons chaque jour.
Travaux de bachelor millésime 2020
Ce semestre de printemps 2020 fut spécial pour l’enseignement universitaire.
En effet, dès le 16 mars, les cours sont passés complètement en ligne, avec la difficulté que cela peut représenter pour les enseignants, mais également pour les étudiants.
Il a fallu très rapidement s’adapter à une autre manière d’enseigner et d’apprendre.
Pour ma part, je préfère enseigner en présentiel et discuter avec mes étudiants face-à-face. Mais cela n’a plus été possible.
J’avais donc de grandes inquiétudes pour le suivi des étudiants, notamment concernant les travaux de bachelor.
Dans notre Faculté, les travaux de bachelor sont effectués lors de la 3ème année d’étude et doivent être rendus avant la fin du semestre de printemps, soit début juin. Le travail s’étend donc sur une durée de 6 à 9 mois.
Il s’agit d’un travail personnel de l’étudiant qui montre ainsi sa capacité à mobiliser ses connaissances sur un sujet particulier, le plus souvent un sujet qu’il a lui-même choisi.
Il est donc important que l’étudiant puisse être encadré dans sa démarche, mais également qu’il puisse avoir accès à l’objet de son étude (terrain ou laboratoire) et aux ressources (littérature, rapports, personnes à interroger, etc).
Or entre mars et mai, cela fût très compliqué. Les laboratoires et les bibliothèques étaient fermés, le terrain interdit, et les personnes à interviewer souvent difficiles à joindre.
En résumé, les conditions n’étaient pas idéales pour effectuer un bon travail de bachelor.
Mes craintes ont rapidement été écartées en lisant les rapports des étudiants que j’ai suivi, tous de très bonne qualité. J’ai moi-même appris des choses intéressantes.
Deux étudiants se sont penchés sur la qualité de l’eau en macropolluants, soit phosphore et azote. Ces deux composés sont utilisés dans les engrais appliqués sur les champs et peuvent finir dans les eaux souterraines et dans les eaux de surface. On les trouve également dans les eaux usées. Régulièrement, l’azote, notamment sous forme ammoniacale, provoque des mortalité piscicoles. Ce fût le cas dans la Sonnaz (FR) en 2019. Cette rivière a reçu des résidus de méthanisation d’une usine de biogaz entrainant la mort de plus de 500 poissons. Le phosphore est lui responsable de l’eutrophisation des milieux aquatiques.
Ces deux composés sont donc importants à suivre dans les cours d’eau.
Christophe Reis s’est intéressé à la Baie de Clarens dont le bassin versant est mixte: il contient une zone forestière, une zone agricole et une zone urbaine. Christophe a trouvé que la qualité de l’eau se péjorait d’amont en aval, mais que les concentrations de phosphore et d’azote restaient bien en dessous des critères de qualité. La qualité de l’eau de la rivière, pour ces deux composés, était bonne à très bonne.
Christophe a également testé deux méthodes de mesure pour les analyses. Une méthode très simple, avec des bandelettes qui changent de couleur en fonction de la concentration, et une méthode plus sophistiquée, effectuée au laboratoire.
Malheureusement il s’est avéré que la méthode simple, que nous utilisons volontiers pour les visites grand public, ne donnait pas de résultats fiables.
Même constatation faite par Johan Guignet qui s’est intéressé à la Basse Venoge. Les bandelettes ne permettaient pas une interprétation scientifique précise.
Concernant cette rivière-là, Johan a constaté de nombreux déchets en aval de la station d’épuration de Bussigny. En temps pluie, des rejets d’eaux usées mélangées à des eaux de ruissellement peuvent se produire, entraînant une pollution du milieu naturel par des résidus divers et variés.
Un occasion de rappeler qu’aucun déchet solide (lingettes, masques, gants) ne doit finir dans les toilettes, ni sur la chaussée.
Raphaël Müller s’est quant-à lui intéressé à la pollution du Rhin. Bâle est une ville connue pour son industrie chimique et pharmaceutique et la question se posait de l’influence de cette production sur la qualité de l’eau du Rhin.
Beaucoup d’entre nous avons encore en mémoire les images de l’incendie de Schweizerhalle en novembre 1986. Des pesticides, entrainés par les eaux d’extinction, ont fini leur course dans le Rhin et ont tué toute la vie sur des centaines de kilomètres.
Dans son travail, basé sur des données collectées auprès du service de l’environnement du canton de Bâle, Raphaël a montré que la majorité des substances cherchées et détectées sont rejetées dans le Rhin par la station d’épuration de Bâle. Elles sont donc émises par nos activités quotidiennes, par exemple notre consommation de médicaments.
Pour quelques substances cependant, la source industrielle est prépondérante, ce qui rappelle l’importance de mettre en place un traitement des eaux industrielles résiduelles. Ce qui est encore trop rarement fait.
Dans un autre domaine, Justine Chaubert et Mathilde Ley se sont penchées sur l’histoire du Valais…et de ses pollutions.
Ce sont des travaux essentiellement bibliographiques, c’est-à-dire qu’elles ont compilé des rapports ou de la littérature existants.
Justine Chaubert s’est intéressée au mercure. Dès 1909, l’entreprise Lonza s’installe à Viège dans le but de produire des substances chimiques. Durant 40 ans, entre 1930 et 1970, Lonza va déverser des tonnes de ce métal dans le « Grossgrundkanal », polluant le Rhône, sa nappe et même le Léman.
Si les concentrations dans le Léman ont diminué suite à l’arrêt du rejet de ce métal, des concentrations très importantes ont été détectées dans les sols en Haut-Valais. Les coûts liés à l’assainissement des surfaces ont été estimé en 2017 à 51 millions de francs.
Mais une autre pollution, également liée à l’entreprise Lonza, a récemment défrayé la chronique. Mathilde Ley s’est ainsi penchée sur le cas de la benzidine, une substance cancérigène utilisée dans la synthèse de colorants. Cette substance est issue de la décharge de Gamsenried.
Cette décharge, située sur la commune de Brig-Glis, a été utilisée par Lonza de 1918 à 1978. Les déchets de l’usine étaient ainsi rejetés par une conduite directement dans la décharge. Parallèlement, 1.5 millions de m3 de chaux ont été déversés, pour stabiliser le tout. Le pH se situe donc actuellement entre 10 et 12; le milieu est fortement basique. A titre de comparaison, de pH d’une eau de surface est autour de 7.5.
Dès 2019, des concentrations élevées de benzidine sont mesurées dans la décharge et aux abords de celle-ci. Ceci est apparemment dû à une remontée de la nappe dans la décharge qui était auparavant confinée. Pour empêcher des inondations, l’eau de la décharge est pompée et rejetée dans le Rhône, diluant la benzidine dans le milieu naturel.
En février de cette année, on apprenait que les rejets d’eau pollués avec de la benzidine devrait être évités à l’avenir…affaire à suivre.
L’avant-dernier travail porte sur la pollution des eaux par les microplastiques. C’est également un travail bibliographique, appuyé par des interviews.
Vidhi Kamar conclut que peu d’études existent sur les microplastiques dans les eaux douces, comme les lacs et rivières suisses. Notamment parce que les approches pour effectuer les analyses ne sont pas encore bien établies. Et quasi aucune étude n’existe sur les risques des microplastiques sur le vivant.
Les dernières études en date montrent que les résidus de pneus seraient des sources non négligeables de pollution des eaux par les microplastiques…affaire à suivre également.
Le dernier travail, écrit par Marianne Violot, porte sur l’influence des lobby sur le monde agricole. Travail très compliqué à mener, considérant le manque de transparence sur le lobbying en Suisse.
Sur la base d’interviews, Marianne s’est également intéressée aux avantages, mais également aux problèmes liés à l’agriculture biologique. Elle a trouvé que même l’agriculture biologique peut être influencée par des lobbies.
J’ai retranscris ci-dessus ce que j’ai retenu de ces travaux. Mes propos n’engagent pas leurs auteurs.
Rapports de fin de cycle, les travaux de bachelor sont souvent assez fouillés. Et très régulièrement j’apprends des choses intéressantes grâce à eux. Parfois même cela me donne des idées de recherche pour le futur.
Malgré la période compliquée que nous avons traversée, les étudiants ont su se montrer consciencieux, inventifs et flexibles.
Bravo à ce millésime 2020!
Références:
Chaubert J. 2020. La pollution du Rhône par le mercure. Bachelor. Université de Lausanne.
Guignet J. La qualité chimique de l’eau de la Basse Venoge. Bachelor. Université de Lausanne.
Kamdar V. 2020. Evaluation des connaissances de la pollution plastique dans le Léman. Bachelor. Université de Lausanne.
Ley M. 2020. La benzidine et le Haut-Valais. Bachelor. Université de Lausanne.
Müller R. L’influence de Bâle en tant que ville industrielle chimique et pharmaceutique sur la pollution du Rhin. Bachelor. Université de Lausanne.
Reis C. 2020. L’impact de l’urbanisation sur un cours d’eau. Bachelor. Université de Lausanne.
Violot M. 2020. Transition en agriculture biologique: un monde agricole contraint par les lobbies agroalimentaires. Bachelor. Université de Lausanne.
Parlons d’un sujet qui fâche…l’expérimentation animale
Une chose me frappe pendant cette pandémie. Les tests sur les animaux ne sont plus tabous.
Des singes ont été infectés par le Covid pour évaluer leur immunité. Cela ne semble émouvoir personne alors que nous voterons prochainement à nouveau en Suisse sur une initiative contre l’expérimentation animale.
Soyons honnêtes, au cours du développement d’un médicament ou d’un vaccin, on procède à des tests sur les animaux.
Idem pour évaluer le risque des substances chimiques, que ce soit pour l’homme, ou pour les espèces de l’environnement.
Il existe certes des modèles, qui permettent de faire des prédictions quant à la toxicité ou l’écotoxicité d’une substance, mais ils ne permettent que de faire un tri. Les effets des polluants ne se laissent pas si facilement décrire.
D’ailleurs c’est un des reproche fait régulièrement aux tests d’écotoxicité effectués lors des procédures de mise sur le marché des substances chimiques. Ces tests ne sont pas assez réalistes et ne reflètent pas l’exposition « réelle », à long-terme des espèces vivantes.
Cette absence de réalisme a été particulièrement critiquée dans le cas des pesticides néonicotinoïdes et de leurs effets sur les abeilles. Les tests actuels étant des tests très courts, ils ne reflétent pas les effets d’une exposition à des faibles doses sur le long-terme.
Pour protéger les espèces de l’environnement, il est donc nécessaire de faire des tests d’écotoxicité sur des espèces de laboratoire.
Il n’y a cependant aucun plaisir à faire des expériences avec des animaux. C’est important de le souligner.
A la fin de ma thèse, j’ai remercié les centaines de daphnies, un microcrustacé, que j’avais exposées à un pesticide.
Ces tests d’écotoxicité ne sont cependant pas faits dans n’importe quelles conditions.
La Loi suisse sur la protection animale est la plus stricte au monde. Elle s’appuie sur les 3R (en anglais: Replacement, Reduction, Refinement), soit substituer avec des modèles si possible, réduire le nombre d’animaux testés et améliorer les conditions de tests.
Les photos montrant des souris ou des grenouilles écartelées datent d’une autre époque. De tels tests ne se font plus chez nous.
Nous travaillons actuellement avec des Xénopes, des grenouilles d’Afrique du Sud, qui sont communément utilisées au laboratoire.
En Suisse, la plupart des amphibiens sont sur liste rouge. Différents facteurs sont pointés du doigt pour expliquer cette diminution des espèces, dont les pesticides.
Les tests sur les Xénopes servent donc à comprendre le risque que ces substances peuvent présenter pour les amphibiens.
En parallèle de l’écriture du projet de recherche, nous avons écrit une demande « éthique » auprès du Service vétérinaire cantonal pour effectuer ces tests. C’est la procédure normale en Suisse. L’acceptation de cette demande nous a pris 6 mois.
D’abord il faut remplir un formulaire très détaillé sur les tests envisagés. Ce formulaire doit être examiné par le vétérinaire cantonal et par une commission d’éthique.
Ceux-ci relèvent les points qui posent problèmes. Nous devons les argumenter ou changer le protocole.
C’est une longue procédure, très stricte, mais nécessaire pour bien encadrer la recherche.
Certains points me posent toutefois question.
D’abord, la réglementation suisse ne concerne que les vertébrés. Au laboratoire, vous pouvez tester sans problèmes des algues, des plantes, des microcrustacés comme les daphnies ou des abeilles.
L’idée derrière est que ces organismes n’ont pas de système nerveux, donc ne souffrent pas.
Mais est-ce bien vrai?
Le test d’évitement sur les vers-de-terre nous interroge à ce propos. Lorsque vous mettez ces vers en présence de deux compartiments, l’un pollué, l’autre pas, ils choisissent de se réfugier dans celui qui ne l’est pas.
N’est-ce pas une indication qu’ils repèrent le danger et donc la souffrance potentielle?
D’ailleurs les décapodes, comme les poulpes, viennent d’être ajoutés à la liste des espèces concernées par la loi en Suisse. Et au fur et à mesure des connaissances, d’autres espèces s’y ajouteront encore.
Chez nous, au laboratoire, nous avons ainsi adopté les « mêmes règles » pour toutes les espèces, à tous les stades de vie.
Rappelons-le, tester des espèces vivantes n’est pas un plaisir. Mais c’est nécessaire pour évaluer le risque des substances chimiques de manière « réaliste ». Donc nous le faisons avec le plus de respect possible pour le vivant.
Un autre point me semble important. Tous les pays ne sont pas aussi strictes que la Suisse.
La tendance est donc, pour certains industriels, mais également pour certains chercheurs, à délocaliser les tests. Est-ce dont vers cela que nous voulons tendre? Ne plus faire d’expériences chez nous pour les faire ailleurs où on ne les voit pas?
La mise sur le marché des substances chimiques et leur surveillance nécessite malheureusement de faire des tests sur les organismes vivants. Leur « sacrifice » est nécessaire pour protéger notre santé et la biosphère.
Les alternatives seraient de ne pas faire de tests, et donc de mettre sur le marché des substances potentiellement dangereuses, ou d’interdire toutes les substances chimiques. Ce qui n’est pas envisageable actuellement.
Les écotoxicologues doivent donc trouver un difficile équilibre entre assurer au mieux le bien-être des animaux de laboratoire et effectuer des tests représentatifs pour protéger les animaux dans l’environnement.
Un casse-tête.
La recherche…en virtuel
a semaine passée j’étais en conférence à Dublin.
Je vous rassure…virtuellement.
Car tout se fait virtuellement en ce moment, même les travaux pratiques que nous donnons aux étudiants…ce qui est assez étrange quand on sait que pour la pratique il faut toucher, manipuler, etc.
Mais revenons à cette conférence. Il s’agissait de la réunion annuelle de la branche européenne de la SETAC (Society of Environmental Toxicology and Chemistry).
Il y a environ 1500 participants, 8 sessions parallèles de présentations orales et plus de 1000 posters.
Je m’y rends tous les 4 ans, ce qui correspond à peu près à la durée d’un doctorat…c’est-à-dire à la régénération des idées de recherche. En effet, si on s’y rend tous les ans, on ne voit pas beaucoup de nouvelles idées apparaître.
La science est un long fleuve tranquille avec des « mainstreams », courants majeurs, qui ne varient que très lentement.
Ainsi il y a quelques années, la mode était aux effets des mélanges de substances chimiques. Maintenant ces sont les méthodes OMICS qui ont la cote. Elles regroupent des analyses de nouvelle génération telles que protéomique (étude de l’ensemble des protéines d’un organisme) ou encore génomique.
Par contre, toujours peu de recherche sur les amphibiens ou les reptiles, dont beaucoup d’espèces sont sur liste rouge. Et qui mériteraient d’être plus étudiés.
Je consacrerai un jour un post aux phénomènes de mode dans la recherche, modes qui ne sont pas toujours en lien avec les sujets qui devraient être traités en priorité.
Donc pour la première fois, cette conférence était virtuelle.
Les organisateurs ont fait un travail considérable en mettant tout en ligne, et une certaine interactivité a été recrée par des sessions en lignes de 45 minutes.
Dans l’une d’elle nous étions 122. Difficile pour les modérateurs de gérer la session: certaines personnes parlent sans y être invitées, ou un dialogue se crée dans le « chat » en parallèle.
Mais globalement, ça n’a pas trop mal fonctionné. Et j’ai quand même réussi à me mettre à jour sur certaines méthodes ou à voir certaines études intéressantes.
J’en ai sélectionné trois que je voulais vous présenter.
La première étude a été réalisée au Canada. Samantha Athey s’est intéressée aux fibres issues de nos jeans et qui sont rejetées dans les eaux.
En effet, la plupart d’entre nous portons ou avons porté des jeans. Il s’en vend 450 millions de paires aux USA chaque année. Baggy, cigarette, slim, le jeans fait partie de la garde-robe de chacun.
Or les jeans perdent des fibres lors des lavages. Celles-ci peuvent être synthétiques ou naturelles, mais surtout sont chargées de beaucoup de produits chimiques comme des colorants (indigo) ou des retardateurs de flamme (et bien oui, il ne faudrait pas que les jeans prennent feu).
Samantha est allée chercher ces fibres dans des eaux usées de stations d’épurations, dans des sédiments et dans des estomacs de poissons, ceci proche de Toronto mais aussi dans l’Océan Arctique.
Et elle a trouvé des fibres de denim partout. Ils représentent 40% des fibres retrouvées dans les poissons et près de 40% de celles trouvées dans les sédiments.
Elle conclut en disant que chaque canadien (et certainement chaque Suisse) rejette 12.5 millions de fibres indigo dans les eaux chaque année. Ce qui est une source de pollution non négligeable, même si on ne connaît pas encore les effets de ces fibres et des substances qu’elles contiennent sur l’environnement.
Nul doute qu’après avoir lu ce poster, on regarde ses jeans différemment.
Une autre étude m’a paru également très intéressante et surtout innovante. Katherine Pedersen s’est penchée sur les effets conjoints de substances chimiques et d’organismes pathogènes chez les insectes.
Pourquoi c’est innovant?
Parce que les chercheurs restent souvent cantonnés à leur domaine. On va regarder les effets des substances chimiques ensemble ou des pathogènes ensemble. Mais rarement on croise les stresseurs.
L’hypothèse est que l’un des stresseurs (les substances chimiques ) va rendre l’organisme plus sensible à l’autre stresseur (les pathogènes).
Katherine a ré-analysé 70 publications sur les insectes avec des modèles de mélanges, et elle a montré que dans la plupart des cas, les deux stresseurs agissent de manière synergiques. C’est à dire que l’exposition à l’un amplifie bien l’effet de l’autre.
Cette étude vient donc renforcer l’idée que ce sont bien les stresseurs multiples qui posent problème, par exemple dans la disparition des abeilles, ou plus généralement dans la baisse de la biodiversité mondiale.
Par stresseurs multiples on entend les substances chimiques, mais également les changements de température ou les stress hydriques liés aux changements climatiques, les pathogènes, etc… Stresseurs qui devraient être considérés conjointement.
Enfin la dernière étude dont je voulais vous parler porte un nom évocateur « Silent Amazon ».
Andreu Rico a recherché 40 substances chimiques le long du fleuve Amazone au Brésil.
Et déjà là, je lui tire mon chapeau.
En effet, bien au chaud dans nos laboratoires en Suisse, nous oublions parfois que la recherche dans certaines régions du monde peut être difficile, en raison des conditions locales de terrains, mais aussi en raison des conditions géo-politiques.
Il est donc rare de voir une étude aussi poussée sur ce fleuve.
Sur les 40 substances recherchées, Andreu a trouvé beaucoup de substances psychotropes (licites et illicites) et de médicaments. Et il y a certainement bien d’autres molécules dans l’Amazone car il n’en a cherché que 40.
Par modélisation, il a montré que les substances détectées présentaient un risque pour 60 à 70% des espèces, ceci surtout en aval des villes. Doù le titre choisi.
Sa prochaine étape est de faire le lien avec la biodiversité dans le fleuve.
En résumé, cette conférence à Dublin, bien que virtuelle, a été intéressante.
Mais il manquait les « vraie » interactions, les cafés/thés/bières partagés, qui sont souvent la source de nos idées dans la recherche.
Références:
Athey, S.N. et al. 2020. The global environmental footprint of indigo denim microfibers. Poster. SETAC Europe 30th. Dublin. 3-7 May 2020.
Pedersen, K.E. et al. 2020. Quantifying synergistic interactions between pathogens and
chemicals on mortality in invertebrates? Poster. SETAC Europe 30th. Dublin. 3-7 May 2020.
Rico, A. et al. 2020. Silent Amazon. Presence and risks of anthropogenic contaminants in the Amazon River. Poster. SETAC Europe 30th. Dublin. 3-7 May 2020.
Communiquer sur le risque des substances chimiques au temps du Covid-19
Ce post sera un peu différent de mes posts habituels. Il résume mes réflexions pendant cette période particulière que nous impose la lutte contre le Covid-19.
En effet, si il y a encore quelques mois, nombres d’articles de presse ou de journaux spécialisés parlaient de pollution environnementale et de ses conséquences sur l’homme et la biodiversité, vous avez certainement constaté, comme moi, que les propos actuels focalisent quasi-exclusivement sur le Covid-19.
Or la pollution n’a pas diminué. On détecte toujours des pesticides, cosmétiques et médicaments dans les eaux de surface. Des perturbateurs hormonaux sont toujours présents dans les plastiques, et des additifs, comme le dioxyde de titane, sont toujours sur la sellette concernant le danger qu’ils représentent pour notre santé, particulièrement celles de nos enfants.
Mais ce n’est plus une priorité.
Comment, donc, continuer à parler du risque que présentent ces substances pour l’environnement et pour l’homme, alors que l’attention du public et du politique est focalisée ailleurs? Avec des inquiétudes liées à sa santé, celle de ses proches, mais également liées aux incertitudes économiques de l’après confinement.
Est-ce que mon propos va sembler déplacé? Comme lorsque j’ai mentionné l’utilisation des désinfectants dans les rues en Chine et ailleurs, qui me semble poser plus de problèmes qu’elle n’en résout.
Ou est-ce que mes propos sur les effets des substances chimiques vont paraître futiles comparés aux effets du Covid-19?
Et surtout comment continuer à convaincre qu’il faut agir.
On l’a lu, le président américain a décidé de suspendre les contrôles environnementaux (pollution de l’air, pollution de l’eau) pendant la pandémie et au delà.
Nous ne sommes pas aux USA, mais de nombreuses personnes s’inquiètent que la reprise économique se fasse au détriment de l’environnement. Le Monde soulignait ainsi que de fortes pressions s’exercent à Bruxelles pour réduire les ambitions du Green Deal européen sur le climat, les transports ou l’agriculture.
Prenons l’exemple des plastiques. Depuis quelques années, nous nous émouvons des continents de plastiques que l’on trouve dans les océans. Au point que de nombreux pays ont interdits les plastiques jetables. De mêmes certaines villes suisses les ont bannis comme Neuchâtel ou Genève. Le « Zéro déchets » est en vogue et on ne compte plus livres et blogs sur le sujet.
Qu’en reste-t-il après deux mois de pandémie?
Le plastique jetable revient en force. Près de 30% de production en plus pour les emballages selon un article de Futura Planète. Et avec le jetable reviennent également les décharges sauvages.
Peut-être en avez-vous fait l’expérience d’ailleurs?
J’ai pour ma part commandé un repas par internet, pour soutenir les restaurants locaux (et aussi parce que j’en avais un peu marre de cuisiner midi et soir). Tout est arrivé sur-emballé. J’ai rempli la moitié de ma poubelle en un soir.
Exit donc la question des déchets plastiques.
Redeviendra-t-elle d’actualité après la pandémie. Je l’espère. Mais rien n’est gagné!
Autre exemple, la question des médicaments dans les eaux.
Mon premier post fût sur la qualité de l’eau potable au robinet. En effet, ces dernières années, de nombreuses études ont montré qu’on y détectait des résidus de pesticides et de médicaments.
Même si, sur la base des connaissances actuelles, des effets sur la santé ne sont pas attendus à ces concentrations-là, il est questionnant, voir inquiétant pour beaucoup de personnes, que notre eau ne soit pas pure.
Avec la pandémie actuelle, de nombreux médicaments ont été utilisés, à l’hôpital, mais aussi chez les particuliers. Parfois de nouveaux médicaments comme la chloroquine qui est utilisée normalement contre le paludisme.
De même des produits désinfectants ont été utilisés par le personnel soignant, mais également dans les magasins et à la maison, ce qui n’est pas habituel. Et cette tendance va perdurer avec le dé-confinement.
Attention, je ne remets pas en cause que l’on doive se protéger et soigner les malades!
Cependant est-ce que l’on retrouve ces médicaments et certains biocides désinfectants dans les eaux usées? Et en quantité plus importante que d’habitude? Comme pendant la période hivernale où les antibiotiques sont plus présents?
Il n’y a pour l’instant pas d’études sur le sujet. La recherche est à l’arrêt. Et d’aucuns diront que cela n’est pas une priorité.
Cependant les médicaments se retrouvent ensuite, dans nos eaux de surface. Avec des effets potentiels sur la faune et la flore, et sur la qualité de l’eau de pompage pour l’eau potable.
En Suisse, nous avons fait le choix d’équiper nos stations d’épurations pour traiter les substances chimiques. Ce choix a un coût, certes, qui a souvent été débattu. Mais au vu de la situation actuelle, il semble judicieux d’avancer dans cette direction.
Pour moi, il est clair que l’exposition à de nombreuses de substances chimiques fait courir un risque à l’être humain et à l’environnement. Je pense l’avoir mis en évidence dans mes différents posts.
Mais c’est un risque à long-terme. Les effets sont observés après plusieurs années, comme la baisse de la fertilité, la puberté précoce, certains cancers ou maladies dégénératives ou encore l’obésité. Le lien de cause à effet est donc très difficile à démontrer, d’autant que les substances chimiques sont certainement un des facteurs jouant un rôle dans ces pathologies.
Cependant beaucoup de ces maladies sont des facteurs aggravants pour le Covid-19, comme l’obésité.
Il me paraît donc crucial de continuer à se préoccuper des substances chimiques qui nous entourent, et de continuer à en parler.
Et surtout de continuer à agir pour réduire notre exposition et celle de l’environnement.
La pollution de l’air, facteur aggravant du coronavirus?
Mi-mars, des chercheurs italiens de la société italienne de médecine environnementale, de l’Université de Bologne et de celle de Bari, ont émis l’hypothèse que la pollution de l’air jouait un rôle prépondérant dans la pandémie de coronavirus, et notamment sur son impact en Italie.
En effet, si on regarde les cartes, la diffusion du virus et sa mortalité sont très différents d’une région à l’autre.
Ces chercheurs ont donc cherché des liens, notamment avec le taux de particules fines dans l’atmosphère.
Les particules fines, on les connaît. Ce sont celles qui nous obligent à rouler moins vite en fin d’hiver ou en été, lorsqu’il n’y a que peu de vent. Ce sont aussi elles qui créent le smog que l’on voit sur les photos en Chine.
Elles sont émises par des sources diverses et variées. Cela va des fumées industrielles à la combustion automobile, en passant par la fumée de cigarette, ou même à la cuisson dans sa cuisine. Une grande partie d’entre elles sont notamment émises par les chauffages des maisons.
Les particules fines, PM pour Particulate Matter, sont classées en fonction de leur taille. Les PM2.5 par exemple ont un diamètre inférieur à 2.5micromètres.
Plus ces particules sont petites, plus elles peuvent s’engager loin dans le système pulmonaire.
Or suivant le type de particules, c’est-à-dire leur source d’émission, elles peuvent être plus ou moins toxiques.
Ainsi les Hydrocarbures aromatiques polycycliques ou PAHs. Cette famille de molécules est issue des processus de la combustion du charbon, du pétrole ou du gaz. Une fois émis, les PAHs persistent longtemps dans l’environnement.
Certains membres de cette famille, tel le benzo(a)pyrène, sont très toxiques, cancérigènes et mutagènes.
Donc sachant que ces molécules pénètrent très loin dans le système pulmonaire, on peut imaginer le risque à long-terme d’y être exposés. Idem pour d’autres particules fines.
Des chercheurs allemands se sont d’ailleurs penchés sur cette question et ont publié une étude début mars sur le sujet. Utilisant des modèles, ils ont ainsi estimé que la pollution de l’air par les particules fines entraînait une mortalité prématurée de 8.8 millions d’habitants par an.
C’est considérable!
Certes, on ne meurt pas forcément directement de la pollution. Mais notre exposition chronique au particules créée une inflammation permanente du système pulmonaire.
Dans son dossier sur l’inflammation en février 2018, le magazine Science & Vie, se pose d’ailleurs la question si l’inflammation chronique dans le corps n’était pas la mère de toutes les maladies modernes.
En effet, une inflammation chronique engendrerait diabète, cancer, infarctus et AVC ainsi que maladies neuro-dégénératives.
En somme, une grande partie des maladies modernes.
C’est là que les chercheurs italiens ont fait le lien avec le coronavirus, son taux de mortalité et sa diffusion.
Selon eux ce sont ces même maladies qui sont des facteurs aggravants dans les cas où le coronavirus a été mortel. Donc les régions où la pollution de l’air est plus importante sont plus susceptibles de se trouver avec des cas graves liés au coronavirus.
Autre point, comme pour le virus SRAS, il semblerait que les particules soient des autoroutes pour la diffusion du virus. Une autre raison qui expliquerait que certaines régions soient plus touchées que d’autres.
Si ces hypothèses sont vérifiées avec d’autres études, il sera donc vraiment crucial que des actions concrètes soient prises pour lutter contre la pollution de l’air.
Certes en Suisse il existe déjà des lois, notamment sur les émissions des fumées par les industries. Mais on a aussi vu l’échec des législations sur les émissions par les voitures avec le dieselgate.
Cette crise passée, il sera donc urgent de se préoccuper de cette pollution qui nous entoure et que nous respirons tous les jours.
Article du Monde du 30 mars 2020 sur le même sujet.
Références:
Lelieveld et al. 2020. Loss of life expectancy from air pollution compared to other risk factors: a worldwide perspective. Cardiovascular Research.
Setti et al. 2019. Relazione circa l’effetto dell’inquinamento da particolato atmosferico e la diffusione di virus nella popolazione. Position paper.
Une solution pire que le problème?
Ce papier m’a été inspiré par une vidéo en lien avec le coronavirus. On y voit un homme avec un masque, dans une sorte de tunnel, sous une pluie de « désinfectant ».
Plus globalement, les médias nous montrent quotidiennement des armées de personnes en habits de protection avec des sprays pour désinfecter les rues, ou même des camions qui projettent ces mêmes désinfectants dans de grosses fumées blanches.
Qu’on soit bien d’accord. Je ne critique pas le fait de prendre des mesures d’hygiènes supplémentaires en temps de pandémie. C’est même crucial.
Mais là, est-ce que ce n’est pas un peu trop? Et n’y a-t-il pas des risques à sprayer dans l’environnement de telles quantités de désinfectants?
Mais d’abord que contiennent ces désinfectants?
Mystère.
Certains parlent d’eau de javel, donc du chlore, dilué. D’autres de superoxydants. Ainsi le produit D7, supposément utilisé dans des hôpitaux de la province de Hubei (Business Insider), tue 99.9999% des bactéries selon leur site internet, notamment de nombreux pathogènes. Il s’attaque également aux virus.
Cependant, on sait maintenant que les bactéries font de la résistance. On sait aussi qu’il y a de bonnes bactéries, notamment dans l’intestin qui est reconnu comme notre deuxième cerveau. Il abrite toute une flore, dont des virus et des bactéries, dont l’équilibre est essentiel pour lutter contre certaines maladies.
Je reviens donc à notre tunnel de lavage et aux camions enfumant les rues de désinfectants. Et je me demande si une utilisation si intensive de produits toxiques ne va pas avoir des conséquences à long-terme plus graves que le virus lui-même.
Je n’ai pas la réponse. Peut-être certains d’entre vous en savent plus que moi?
Ces questionnements m’ont cependant rappelé un cas où la solution fût certainement plus dommageable que le problème.
Je dis « certainement » car dans ce cas, il n’y a pas eu de suivi biologique qui donne une réponse claire.
Certains d’entre vous se rappelleront certainement de la catastrophe pétrolière de 2010 dans le Golf du Mexique. Une plateforme pétrolière, Deepwater Horizon, de la compagnie pétrolière BP, exploite le pétrole issu du forage le plus profond jamais percé.
Le 20 avril 2010 elle explose, tuant 11 personnes. La marée noire qui en résulte est gigantesque. On estime à près de 5 millions de barils le pétrole qui s’échappe dans la mer.
Or le Golf du Mexique est un écosystème particulier car en partie fermé. Les dommages attendus sur l’écosystème seront conséquents.
C’est une catastrophe économique pour BP, mais surtout une catastrophe en terme d’image.
Une solution serait d’utiliser des dispersants. Ces composés, qui permettent de fractionner le pétrole en fines goutelettes, sont souvent utilisés dans les catastrophes pétrolières.
Une hypothèse est que le pétrole fractionné serait plus vite dégradé. Et surtout il ne reste pas en surface, permettant d’éviter les marées noires qui ont un très fort impact sur l’écologie, mais également un fort impact visuel sur le public. Les oiseaux englués dans du pétrole noir, cela frappe les esprits.
2 millions de galons (soit près de 8 millions de litres) de dispersant Corexit sont ainsi déversés dans le Golf du Mexique.
Malheureusement, un article publié en 2013 montre que le mélange Corexit/pétrole est 52 fois plus toxique que le pétrole seul, ceci sur une espèce de rotifères. Laissant supposer que cela puisse être le cas pour d’autres espèces.
L’histoire s’arrête là.
A ma connaissance, il n’y a pas eu d’étude sur l’impact environnemental de cette catastrophe. Ni d’autres études sur la toxicité conjointe du Corexit et du pétrole.
Mon hypothèse, pour expliquer cet effet de mélange, est qu’en fractionnant le pétrole, les composés deviennent plus disponibles, et donc plus toxiques, pour le vivant.
En février dernier, Allison Rose Levy, une journaliste américaine, revient sur cette affaire. Avec un titre très parlant: « The Deepwater Horizon oil spill was a cover-up, not a cleanup » (la marée noire du Deepwater Horizon était une dissimulation, pas un nettoyage).
Il est intéressant de lire comment les décisions, très pragmatiques, d’utiliser ce dispersant ont été prises. Sous un gouvernement pourtant démocrate et se déclarant concerné par les questions environnementales.
Mais je me suis beaucoup éloignée des désinfectants.
Pour moi cependant la question reste la même. Est-il judicieux de disperser dans l’environnement d’énormes quantités de substances dont les effets sur le vivant à long-terme ne sont pas connues?
Je n’ai pas de réponse. C’est certainement du cas par cas, en fonction des risques à court-terme.
Mais sachant que ce type d’évènements va se reproduire, il serait important de monitorer les conséquences environnementales des solutions mises en œuvre.
Mise à jour, 30 avril 2020
Depuis ce post, le Graie, en France, a mis en lignes ces vidéos pour rappeler le risque que représente la désinfection des rues.
Et un article sur les conséquences dramatiques de la désinfection de plages en Espagne.
Référence:
Roberto Rico-Martínez, Terry W. Snell, Tonya L. Shearer. Synergistic toxicity of Macondo crude oil and dispersant Corexit 9500A® to the Brachionus plicatilis species complex (Rotifera). Environmental Pollution, 2013; 173: 5 DOI: 10.1016/j.envpol.2012.09.024
Des insecticides en avion
Cette anecdote est arrivée à une amie. Et peut-être l’avez vous vécue vous-même.
Vous vous asseyez dans l’avion, attendant le décollage. Vous observez alors que le personnel de bord passe à côté de vous avec des petites bonbonnes et spray quelque chose dans l’allée, en dessus des têtes.
Lorsque vous vous renseignez, le steward ou l’hôtesse vous dit que ce n’est rien.
En fait, après enquête, il s’agit d’insecticides.
Les pays asiatiques et l’Australie, notamment, demandent aux compagnies aériennes de vaporiser des insecticides dans les avions qui s’y rendent. Ceci pour éviter le « débarquement » d’hôtes indésirables dans ces régions.
C’est maintenant connu, les moustiques, par exemple, voyagent volontiers en avion. Parfois porteurs de maladies, ils peuvent infecter des personnes très loin de la région endémique. Il existe ainsi un « Paludisme d’aéroport ». En France, en 40 ans, 30 cas ont été déclarés (chiffres 2009).
Donc les avions sont désinfectés, de même que les passagers.
Mais que contiennent ces sprays?
Il s’agit principalement de phénothrine et de perméthrine, tous deux de la famille des pyréthrinoïde. Ces insecticides agissent sur le système nerveux des insectes. Remplaçant les organophosphates, très toxiques pour les humains, ils sont plus sélectifs…
…mais restent très efficaces. Suivant la publicité, la mortalité [des moustiques] est totale en 3 minutes!
Notons que ces insecticides sont aussi utilisés contre les poux ou dans les produits antiparasitaires pour les animaux.
Pas de risques donc pour notre santé en prenant l’avion?
C’est difficile à dire. Certainement qu’une exposition occasionnelle n’est pas trop grave.
Mais la question peut se poser pour les personnes qui prennent régulièrement l’avion et surtout pour le personnel naviguant.
Ainsi SAgE pesticides, du gouvernement canadien, considère que les effets aigus pour la perméthrine sont modérés, mais que les effets à long-terme, résultant d’une exposition chronique, sont extrêmement élevés. En laboratoire, sur des souris et des rats, des signes cliniques comme « surexitabilité, tremblements, effets sur le poids corporel et celui du foie » ont été observés.
Sachant que ces insecticides sont neurotoxiques, des effets à long terme sur le système nerveux, en cas d’exposition prolongée, pourraient donc être observés chez l’homme.
Il n’y a moins de données sur la phénothrine car elle n’est pas enregistrée comme pesticide, mais les mêmes constatations s’appliquent certainement.
Rappelons que la maladie de Parkinson, une maladie neurodégénérative, a été reconnue comme maladie professionnelle pour les agriculteurs en France en 2013. En 2018, une autre étude montrait que les riverains de zones agricoles étaient également plus sujets à cette maladie.
Le personnel naviguant respirant régulièrement ces substances pourrait-il aussi être touché?
C’est ce que pense Brett Vollus, steward pendant 27 ans, atteint à 52 ans de la maladie de Parkinson. Il a attaqué la compagnie aérienne australienne Quantas en 2013, mettant en avant le risque que présentent les insecticides pulvérisés dans les avions pour le développement de cette maladie.
Je n’ai pas réussi à trouver où en était l’affaire, ni si une jugement avait été rendu.
A l’heure où les différentes maladies se propagent de par le monde en bateau ou en avion, il est certainement important de limiter les vecteurs comme les moustiques.
Cependant, au vu des risques que présentent les pesticides, et surtout les insecticides, des études à long-terme sur la santé des personnes exposées régulièrement dans les avions me paraîtraient indispensables.
A ma connaissance, il n’y en a pas.
Références:
Queyriaux et al. 2009. Paludisme d’aéroport. Airport malaria. La Presse Médicale 38: 1106-1109.
Faire parler l’ADN de l’environnement
Je vous ai passablement parlé jusqu’à maintenant du risque des substances chimiques pour l’environnement. Or l’évaluation du risque c’est une prédiction.
On utilise des modèles, souvent simples, parfois même simplistes, pour tenter de déterminer les effets des cocktails de polluants sur les écosystèmes. Mais que s’y passe-t-il réellement dans ces écosystèmes? Est-ce que les espèces sont vraiment impactées par ces polluants? Ou au contraire nos modèles sont-ils trop protecteurs?
Il est très difficile de répondre à cette question. Une des raisons est qu’il est fastidieux d’identifier les espèces présentes dans un écosystème.
Prenons le cas de l’identification des poissons dans une rivière. On peut procéder sur la base des relevés de pêche, tout en sachant qu’il y aura un biais, les pêcheurs ne retenant que les poissons qui peuvent être consommés.
On peut aussi faire ce que l’on appelle un pêche électrique ou électropêche. Concrètement, il s’agit de mettre un courant électrique dans une rivière, ce qui va étourdir le poisson et le faire remonter à la surface. Il pourra ainsi être analysé, pesé, etc…avant d’être remis dans la rivière.
Ce type de pêche permet de faire un état de la faune piscicole d’un cours d’eau. Mais depuis quelques années, cette pratique est discutée, car même si le poisson n’est pas tué, il peut être blessé par la manipulation.
Donc, en plus d’être complexe, l’identification des espèces peut être dommageables pour celles-ci. Ce n’est pas idéal.
Depuis une dizaine d’années, une nouvelle technique a fait son apparition dans la trousse à outil des chercheurs: l’ADN environnemental.
Cette technique part du principe que la vie laisse des traces où elle passe. Par l’analyse du milieu (par exemple de l’eau d’une rivière), il est possible de remonter aux espèces qui y circulent. Un peu comme nous-mêmes, laissons des empreintes là où nous passons (cheveux, peau, etc.).
Connaissant l’ADN des espèces potentiellement présentes dans un écosystème, il est donc possible d’évaluer leur présence ou leur absence. Et de mettre ces résultats en lien avec la pollution, plus ou moins importante, d’un milieu.
Le projet que j’aimerais vous présenter utilise ce type d’approche, soit la recherche de l’ADN environnemental. Il a été mené par un consortium de chercheurs franco-suisses, et coordonné par l’INRA de Thonon pour la partie française et par l‘Université de Genève pour la partie suisse.
Ce projet a pour étude la pollution du Léman et, entre autre, son impact sur les communautés de périphyton. Le périphyton, c’est un mélange d’algues, de champignons et de bactéries qui vivent en symbiose.
Vous connaissez cette communauté d’organismes, c’est la pellicule glissante que vous trouvez sur les cailloux dans les cours d’eau.
Le périphyton joue un grand rôle pour les écosystèmes. Il sert de nourriture aux macroinvertébrés ou à certains poissons. Il peut aussi filtrer l’eau et la dépolluer. Il est donc essentiel dans un système lacustre comme le Léman.
Or le type d’organismes présents dans le périphyton, le type d’algues notamment, est un indicateur de la qualité de l’eau. Il est donc possible d’évaluer la qualité de l’eau des bords du Léman en prélevant cette communauté tout autour du lac.
Cependant, comme expliqué plus haut, il est très fastidieux de déterminer toutes les espèces d’algues présentes dans un échantillon, et jusqu’à présent, une telle détermination n’avait été menée que pour quelques sites autour du lac.
Dans le projet Synaqua, les chercheurs ont utilisé l’ADN pour faciliter leur travail et donc évaluer plus de sites.
Très concrètement, ils ont séquencé l’ADN des échantillons prélevés, et comparé les résultats avec leurs bases de données pour déterminer les espèces présentes. Dans cette base de données se trouvait aussi la sensibilité de ces espèces aux polluants comme le phosphore ou l’azote.
La présence ou l’absence des différentes espèces d’algues dans la communauté a donc permis de classer les sites autour du lac en trois catégories de pollution: bonne qualité écologique, qualité écologique moyenne et qualité écologique dégradée.
La carte du pourtour du lac est la suivante:


(Source des images, Synaqua, INRA Thonon).
On pouvait s’y attendre, les zones où la qualité écologique est la plus dégradée se situent proches des zones les plus urbanisées. Des zones où se rejettent notamment des effluents de stations d’épuration ou de déversoirs d’orage, C’est le cas autour de la Baie de Vidy au sud de Lausanne, qui ressort en rouge.
Certes, cet outil n’est pas encore adapté pour des pollutions avec des pesticides et des médicaments. Mais ces méthodes sont amenées à se développer rapidement.
Elles pourront donc très certainement être utilisées dans un proche avenir pour affiner et valider les évaluations de risque.
A écouter, l’émission CQFD du 22 janvier avec la Dr Bouchez.
Références:
Projet SYNAQUA: https://www6.inrae.fr/synaqua/
Poulet N, Basilico L. 2017. L’ADN environnemental pour l’étude de la biodiversité. Etat de l’art et perspectives pour la gestion. Agence française pour la biodiversité. www.documentation.eauetbiodiversite.fr
Autour de l’autorisation et de l’interdiction des pesticides.
Le chlorothalonil, un fongicide, sera interdit dès le 1er janvier 2020. Le chlorpyriphos et le chlorpyriphos-méthyl l’ont été en juin 2019, même si il y a actuellement un recours de différentes entreprises. Le chloroprophame, un autre fongicide, va certainement être interdit en Europe.
Y a-t-il donc quelque chose qui cloche dans le processus d’homologation des pesticides? Pourquoi ces pesticides se trouvaient-ils sur le marché?
La question m’a été posée plusieurs fois.
Et la réponse est complexe.
D’abord, la plupart de ces substances sont de « vieilles » molécules. Elles ont été mises sur le marché dès les années 1960/70, soit bien avant les premières procédures d’homologation, qui datent des années 1990. Il n’y avait à cette époque pas de réelle prise en compte des effets toxiques, co-latéraux, des pesticides.
Le risque que présente ces substances a bien sûr été ré-évalué depuis. Mais la procédure de ré-évaluation n’est pas accessible pour les chercheurs et ils ne peuvent pas se prononcer sur la question.
Prenons le cas de l’herbicide atrazine, utilisé pendant de nombreuses années sur les cultures de maïs. Il a été retiré du marché européen en 2003. Une discussion a également eu lieu en Suisse, mais ni les scientifiques, ni le public, n’ont eu accès aux arguments pour et contre l’interdiction.
En 2002, le Conseil Fédéral répondait à une interpellation de Giosué Galli Remo qui demandait son interdiction, qu’ « une interdiction totale de l’atrazine, comme en Allemagne, ne s’impose pas actuellement, ni pour des raisons de santé des personnes, ni pour des raisons d’écotoxicité. Il faut préciser aussi que les pesticides qui seraient utilisés en remplacement ne diffèrent pas beaucoup de l’atrazine, ni en termes de toxicité, ni en terme d’évolution dans l’environnement. A cela s’ajoute aussi qu’ils ne sont plus aussi facilement détectables dans l’environnement que l’atrazine.«
En 2006, le Conseil Fédéral répondait à une motion de Josef Zisyadis qui demandait également son interdiction, que « la réévaluation de l’atrazine suit la procédure régulière en tenant compte entre autres des expertises européennes et devra aboutir avant deux ans à une décision concernant son utilisation dans les produits phytosanitaires« .
Cette substance a finalement été interdite en Suisse en 2012.
Ce manque de transparence, également décrié pour l’homologation elle-même, est problématique. Il ne permet pas un débat ouvert autour de la question du risque toxicologique et écotoxicologique des vieilles substances chimiques.
Mais il faut aussi savoir que même quand ce débat a lieu, il est souvent très difficile de retirer une substance qui est déjà sur le marché. On voit les controverses générées par l’herbicide glyphosate ou l’additif bisphenol-A.
Un autre point important est l’accumulation de connaissances avec le temps. Souvent, plus une substance est étudiée, plus on découvre son potentiel toxique. C’est le cas du glyphosate qui a été classé en 2015 comme potentiellement cancérogène par le CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer, agence de l’OMS), alors qu’il est utilisé depuis les années 1970.
Dans le cas du chlorothalonil, il s’agit d’un autre problème. C’est l’un de ces produits de dégradation, régulièrement détecté dans l’eau potable, qui a mené à son interdiction. Or les produits de dégradation font rarement l’objet de tests spécifiques dans la procédure homologation.
On le voit avec ces exemples, nous sommes en train de faire le tri dans un héritage qui date de ce que l’on appelé la révolution verte. Après la deuxième guerre mondiale, les techniques agricoles ont été révolutionnées notamment avec l’utilisation de plus en plus importante d’engrais et de substances phytosanitaires.
Il a fallu attendre des lanceurs d’alerte comme Rachel Carson pour que les risques soient pris en compte, ce qui a mené au législations régulant la mise sur le marché des pesticides dès les années 90.
Mais même à cette époque, le problème n’était pas encore connu. C’est avec les avancées faites par les méthodes d’échantillonnages et les méthodes d’analyses chimiques que l’on a pu mettre en évidence, dès les années 2000, l’ampleur de la pollution de l’environnement par les pesticides.
Dès ce moment, on aurait pu et dû faire le tri. Mais comme je l’ai mentionné plus haut, il est malheureusement très difficile de retirer une substance du marché. Les controverses autour de la toxicité humaine et environnementale peuvent durer des années avant une prise de décision.
Il semble cependant qu’actuellement le contexte politique soit plus favorable à l’interdiction de pesticides problématiques.
Mais est-ce que les procédures d’homologation, mises en place dès les années 1990, ont diminué le risque de trouver des pesticides problématiques sur le marché?
Il n’existe pas de statistiques sur le sujet. Mais certainement qu’elles ont joué un rôle de garde-fou, car le nombre de nouvelles substances a été fortement réduit. Au point que certains ont parlé de frein à l’innovation.
Cependant, même les substances « nouvelles » peuvent poser problème, comme les néonicotinoïdes mis en cause dans la disparition des abeilles.
Ce sont des molécules qui passent au travers du filet.
Car la procédure d’homologation est standardisée et focalise sur un nombre de tests restreints. Pour l’écotoxicité aquatique, une à deux espèces d’algues sont testées, une espèce de microcrustacés et une ou deux espèces de poissons. C’est sur cette base que l’on évalue le risque pour les centaines d’espèces des lacs et cours d’eau. Les chances sont donc grandes de « louper » quelque chose.
Tous ces exemples montrent que la procédure d’homologation des pesticides n’est pas idéale. Et le manque de transparence qui l’entoure n’est pas le moindre des problèmes.
Et pourtant, malgré tous ces biais, comme déjà mentionné, cette procédure joue certainement un rôle important pour limiter le nombre de substances problématiques sur le marché.
Dans d’autres domaines, où les réglementations sont plus faibles voire inexistantes, le flou règne. Surfactants, cosmétiques, colorants, additifs, nous les utilisons quotidiennement sans connaître, le plus souvent, ni le risque pour la santé, ni celui sur l’environnement.
Ainsi le dioxyde de titane, un additif utilisé dans l’alimentation (E171) est suspecté de créer des lésions au niveau de l’intestin, lésions qui pourrait conduire à des cancers comme le soulignait le Monde en 2017 déjà. L’émission A Bon Entendeur y a consacré un excellent reportage début décembre 2019.
Le dioxyde de titane a été classé comme cancérigène probable par le CIRC en 2006 déjà. Les enfants y sont particulièrement exposés car il est présent dans les bonbons et dans les dentifrices, qu’ils avalent le plus souvent au lieu de les recracher. La France va l’interdire dès 2020 comme additif.
Or je n’entends aucun débat en Suisse à ce sujet.
A mon sens, les discussions qui ont lieu actuellement autour de l’utilisation des pesticides sont cruciales. Et il est réjouissant de voir que des substances particulièrement problématiques sont enfin interdites. Et que les procédures de mise sur le marché sont questionnées.
Mais il ne faut pas oublier que les pesticides ne sont que la pointe de l’iceberg. Ces discussions peuvent avoir lieu car se sont les substances pour lesquelles on a le plus de données de toxicité et d’écotoxicité, et ce sont également les plus réglementées.
Il est donc crucial que l’exemple des pesticides puisse amener à réfléchir à la procédure d’autorisation de toutes les autres substances chimiques et aux critères d’interdiction quand c’est nécessaire.
Du poison au paradis
Au cours des 150 dernières années, la plupart des cours d’eau de Suisse ont été canalisés et de nombreux sites naturels ont disparus.
En effet, si nous avons toujours eu besoin d’eau pour vivre, cette dernière peut également présenter un danger lors des inondations. Pour cette raison, mais aussi pour créer de l’énergie ou pour construire, les populations ont cherché à modifier le tracé naturel des cours d’eau. De nombreuses rivières ont ainsi été canalisées ou mises sous tuyau.
Cette modification du tracé des rivières n’a pas été sans conséquences sur l’écologie aquatique. En effet, les cours d’eau qui étaient des mosaïques d’habitats (zones rapides, calmes, gravillons, sédiments fins, etc…) sont devenus des canaux longitudinaux monotones.
Par exemple des poissons comme la truite, qui ont besoin d’un lit de gravier pour pondre, peuvent difficilement se reproduire dans un canal. De même les larves d’insectes, qui se cachent dans les fonds de rivière, ne réussissent pas à s’implanter dans ce même canal.
En 1998, la sonnette d’alarme était tirée. Plusieurs indicateurs montraient que les populations de poissons étaient menacées en Suisse. Les relevés indiquaient une diminution des prises de truites allant jusqu’à 50 % depuis les années 1980, l’habitat dégradé et la pollution étant des facteurs causals robustes.
Entre 1997 et 2008, l’état de 65’000 km du réseau hydrologique suisse a été évalué par l’Office fédérale de l’environnement. La Figure 1 présente l’état de la situation en 2009. Les graphiques montrent que plus de 75% du réseau d’eau en zone urbaine est très affecté, artificiel ou souterrain. Difficile pour la biologie de faire sa place.

Figure 1: Etat hydromorphologique des rivières en Suisse par zones en 2009 : (a) urbaine, (b) agricole et (c) autre. I = naturelle (bleu), II = peu affectée (vert), III = très affecté (jaune), IV = artificiel (rouge) et V = souterraine (magenta). Source : (Office fédéral de l’environnement 2009).
Sur la base de ce constat et suite à la modification de la Loi sur la protection des eaux en 2011, le gouvernement suisse a prévu la restauration de 4’000 km de rivière d’ici 2090. La renaturation implique le rétablissement des fonctions naturelles et la restauration de l’habitat pour obtenir une faune et une flore diversifiées. 307 km de rivières avaient déjà été renaturés en 2014.
Mais la restauration est un travail colossal et très coûteux.
De plus, rendre à la rivière sa place implique de prendre du terrain sur le milieu urbain, ou sur les terres agricoles, ce qui n’est pas toujours très simple.
S’y ajoute un autre problème, mis en évidence récemment par des chercheurs allemands dans leur article « Poison au paradis ». Ces auteurs montrent que le succès des renaturations n’est peut-être pas toujours au rendez-vous, ceci au vu de la pollution chimique de l’eau, et surtout des sédiments, dans les zones renaturées.
En effet, les activités humaines dans les bassins versants des cours d’eau génèrent une pollution diffuse dans la rivière. Le ruissellement sur les routes en milieu urbain entraîne des métaux issus de l’abrasion des véhicules, du mobilier urbain ou des toitures, vers les grilles d’égouts, puis vers les cours d’eau. Il entraîne également des pesticides utilisés dans les jardins, et bien d’autres polluants. En zone agricole, des pesticides, toujours, sont également emmenés jusque dans les rivières lors des pluies.
Or cette pollution est rarement mesurée avant une renaturation. Les évaluations des corrections des cours d’eau tendent à se concentrer sur les modifications de l’écomorphologie, soit du lit du cours d’eau.
Les chercheurs se sont donc penchés sur le cas de la rivière Nidda, en Allemagne. Cette rivière a un bassin versant de 2000 km2, avec une importante pression agricole et industrielle. Ils ont comparé la toxicité de l’eau et des sédiments prélevés dans une zone renaturée, avec celle d’échantillons pris dans une zone peu impactée en amont de la rivière. Ils ont ainsi montré, en laboratoire, que les organismes biologiques étaient fortement impactés par les échantillons provenant de la zone renaturée, alors qu’ils ne l’étaient que peu par ceux provenant de la zone en amont.
Pour les auteurs allemands, la pollution est un facteur de stress persistant pour le cours d’eau, ce qui peut limiter la récupération de la biologie dans les zones renaturées.
Si on veut donner une chance aux écosystèmes des rivières, il semble donc important de re-créer des habitats, mais également d’assainir le bassin versant. Cela passe donc par une réflexion sur les mesures qui peuvent être prises pour limiter les rejets vers les eaux
Sinon, il y a de fortes chances que la biologie ne se réapproprie pas des zones qui, bien que paraissant naturelles, restent toxiques.
Références:
Brettschneider, DJ, Misovic A, Schulte-Oehlmann U, Oetken M & Oehlmann J. 2019. Poison in paradise: increase of toxic effects in restored sections of two rivers jeopardizes the success of hydromorphological restoration measures. Environmental Sciences Europe. 31:36.
Office fédéral de l’environnement (OFEV). 2009. Ecomorphologie des cours d’eau suisses: Etat du lit des berges et des rives. Résultats des relevés écomorphologiques (avril 2009). Confédéderation suisse, Berne.
Les pesticides dans nos ménages
Le 7 octobre 2019 un rapport de l’ANSES* sur l’utilisation des pesticides dans les ménages est sorti sans vraiment être relayé du côté suisse.
Pourtant ce rapport est extrêmement intéressant à plus d’un titre.
L’étude, appelée Pesti’home, a été réalisée en 2014 sur un échantillon représentatif de quelques 1500 ménages français. Elle visait à comprendre l’usage des pesticides dans le quotidien des Français.
Il en ressort que plus de 75% des ménages ont utilisé au moins un pesticide dans l’année précédent le sondage.
Dans 84% des cas, il s’agit d’insecticides contre les insectes volants ou rampants, contre les puces/tiques pour les animaux domestiques ou contre les poux. La moitié des sondés en utilisent au moins 3 fois par an.
Environ 20% des foyers utilisent des herbicides et fongicides dans les espaces extérieurs (jardins, balcon) et ceci plus de 2 fois par an.
Enfin les répulsifs anti-moustiques sont utilisés 6 fois par an par la moitié des ménages et plus de 25 fois par un quart des ménages français.
Ce qui m’a particulièrement interpellée, c’est que l’ANSES relève que les précautions d’emploi lié à l’utilisation de ces substances toxiques ne sont pas assez connues et suivies.
Par exemple « environ un tiers des ménages ne lit jamais les indications des emballages des anti-acariens et anti-rongeurs et un quart d’entre eux ne les lit jamais pour les produits contre les insectes volants et rampants« **.
Tout aussi problématique, l’enquête montre que la majorité des utilisateurs ne savait pas comment se débarrasser des pesticides. « 60% des ménages jettent leurs produits inutilisés à la poubelle et seulement 31% les déposent à la déchetterie« .
Et plus grave, « plus d’un quart des ménages avaient dans leur stock au moins un produit de protection des plantes interdit à la vente. »
Je ne pense pas que ce constat serait très différent en Suisse, comme le montrait un reportage du TJ en mai 2019.
Moins de la moitié des personnes interrogées dans ce reportage savaient que l’application des pesticides était interdite en Suisse sur les terrasses, les parkings ou les toitures.
Et pourtant, l’utilisation de pesticides dans les ménages n’est pas inoffensive. Ni pour notre santé, ni pour l’environnement.
Prenons le cas des insecticides que l’on utilise pour les plantes d’intérieur. Certains contiennent de la cypermethrine, un insecticide qui agit sur le système nerveux des insectes. Bien que moins toxiques pour l’homme que leur prédécesseurs les organophosphates, les pyrethrinoïdes n’en restent pas moins des substances pesticides auxquelles notre exposition devrait être limitée.
De plus, la cypermethrine est très toxique pour les microcrustacés et les amphibiens. Verser le reste de son récipient dans l’évier peut avoir des conséquences désastreuses sur le milieu aquatique. Et au bout de la chaîne sur l’eau potable.
D’autre produits pour plantes d’ornements contiennent des néonicotinoïdes comme l’acétamipride. Cette famille de substances est actuellement controversée pour leur effets sur les pollinisateurs. Et l’acétamipride est interdit en France depuis 2018. Mais pas en Suisse…
Spayer ses plantes d’appartement contre les cochenilles ou autres araignées n’est donc pas anodin!
Or ces produits insecticides sont en vente libre. Et aucune formation n’est demandée au quidam qui veut les utiliser.
Au vu des risques pour la santé et l’environnement, je trouve ça grave!
Pour le jardinage également, ces produits sont en vente libre. Or qui n’a pas envie de récolter de beaux fruits et légumes après avoir passé tant de temps à les bichonner.
Une étude que nous avions menée avec des étudiants en 2006 dans différents jardins communaux nous avait inquiétée. Nombre de personnes interrogées ne savait pas ce qu’elles utilisaient comme pesticides, et surtout, ne lisaient pas les mode d’emploi.
Or, il est très facile de surdoser un produit. Ceux-ci doivent souvent être dilués avant emploi, mais la dilution elle-même nécessite le matériel adéquat et quelques efforts de calculs.
Cette surdose peut empoisonner les sols, les eaux (en milieu urbain, les eaux de pluies rejoignent vite les rivières) ou même sa propre santé. En effet, on s’y expose lorsqu’on les applique (souvent sans masque et sans gants) et lorsque on mange ses fruits et légumes.
Je pense pour ma part que les pesticides ne sont ni nécessaires sur nos plantes d’intérieur, ni dans nos potagers. Certes, ils peuvent permettre un meilleur rendement, mais au prix de la pollution de l’air que nous respirons à l’intérieur comme à l’extérieur, de la pollution de nos eaux ou de nos sols.
Un mot encore sur les anti-moustiques***. La plupart contiennent du DEET, une substance qui agit comme répulsif et non comme insecticide. Pour l’instant, elle ne semble pas très toxique pour la santé et l’environnement, mais on a très peu de données à disposition. Il est cependant recommandé de l’éviter sur les enfants.
Il existe également des anti-moustiques avec de réels insecticides. C’est le cas de certains diffuseurs qui contiennent des pyrethrinoïdes dont j’ai mentionné les effets plus haut. Sachant qu’ils diffusent toute la nuit, il faut bien réfléchir avant de les utiliser.
* ANSES: Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail en France
** Toutes les citations sont issues de l’actualité du 07.10.19 publié par l’ANSES.
*** Voir l’article de Que Choisir: Antimoustiques
Changement climatique…et pollution
Ce n’est pas un article très gai pour ce début octobre, si tant est que les autres aient pu l’être.
Aujourd’hui, personne ne peut prétendre ignorer que notre civilisation va au devant de grands changements, même si des mesures sont prises rapidement.
Le rapport du GIEC du 25 septembre sur les océans et la cryosphère est sans appel: « Approuvé le 24 septembre 2019 par les 195 Gouvernements membres du GIEC, le Rapport spécial du GIEC sur l’océan et la cryosphère dans le contexte du changement climatique…présente de nouvelles preuves soulignant les avantages qu’il y a à faire en sorte que le réchauffement planétaire soit aussi faible que possible, conformément à l’objectif que les gouvernements se sont fixés dans l’Accord de Paris en 2015. En réduisant de toute urgence les émissions de gaz à effet de serre, il est possible de limiter l’ampleur des changements auxquels sont confrontés l’océan et la cryosphère. Les écosystèmes et les moyens d’existence qui en dépendent peuvent être préservés. »
Même les banques commencent à réaliser les risques que représentent ces changements à l’instar du rapport publié par Golman Sachs cette semaine.
Cependant, si les changements climatiques ont un impact important et mesurable sur les écosystèmes, ce ne sont pas les seuls pressions anthropiques que ces derniers subissent. Les substances chimiques, dont je vous parle depuis 2 ans, ont également un impact non-négligeable sur l’environnement.
Or il y a très peu d’études scientifiques qui se penchent sur les effets conjoints des modifications du climat et de la pollution chimique.
En cherchant pour mes étudiants, j’ai trouvé un article de 2009 qui fait le point sur la question. Il s’intitule: la toxicologie du changement climatique: les contaminants de l’environnement dans un monde plus chaud.
Et autant vous le dire tout de suite, le constat est alarmant. Donc si vous ne voulez pas entendre de mauvaises nouvelles, arrêtez votre lecture ici.
D’abord les changements climatiques auront un effet sur le transport et le devenir des substances chimiques dans l’environnement.
Une bonne nouvelle cependant, il est possible que des températures plus élevées augmentent la dégradation des substances chimiques dans l’environnement. Ceci peut en partie s’expliquer par de plus longues périodes « chaudes » pendant lesquelles les microorganismes qui dégradent les substances fonctionnent bien.
En revanche, des températures plus chaudes vont augmenter la pollution de l’air (par « évaporation » de substances depuis les eaux et les sols ), avec des risques pour la santé humaine et les écosystèmes.
Le manque de pluie va également contribuer à cette pollution de l’air, car l’atmosphère sera plus rarement « lavée » par l’eau. L’air sera pollué plus durablement.
A l’opposé, les évènements de pluie extrêmes prévus par les différents scénarios vont entraînés les substances chimiques vers les eaux avec un risque d’augmenter significativement les concentrations dans le milieu aquatique. Et donc le risque pour les espèces aquatiques.
Au niveau de la toxicité, l’étude relève que les changements climatiques vont augmenter les effets des substances chimiques. Pour résumer les organismes vont être soumis à un double stress. Ils devront s’adapter à des changements de leur milieu (en terme de température, humidité, nourriture disponible) et en même temps faire face aux polluants toxiques.
Prenons le cas d’un poisson dans une rivière. Les été chauds et secs contribuent à réduire l’eau présente dans sa rivière en été. Cette eau est également plus chaude. Notre poisson doit donc faire face à un milieu de vie moins confortable.
A côté de cela, les pesticides et autres médicaments se déversent toujours dans la rivière. Mais comme il y a moins d’eau, ils sont moins dilués et leur concentrations sont plus élevées. Donc ils sont plus toxiques
Je pense que vous êtes arrivés à la même conclusion que moi: la « sur »vie de ce poisson va être compliquée.
Je vous avais prévenu, ce post n’est pas très gai.
Ces conclusions montrent qu’il y a urgence, urgence d’agir sur les gaz à effets de serre comme le souligne le GIEC, mais également sur l’utilisation et les rejets des substances chimiques.
Malheureusement, actuellement ces problématiques sont encore traitées séparément. Il est donc facile aux industriels de faire recours contre l’interdiction d’une substance comme c’est le cas pour le chlorpyriphos et ses cousins en Suisse. On peut discuter pendant des années du risque que présente une molécule, voir un groupe de substances. On connaît la controverse autour du glyphosate.
On n’en est malheureusement plus là. Les espèces vivantes ne sommes pas exposées à une substance, mais à des centaines de milliers. Dans un environnement qui va beaucoup changer.
Je me répète certainement, mais nous pouvons diminuer les substances chimiques que nous utilisons, au quotidien. Ensemble, elles ont un impact sur notre santé et sur notre environnement. Au niveau de l’alimentation, des cosmétiques, des détergents. Il y a des choses à faire.
Et au delà de nos actions de consommateurs, nous avons également le droit de vote. Et pour éviter tout malentendu, je ne préconise pas ici de voter pour un parti donné. J’ai eu l’occasion de collaborer avec des personnes de différents partis et ce fût souvent enrichissant.
Mais il s’agit bien ici de donner son avis, en fonction de ses convictions, au moment où on nous le demande, que ce soit pour les votations communales, cantonales ou fédérales, ou sur des initiatives.
Référence:
Noyes et al. 2009. The toxicology of climate change: Environmental contaminants in a warming world. Environment International 35: 971-986.
On ne trouve que ce que l’on cherche
Régulièrement, de nouvelles problématiques liées aux substances chimiques apparaissent. C’est le cas du chlorothalonil, un fongicide appliqué sur les champs de céréales et qui a défrayé la chronique au début de l’été. Son autorisation n’a pas été renouvellée en 2019 par l’Union européenne, mais il est encore autorisé en Suisse.
Dans le cas de ce fongicide, le problème vient surtout de ses produits de dégradation. En effet, le chlorothalonil est classé comme cancérigène potentiel. Mais ce sont ses métabolites que l’on trouve dans des concentrations dépassant la norme de 0.1 ug/l dans les eaux souterraines. Or comme la substance parente est cancérigène potentielle et que la preuve n’est pas faite que ses métabolites ne le sont pas, elles sont considérées comme problématiques (vous suivez?).
Suite à cette nouvelle classification, des eaux souterraines sont devenues impropres à la production d’eau potable. Pourtant le chlorothalonil est utilisé depuis 50 ans, alors pourquoi maintenant?
En premier lieu, cela s’explique par l’évolution des méthodes d’analyses chimiques.
Si vous devez surveiller la qualité des eaux, vous allez prélever un échantillon d’eau (si possible représentatif) et y rechercher les substances d’intérêt. Or il n’est pas possible de faire une recherche « au hasard ». Vous devez choisir un certain nombre de substances connues, pour lesquelles les méthodes d’analyse existent, que vous pourrez comparer avec ce qui est présent dans votre échantillon. Donc au final vous ne pourrez trouver que ce que vous cherchez.
Je vous donne deux exemples.
Prenons le cas du glyphosate. La méthode d’analyse au laboratoire est assez complexe et cette molécule ne pouvait pendant longtemps pas être analysées en même temps que d’autres pesticides. Peu de laboratoires étaient donc capables de le rechercher. Malgré le fait qu’il était l’herbicide le plus vendu en Suisse, on ne le trouvait pas dans les eaux de surface car il était absent des programmes de surveillance. Or lorsqu’il a été inclus dans ces mêmes programmes, au milieu des années 2000, il s’est avéré qu’on le trouvait aussi bien dans les eaux de surface que dans les eaux souterraines.
Un autre exemple est donné par les médicaments dans les eaux. Il y a entre 2000 et 3000 substances médicamenteuses sur le marché en Suisse. Or depuis le début des années 2000, nous en cherchons entre 50 et 100. Soit maximum 5%. C’est peu. Ce pourquoi les laboratoires cherchent à toujours plus étayer leurs analyses. C’est donc un peu par hasard que la metformine, un anti-diabétique, a été rajoutée à la liste des substances cherchées à la fin des années 2000. Et qu’on s’est rendu compte qu’on la trouvait partout. Presque 20 tonnes dans le Léman par exemple.
Tout cela pourrait laisser penser que les recherches se font « au petit bonheur la chance ». Or ce n’est pas le cas. Les organismes de surveillance et les chercheurs travaillent de concert pour dresser des listes de substances « à rechercher ». Par exemple, en cherchant à connaître celles qui sont le plus utilisées.
Mais la tâche est colossale. D’une part parce qu’il y a plus 100’000 substances sur le marché en Europe, et 10 à 20 fois plus si on compte les produits de dégradation. Mais surtout parce que nous n’avons pas accès aux données de composition des produits, ni aux quantités vendues. Donc, dans la plupart des cas, impossible de faire des pronostics sur les substances à rechercher.
Il y a donc fort à parier que dans le futur, il y aura de plus en plus d’actualité sur des pollutions qui ne seront nouvelles que par leur mise en évidence.
Mais revenons au chlorothalonil et au problème qu’il pose actuellement alors que ce n’était pas le cas il y a encore une année.
La deuxième explication est liée à l’évolution des données sur la toxicité humaine et environnementale.
Reprenons le cas des métabolites du chlorothalonil. La question des produits de dégradation est très complexe, mais cependant très importante. En effet, la structure d’une substance chimique, dans l’environnement, va changer sous l’action du soleil, des bactéries, etc…. Généralement cette évolution est plutôt positive car la toxicité de la substance va diminuer. Mais ce n’est pas toujours le cas. C’est un phénomène d’ailleurs bien connu pour les médicaments. Certains d’entre eux sont plus actifs une fois transformés par le foie chez l’être humain. Comme exemple, le tamoxifen, un anti-cancéreux utilisé dans le traitement des cancers du sein. Dans son cas, c’est l’endoxifen, sa métabolite, qui est 100 fois plus active contre le cancer.
Dans le cas du chlorothalonil, 6 métabolites ont été déclarées comme pertinentes (à risque) et 3 comme non-pertinente dans un rapport de l’Office Fédérale de l’Agriculture du 6 août 2019. Avant cette date, le chlorothalonil ne posait pas vraiment de problèmes. Notons que dans le rapport cité ci-dessus, 19 métabolites sont déclarées comme pertinentes, alors qu’elles ne font de loin pas toutes, pour l’instant, l’objet de recherche dans les eaux.
Ici également il y a fort à parier que le nombre d’études augmentant, le nombre de substances devenant à risque va augmenter aussi.
Un bon exemple de changement d’interprétation de la qualité de l’environnement est donné par les PCBs. Cette famille de composés chlorés a été largement utilisée jusque dans les années 80 et même s’ils sont maintenant interdits, ils sont encore présents dans l’air et relargués par certains matériaux de construction comme les joints ou encore par les décharges.
Jusqu’au début des années 2000, on mesurait les quantité de PCBs sur la base des 6 congénères que l’on trouve en majorité dans les eaux. Ces valeurs étaient en dessous des normes et tout allait bien.
Mais soudain, des chercheurs mettent en évidence que certains membres de la familles sont beaucoup plus toxiques que prévus. On les appelle dioxines-like car aussi toxiques que les dioxines. De nouvelles normes entrent en vigueur et la Suisse découvre ses eaux beaucoup plus polluées que précédemment, entrainant la fermeture de la pêche dans certaines rivières telle la Sarine.
On le voit, la surveillance de la qualité de l’eau est complexe. De nouvelles méthodes d’analyses, de nouvelles données de toxicité ou d’écotoxicité font régulièrement leur apparition et mettent en lumière de nouveaux problèmes.
Il paraît donc important de prendre des mesures non pas seulement lorsque le problème est détecté, mais également pro-activement, pour réduire de manière générale les substances chimiques qui entrent dans les eaux. A titre d’exemple, l’amélioration des traitements des effluents des stations d’épuration voulu en Suisse, ceci pour réduire les substances chimiques rejetées, va dans ce sens.
Des métaux dans le fonds du lac
Je vous avais parlé, dans un blog précédent, du cuivre que l’on trouvait dans les sédiments des cours d’eau, ceci dû à son utilisation en agriculture, mais également à son utilisation dans la construction.
Ce cuivre, accroché sur les particules et transporté par les eaux de pluies, se dépose dans le fonds des rivières et des lacs.
Un de mes étudiants de master, Sabesan Sabaratnam, s’est penché sur la pollution en cuivre, mais également en autres métaux, des sédiments d’un lac. Il a choisi la Baie de Vidy, dans le lac Léman, car les eaux de ruissellement de Lausanne, ainsi que les eaux de la station d’épuration de Vidy, s’y déversent (Figure 1).
C’était un excellent exemple pour évaluer la pollution par les métaux qu’une ville de 200’000 habitants peut engendrer dans un lac.

Figure 1: Localisation de la Baie de Vidy, (Sabaratnam 2019)
Depuis un bateau (Figure 2), M. Sabaratnam a collecté des échantillons de sédiments, dans le fonds de la Baie, en 54 points, répartis de manière homogène (Figure 3). Certains points se trouvaient proches du rejet de la station d’épuration de Vidy, d’autres plus proches de la Chamberonne, une rivière qui va entraîner les eaux de pluie de l’ouest lausannois dans le lac.
 Figure 2: Bateau pour l’échantillonnage (Sabaratnam 2019). Figure 2: Bateau pour l’échantillonnage (Sabaratnam 2019). | 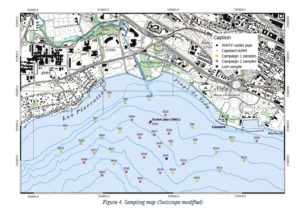 Figure 3: Sites de prélèvements. Le site de rejets de la station d’épuration de Vidy est noté en noir (Sabaratnam 2019). Figure 3: Sites de prélèvements. Le site de rejets de la station d’épuration de Vidy est noté en noir (Sabaratnam 2019). |
M. Sabaratnam est ensuite parti au laboratoire pour analyser 11 métaux: l’aluminium, le cadmium, le chrome, le cuivre, le fer, le manganèse, le nickel, le plomb, le titane et le zinc. Le mercure a également été mesuré à l’Université de Genève car la méthode est complexe.

Figure 4: Préparation des échantillons au laboratoire ((Sabaratnam 2019).
Qu’a-t-il trouvé?
Tout d’abord, comme on s’y attendait, les sédiments contiennent plus de matière organique proche du rejet de la station d’épuration (Figure 5).
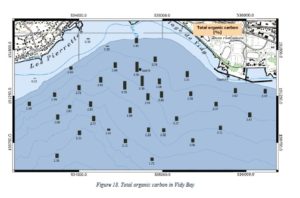
Figure 5: Carbone organique total dans les sédiments. La hauteur des barres montre les quantités (Sabaratnam 2019).
Ce n’est pas étonnant sachant que nos eaux usées, véhiculant nos excréments, sont très chargées en matière organique. Mais si une grande partie est traitée à la station d’épuration, des rejets surviennent lors des pluies et amènent cette matière organique vers les eaux de surface.
Pourquoi je vous en parle? Parce que la matière organique joue un grand rôle dans la disponibilité, et donc la toxicité, des métaux pour les organismes vivants.
Mais parlons de la pollution par les métaux.
Pour le cuivre, on voit un grosse tache noire (correspondant aux concentrations les plus élevées, soit 160 mg/kg) au milieu de la Baie (Figure 6). De nouveau cela correspond au rejet de la station d’épuration. La tache sombre plus bas à droite correspond également à une zone fortement polluée. Cette pollution peut être due aux rejets par temps pluie, dont la conduite principale se trouve à droite de la station d’épuration, ou à des courants qui déplacent les sédiments.

Figure 6: Concentrations en cuivre dans les sédiments. Les concentrations les plus élevées sont les plus foncées (Sabaratnam 2019).
Le cadmium, le chrome, le plomb, le mercure, le nickel, le fer et le zinc présentent le même pattern et donc la même source de pollution dans le lac.
Par contre, la situation est différente pour le manganèse, l’aluminium et le titane (Figure 7). Les concentrations maximales sont en bordure de la zone. Il semble donc que la source d’apport soit le lac. Non que celui-ci soit fortement pollué. Mais les valeurs trouvées correspondent aux valeurs « naturellement » présentent dans les sédiments et donc sont plutôt influencées par les courant lacustres.
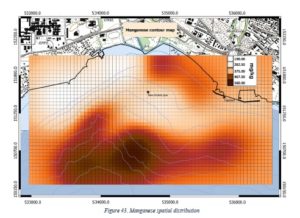
Figure 7: Concentrations en manganèse dans les sédiments. Les concentrations les plus élevées sont les plus foncées (Sabaratnam 2019).
Tout ceci est bien joli, mais ces concentrations sont-elles problématiques?
M. Sabaratnam les a comparées avec des valeurs seuils d’effets sur les espèces vivant dans les sédiments. Le cas du cuivre est le plus clair, les concentrations moyennes et maximales sont en dessus du seuil d’effets. Idem pour la nickel. Les concentrations présentent donc un risque non négligeables pour l’écosystème.
Pour les autres métaux, les concentrations maximales sont en dessous de ces seuils, mais au dessus du seuil d’effet potentiel. Ils présentent donc un risque faibles à modérés.
Pourquoi cette pollution par le cuivre et le nickel? Nous avons déjà parlé des toitures en cuivre et du trafic comme source importante de cuivre dans l’environnement. Pour le nickel, c’est également le trafic et le mobilier urbain qui contribue à cette pollution. Avec certainement des sources industrielles.
Que faire?
La pollution se fait surtout par temps pluie, pour le cuivre et le nickel. Ces eaux ne sont pas traitées et rejoignent le milieu naturel directement.
Il existe des solutions comme le nettoyage des routes, qui se fait déjà, et qui peut limiter les particules se rejetant dans les eaux de surface. Des systèmes de filtration existent aussi pour retenir cette pollution au niveau des bâtiments ou des grilles d’égouts. Des solutions qui peuvent être mises en place, mais avec un certain coût.
Mais j’aimerais souligner un point qui me semble important. Ces résultats sont pour les métaux. Cependant des considérations semblables s’appliquent pour d’autres substances. Même si nous ne les avons pas mesurés, on s’attend à ce que d’autres polluants qui s’adsorbent sur les particules, comme certains biocides ou pesticides, se répartissent de la même manière.
La pollution par les eaux de pluie n’est donc pas négligeable et une attention particulière devrait lui être accordée!
En se souvenant aussi que ce qui part dans une grille d’égout finit souvent directement dans une rivière ou dans un lac.
Référence:
Sabaratnam S. 2019. Spatial distribution of trace metals and major elements
in surficial sediments from the Vidy Bay. Travail de Master. FGSE. Université de Lausanne.
L’échec des législations sur les substances chimiques
On me demande souvent pourquoi on ne connaît pas la toxicité de telle ou telle substance. Prenons l’exemple d’un cosmétique. On lira « methylpropanediol » dans la composition, mais taper son nom dans son moteur de recherche n’amènera, au mieux, que des informations contradictoires sur le risque que cette molécule présente.
Il faut dire que jusqu’aux années 2000, seuls les pesticides et les médicaments étaient soumis à une législation spécifique visant à évaluer le risque qu’ils pourraient présenter. Pour l’homme et l’environnement (ou pour l’homme seulement dans le cas des médicaments).
Or il y avait au début du 21ème siècle près de 150’000 substances sur le marché en Europe. Pour lesquelles ce risque était donc inconnu!
Fort de ce constat, les députés européens ont adopté le 13 décembre 2006 une loi visant à enregistrer et évaluer les substances chimiques présentes sur le marché en Europe, la directive REACH.
Cette directive inversait le fardeau de la preuve, c’est-à-dire que, comme pour les pesticides, les industries devaient montrer qu’une substance ne présentait pas de risque pour pouvoir la mettre sur le marché. Ce n’était plus à nous, scientifiques, et aux administrations, de devoir démontrer ce risque pour qu’elle soit retirée du marché.
L’accouchement de cette directive fût difficile. Un intense lobbying, autant du milieu industriel que des ONG, a eu lieu à Bruxelles.
Au final, c’est seulement 30’000 substances sur les 150’000 qui devaient être évaluées, soit celles produites à plus de 1 tonne par an.
Mais l’adoption de cette directive nous a réjouis, toxicologues et écotoxicologues. Nous allions enfin en savoir plus et pouvoir évaluer le risque environnemental des molécules qui nous entouraient. Je me souviens d’en avoir parlé avec enthousiasme aux volées d’étudiants qui suivaient mes cours.
En 2019, maintenant que les dernières données ont été reçues par l’agence européenne des produits chimiques à Helsinki, force est de constaté que le soufflé est retombé.
En mai dernier, des documents de l’association environnementale allemande Bund, cités par Le Monde, montraient que plus de 654 entreprises allemandes ne respectaient pas la directive REACH. Ils parlent même de « dieselgate » de l’industrie chimique.
En effet, pour 940 substances, dont 41 utilisées entre 12 et 121 millions de tonnes par an, les données sont non conformes ou insuffisantes concernant le danger toxicologique et écotoxicologique. Ainsi le phtalate de dibutyle, un plastifiant soupçonné d’être un perturbateur endocrinien, est encore largement utilisé dans les jouets.
Récemment, des collègues se sont également penchés sur les valeurs d’écotoxicité à disposition dans la base de données REACH. Sur les 305’068 données trouvées, seules 54’353 étaient utilisables. C’est-à-dire que 82% des valeurs à disposition ne pouvaient pas être utilisées pour évaluer le risque environnemental d’une substance!
Pourquoi un pourcentage si élevé de données non utilisables?
Ces collègues posent plusieurs hypothèses comme des erreurs lors de la saisie des données. Mais pas seulement. Parfois les conditions de tests ne sont pas précisées. Ou encore il est mentionné que la toxicité est inférieure à une certaine valeur, mais cette valeur n’est pas donnée.
C’est un énorme gâchis. Énormément d’argent a été investi pour créer des données inutilisables. Et au final, cette réglementation sensée mieux nous protéger ne le fait pas.
Mais il y a encore pire à mon sens. Dans son excellent livre: « Toxiques légaux », Henri Boullier montre que même pour des substances dont la toxicité est reconnue, « des députés, des avocats, des hauts fonctionnaires, des représentants d’entreprise et des chefs d’Etat ont progressivement inscrit dans le droit l’impossibilité d’interdire les molécules chimiques, si toxiques soient-elles ».
S’inscrit dans la loi notamment le fameux « principe d’exception » lorsqu’une substance est utilisée dans un usage contrôlé.
Je m’explique. Une substance dangereuse peut par exemple être utilisée sur un lieu de travail si les conditions de travail sont contrôlées et donc que la santé du travailleur n’est pas mise en danger. Sont ainsi établise cartes de risques et mesures de protection. Mais souvent dans la pratique, comme le montre Henri Boullier, ces mesures ne sont pas appliquées correctement.
C’est donc un constat bien amer. Malgré la volonté affichée en Europe de mieux contrôler les substances chimiques, l’échec est flagrant.
Donc je continuerai certainement encore longtemps de répondre « je ne sais pas » lorsque l’on me posera la question de la toxicité d’une substance chimique découverte dans la composition de son shampoing préféré.
Références:
Boulier H. 2019. Toxiques légaux. Comment les firmes chimiques ont mis la main sur le contrôle de leurs produits. Editions la découverte.
Saouter et al. 2019. Using REACH for the EU Environmental Footprint: building a usable ecotoxicity database (part I). Environmental Chemistry and Toxicology. Article sous presse.
Image: Fotolia_64542047_Subscription_L, copyright
Une bonne décision prise tardivement
Il y a deux jours, l’Office Fédéral de l’Agriculture annonçait le retrait du marché de deux insecticides, le chlorpyriphos et le chlorpyriphos-ethyl. C’est une décision intelligente. Ces deux substances sont toxiques pour le système nerveux et ceci à petite dose déjà. Or on les utilise largement depuis la révolution verte des années 50.
Cependant, on peut se demander pourquoi avoir attendu aussi longtemps.
Ces deux substances font partie de la grande famille des organophosphates, des composés connus pour être neurotoxiques depuis les années 20. En effet, et c’est un cas d’école, un organophosphate, le tricresyl phosphate, a fait des ravages dans la population noire et pauvre lors de la prohibition aux Etats-Unis.
Comme la commercialisation de l’alcool était interdite, les populations pauvres consommaient les remèdes faits à base d’alcool. Notamment le Ginger Jake, un médicament jamaïcain. Les autorités américaines ont donc décidé d’augmenter le gingembre pour en augmenter l’amertume et donc diminuer la consommation.
Comme le contrôle du taux de gingembre se faisait au poids sec (après évaporation du liquide), des petits malins ont trouvé la solution de remplacer le gingembre, très cher, par du tricresyl phosphate, lui très bon marché.
Ce sont des médecins qui ont alerté les autorités. Ils recevaient un nombre croissant de patients pauvres avec des difficultés pour marcher et bouger, signe d’une atteinte neurologique.
Après quelques temps, le pot-aux-roses a été trouvé. Mais cet épisode a laissé de nombreux malades et une séries de chansons de blues sur le « Jake Walk Blues« .
Mais c’est pendant la deuxième guerre mondiale que la famille des organophosphates a été développée, avec notamment le gaz sarin qui refait parler de lui actuellement en Syrie.
Dans les années 50, après la guerre, il fallait trouver une utilité à ces substances chimiques. Elles ont donc été reconverties en insecticides (heureusement pas le gaz sarin), pendant ce que l’on a appelé la révolution verte.
Donc cela fait plus de 60 ans que ces substances sont sur le marché, utilisées dans notre agriculture. Pourquoi avoir attendu si longtemps avant de les interdire?
Je n’ai pas la réponse.
Autre questions, quelles sont les substances chimiques qui vont les remplacer?
Actuellement, dans certaines cultures, on utilise la lutte par confusion. C’est-à-dire que l’on diffuse des phéromones femelles qui vont empêcher les mâles de retrouver les vraies femelles et donc de se reproduire.
Mais dans beaucoup d’autres cas, ce sont d’autres insecticides qui vont être utilisés. Notamment des pyrethrinoïdes comme la permethrine ou encore des néonicotïnoides. Les pyrethrinoïdes sont moins toxiques pour les animaux à sang chaud, comme l’humain, car ils se lient à des récepteurs spécifiques aux insectes. Cependant, pour les insectes non cibles comme les abeilles ou les microcrustacés des cours d’eau, cela ne fait pas une grande différence de remplacer le chlorpyriphos par de la permethrine. Les deux sont très toxiques.
Quant aux néonicotinoides, ils font régulièrement la une des médias pour leur mise en cause dans le déclin des colonies d’abeilles.
Donc oui, cette interdiction est certainement une avancée car le chlorpyriphos et le chlorpyriphos-ethyl auraient dû être retirés du marché depuis longtemps. Et en ce sens, la Suisse ne fait que suivre le mouvement puisque le Danemark, la Finlande, l’Allemagne, l’Irlande, la Lettonie, la Lituanie, la Slovénie et la Suède ont déjà interdit ces substances.
Mais est-ce une réelle avancée pour la protection de l’environnement? A voir si l’idée est de réduire l’utilisation d’insecticides, ou juste de substituer deux « vieilles » substances par des nouvelles, aussi puissantes, et souvent plus rentables pour l’industrie chimique.
Du plastique, du plastique, toujours du plastique
La thématique du plastique est à la mode. Il faut dire que les images de tortues ou de baleines étouffées par des sacs plastiques ne laissent pas indifférents.
Certes, l’état de nos lacs et rivières ne ressemblent pas (encore ?) aux canaux de certaines villes asiatiques où les déchets plastiques couvrent la surface de l’eau. Mais il suffit de se promener sur les plages le nez par terre pour voir que la Suisse n’est pas « propre en ordre ». L’Association pour la Sauvegarde du Léman organise chaque année un nettoyage des bords du Léman (NetLeman). En 2018, les bénévoles ont récolté près de 5 tonnes de déchets, dont quelques 10%, soit pas moins de 500kg, sont des déchets plastiques.
Mais au delà de ces déchets visibles, une partie de la pollution est constituée de microplastiques. Il s’agit de minuscules particules, plus petites que 5 mm, qui peuvent être le résultat de la dégradation des déchets plastiques (bouts de bouteille en PET, de ballon, etc.). Mais ils peuvent également être émis dans l’environnement tels quels. C’est le cas de microbilles de plastique utilisées dans les cosmétiques (exfoliants ou dentifrices), ou encore dans certains détergents (avec eux plus besoin de frotter).
Or ces microplastiques se comportent différemment dans l’environnement que les sacs ou autres bouteilles en PET. S’ils sont très petits, ils peuvent rester en suspension dans l’eau et servir de support aux bactéries ou aux microalgues. Plus gros, ils vont souvent sédimenter dans les fonds des systèmes aquatiques. Et ils peuvent bien sûr être absorbés par les espèces qui vivent dans les eaux.
Des études menées par l’EPFL entre 2012 et 2017 montrent que l’on détecte des quantités non négligeables de microplastiques dans les eaux et les sédiments des lacs suisses (voir références plus bas).
Une de nos étudiantes de master, Sandrine Froidevaux, s’est donc posée la question de la présence de microplastiques dans les poissons de lac, plus précisément du Léman.
Pour ce faire, elle est allée collecter des estomacs de poissons chez différents pêcheurs autour du Léman, en sélectionnant différentes espèces comme le gardon et la perche.

Elle a ensuite dû « détruire » les estomacs au laboratoire pour éliminer la matière organique et ne garder que les résidus plastiques. Ces résidus ont ensuite été observés sous la loupe binoculaire.
Un test très simple a permis de déterminer si il s’agissait vraiment de plastique. Une aiguille chauffée à été mise en contact avec le fragment. Si celui-ci fondait et collait à l’aiguille, il était compté comme du plastique.
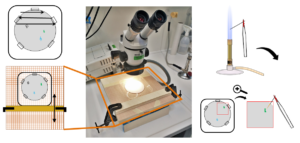
Source: S. Froidevaux. 2019. Master Unil.
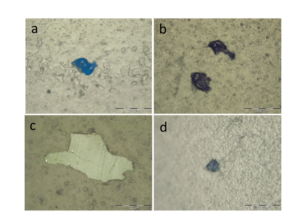
S.Froidevaux. 2019. Master Unil.
En a-t-elle détectés beaucoup au final, de ces bouts de plastiques dans les poissons ? Et bien, beaucoup moins qu’attendus au vu des concentrations dans les eaux.
Des microplastiques ont été trouvés dans moins de 6% des échantillons. Ceci correspond d’ailleurs à d’autres études menées en Suisse et en Europe.
Ce constat est plutôt rassurant.
Mais comment cela s’explique-t-il ?
On peut faire l’hypothèse que les microplastiques transitent par le système digestif des poissons mais ne s’y accumulent pas.
Par contre, il semble que tous les poissons ne soient pas égaux face à cette pollution. Sandrine Froidevaux souligne ainsi que les perches semblent manger plus de plastique que les autres espèces. Elles sont connues pour être plus voraces et plus opportunistes que les autres.
Si les consommateurs des poissons de lacs peuvent être rassurés (il y a peu de microplastique dans les estomacs de poissons et les filets ne devraient pas en contenir), reste la question de l’effet de cette pollution sur les poissons eux-mêmes.
Sur ce point, la recherche est encore en cours…
Références:
Froidevaux S. 2019. Microplastiques dans les poissons du Lac Léman ?
Prospection sur le Gardon (Rutilus rutilus) et la Perche (Perca fluviatilis). Master. Université de Lausanne.
Faure F, Corbaz M, Baecher H, De Alencastro LF. 2012. Pollution due to plastics and microplastics in lake Geneva and in the Mediterranean sea. Archives des Sciences , 65(1-2) :157–164, 2012.
Faure F, Demars C, Wieser O, Kunz M, De Alencastro LF. 2015. Plastic pollution in Swiss surface waters : Nature and concentrations, interaction with pollutants. Environmental Chemistry :12(5) : 582–591.
Faure F, De Alencastro LF. 2016. Microplastiques – Situation dans les eaux de surface en Suisse. Aqua & Gas n°4 , pages 72–77.
Anti-puces familial
J’ai toujours eu des chats. Pas que je n’aime pas les chiens, mais en ville, c’est plus compliqué pour eux qui ont besoin d’espace.
Lors de notre premier rendez-vous chez le vétérinaire avec notre petite chatte québécoise, celui-ci nous a conseillé de lui appliquer un anti-puces tous les mois.
Ayant grandi à la campagne, et ayant toujours vu les chats de ferme se débrouiller sans cela, je n’ai pas donné suite.
Cela a changé avec notre deuxième chatte. Très vite, il s’est avéré qu’elle était allergique aux piqûres de puces. Elle a développé une dermatite et perdait ses poils sur les pattes. Il fallait alors lui faire des piqures d’antibiotiques.
Je me suis donc résolue à lui appliquer les pipettes vendues chez les vétérinaires, ce qu’elle détestait pas ailleurs cordialement.
C’est l’arrivée de notre fils qui m’a fait réfléchir un peu plus loin sur ce que je mettais dans notre appartement. En effet, le produit appliqué est censé être entrainé depuis l’endroit d’application sur tout le corps du chat et il y reste 1 mois. Or toute personne qui a déjà eu un chat sait que celui-ci se frotte constamment aux meubles, coins de portes et autres, pour marquer son territoire. Il semble donc assez logique que le produit en question soit aussi distribué dans tout l’appartement.
Mais qu’est-ce donc que ce produit? Il s’agit souvent d’un insecticide, le fipronil. Bien que neurotoxique, il est surtout actif contre les insectes, mais semble moins toxique pour les animaux à sang chaud.
Il reste que c’est un pesticide, qui est aussi utilisé dans l’agriculture, notamment pour la protection des semences. Il a également été mis en cause, au côté des néonicotinoïdes, dans la disparition des abeilles.
En cherchant dans la littérature, je n’ai pas trouvé beaucoup d’études sur la toxicité et l’écotoxicité du fipronil. Ce n’est malheureusement pas une substance à la mode comme le glyphosate.
Il a cependant fait l’objet d’un scandale sanitaire en Europe en 2017: « les oeufs au fipronil« . En effet, des poules pondeuses avaient été traitées illégalement contre le pou rouge aux Pays-Bas et en Belgique avec du fipronil. Des dizaines de millier d’oeufs furent contaminés et ont dû être éliminé. Mais le message des gouvernements, à l’époque, furent plutôt rassurants. Reste que ce produit a passé des plumes de la poule à l’intérieur de l’oeuf…ce qui n’est guère rassurant.
Le fipronil n’est pas le seul pesticide utilisé dans les anti-puces, on y trouve aussi de la perméthrine, très toxique pour les insectes et pour les amphibiens.
A part les chiens et les chats, les autres animaux peuvent aussi être traités. Le DEET, un répulsif développé pour la guerre du Vietnam, est communément utilisé dans les écuries et les étables. Il repousse les mouches et les taons. On le détecte d’ailleurs dans des concentrations assez élevées dans les cours d’eau suisse. De nouveau, il existe très peu d’études sur sa toxicité et son écotoxicité, ce qui fait que le DEET n’est pas un problème pour l’instant.
Mais revenons à notre anti-puces. Ayant regardé plus en détail la composition de la pipette en question, je l’ai bannie de notre appartement. Pour un bébé, qui passe son temps par terre, le risque lié à cette exposition continue me semblait déraisonnable. Mais je n’ai aucune étude pour le prouver…
Et notre chatte? Elle se porte très bien merci. Après avoir essayé des traitements alternatifs aux huiles essentielles (peu efficaces dans son cas), je lui ai donné un remède homéopatique que je donne aussi à mon fils lors d’épisodes de poux à l’école. Depuis plus rien. Mais c’est peut-être psychologique…
Reste la question suivante: pourquoi proposer de traiter systématiquement les animaux domestiques avec des anti-puces? Certes aucune étude n’a montré qu’ils étaient vraiment problématiques, même si des chats et des chiens sont déjà morts après l’application. D’ailleurs en 2016, un article dans Science et Avenir posait la question de la toxicité de ces produits pour les animaux et les enfants.
Ne serait-il donc pas judicieux de garder les anti-puces pour des cas problématiques, par exemple les allergies aux piqûres de puces citées plus haut? Et de laisser nos animaux se débrouiller dans les autres cas? Notre exposition aux pesticides en serait certainement allégée.
Les hôpitaux comme source de pollution par les médicaments ?
Des traces de médicaments sont détectables dans la plupart des eaux de surface, et même des eaux souterraines. La source principale de pollution est notre consommation de produits pharmaceutiques comme déjà discuté dans le post « Des médicaments et des hommes ».
On peut donc se demander si les espaces de soins, comme les hôpitaux, représentent une source ponctuelle importante, et donc s’il serait nécessaire d’envisager un traitement spécifique pour ces structures.
Entre 2010 et 2013, nous nous sommes donc intéressés au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) afin d’estimer quelle était sa participation, par rapport à la ville, dans les rejets en médicaments à Lausanne. Cet établissement d’environ 700 lits représente le plus grand hôpital de la région lausannoise.
Première constatation, dans les grands hôpitaux, il est difficile de mesurer des concentrations « à la sortie du tuyau ». En effet, chaque bâtiment a sa propre sortie d’eaux usées et elles ne rejoignent pas forcément le même collecteur. Difficile donc d’avoir une idée de la pollution globale du CHUV.
Deuxième constatation, l’estimation des substances pharmaceutiques consommées est extrêmement fastidieuse à effectuer. En effet, les données fournies par la pharmacie de l’hôpital sont les quantités de produits médicamenteux distribués. Il faut donc les transformer en substance active afin d’estimer ce qui va être rejeté.
De plus, les médicaments non consommés, et parfois jetés, ne sont pas comptabilisés. Il y a donc un biais dans les calculs.
Malgré ces soucis de mesures et de calculs, on constate rapidement que pour la majorité des médicaments, l’hôpital n’est pas la source principale de pollution. La part d’un centre de soin comme le CHUV représente moins de 10% de la pollution médicamenteuse à l’entrée de la station d’épuration de Vidy à Lausanne.
Ce résultat nous a surpris. Pourquoi une structure avec autant de patients traités ne représente-t-elle pas une plus grande part ?
Parce que les traitements actuels se font de plus en plus souvent en ambulatoire. Le patient prend le médicament au CHUV, mais l’excrétion de celui-ci se fait dans ses toilettes, à la maison.
Ceci explique aussi pourquoi on détecte des concentrations de médicaments assez importantes dans les effluents de stations d’épurations de petits villages.
Cependant, pour certains médicaments particuliers, l’hôpital représente quand même 50% de la pollution à la station d’épuration. C’est le cas de certains antibiotiques utilisés pour traiter des bactéries multirésistantes par exemple.
Notons que les résultats trouvés pour le CHUV sont confirmés par d’autres études, comme celle menée sur l’hôpital de Baden par le centre de recherche eawag, ou encore aux HUG de Genève.
Faut-il donc s’occuper des effluents hospitaliers?
A mon sens oui, ceci du fait que pour certaines substances, souvent assez actives comme des antibiotiques ou anticancéreux, les hôpitaux représentent une part non négligeable de la pollution.
De plus, ces effluent véhiculent des virus et des bactéries multirésistantes que nous préférerions ne pas retrouver dans l’environnement. Ils contiennent enfin également des désinfectants et des biocides utilisés pour le ménage, mais aussi pour les bacs de désinfection des instruments. Or on sait que les biocides peuvent engendrer des résistances dans l’environnement.
Mais actuellement, légalement, rien de contraint les hôpitaux à traiter les eaux usées, sauf dans le cas de substances radioactives.
Traiter ne serait d’ailleurs pas évident. Comme mentionné plus haut, les bâtiments ont des réseaux d’eaux usées complexes qui ne se rejoignent pas forcément au même endroit.
L’idée serait donc plutôt de proposer un catalogue de solutions qui pourraient être appliquées au cas par cas.
Par exemple à Lausanne, les effluents hospitaliers vont être traités par la nouvelle station d’épuration qui retiendra les micropolluants. Il n’y aura donc pas vraiment de problèmes par temps sec.
Par contre, en cas de pluie, une partie des eaux usées se déverse directement dans le lac. L’idée serait donc de construire un bassin qui retiendrait les eaux de l’hôpital lors des pluies, et les renverrait dans le réseau après, afin d’être traitées.
Cependant, à côté du traitement, différentes solutions pourraient aussi être appliquées directement à l’hôpital pour éviter les rejets. Ainsi les restes de perfusions sont le plus souvent jetés à l’évier. Certains hôpitaux réfléchissent ainsi à brûler tous leurs déchets, inclus les liquides.
D’autres études proposent de récupérer les urines après traitements radiographiques dans des poches que le patient pourraient ramener à l’hôpital.
Dans ces deux cas, une sensibilisation, voire une formation du personnel soignant à cette problématique semble indispensable! Malheureusement, les questions liées à la pollution environnementale par les médicaments sont encore trop peu évoquées dans les études en soins infirmiers ou en médecine.
En résumé, même si les hôpitaux ne sont pas les sources principales de pollution par les médicaments, des mesures prises à la source et/ou sur le réseau, pourraient permettre de réduire encore la part qu’ils représentent. Mais ceci reste pour l’instant dépendant de la volonté des directions des centres hospitaliers.
Notons encore que nous avons parlé ici des grandes structures hospitalières. Mais à côté, il existe également de multiples petites à moyennes unités de soins (centres de radiographies, cabinets médicaux ou dentaires, centre pour personnes âgées, etc…). Ces derniers représentent également des sources ponctuelles de pollution par les médicaments. Certes petites, ces contributions pourraient également être réduites avec des solutions adéquates.
Références:
Daouk S, Chèvre N, Vernaz N, Widmer C, Daali Y, Fleury-Souverain S. 2016. Dynamics of active pharmaceutical ingredients loads in a Swiss university hospital wastewaters and prediction of the related environmental risk for the aquatic ecosystems. Science of the Total Environment 547: 244-253.
Chèvre N, Coutu S, Margot J, Wynn HK, Bader HP, Scheidegger R, Rossi L. 2013. Substance flow analysis as a tool for mitigating the impact of pharmaceuticals on the aquatic system. Water Research 47: 2995-3005.
Des poêles…à l’Himalaya
La semaine passée, l’émission Temps Présent à diffusé un reportage sur le scandale de la pollution au téflon dans la région de Parkersburg aux Etats-Unis. Dans les années 80 et 90, l’entreprise DuPont a ainsi déversé quelques 7000 tonnes de substances toxiques dans les eaux de la région, impactant de manière durable la santé des habitants.
Cet exemple dramatique de pollution industrielle concernait un composé utilisé dans le téflon et portant le doux nom d’acide perluorooctanoïque, « PFOA » pour les intimes. Ce composé fait partie de la famille des Polluants Organiques Persistants (POPs) dont je vous ai déjà parlé dans d’autres articles.
Les POPs sont des substances chimiques, souvent inventées entre le début et le milieu du XXème siècle, et utilisées pour leurs propriétés de stabilité. En effet, que ce soit sous l’effet de la chaleur ou du temps, elles gardent cette stabilité.
Et c’est bien là le problème, une fois dans l’environnement, ces composés sont aussi très stables. On estime leur persistance à plusieurs dizaines, voir plusieurs centaines d’années. Autant dire qu’ils nous survivront.
Pourquoi sont-ils persistants? Parce que ce sont des molécules complexes, contenant des éléments toxiques comme le chlore, le brome, ou encore le fluor dans le cas du PFOA. Les bactéries ne sont pas bêtes, et avant de s’attaquer à des molécules qui, d’une part, leur demanderont beaucoup d’énergie à dégrader et qui, d’autre part, pourraient être toxiques, elles vont chercher d’autres sources de nourriture.
Ce qui m’amène à mon deuxième point, ces molécules sont toxiques voir très toxiques. Elles sont souvent cancérigènes et ont des effets sur la reproduction (malformation du foetus, stérilité, etc.). Ainsi le reportage de Temps Présent présente le cas dramatique d’un enfant né avec la moitié du nez et ayant subi de multiples opérations dans son enfance. Sa mère a travaillé dans une usine produisant du téflon (et du PFOA) et il a été exposé à cette substance pendant toute la période in utero.
Enfin, de part leurs caractéristiques physico-chimiques, les POPs ont tendance à s’accumuler dans les graisses et leurs effets peuvent être amplifiés le long de la chaîne alimentaire. C’est le cas bien connu du DDT que j’ai traité dans l’article « Les douze salopards ».
Une partie de ces composés sont donc réglementé au niveau mondial par la Convention de Stockholm (pour la Suisse). Les pays signataires d’engager à ne pas produire, vendre, acheter ou utiliser de tels substances.
En 2009, s’est ajouté à la liste des 12 salopards, l’acide perfluorooctanesulfonique ou PFOS, un cousin du PFOA.
Ces deux substances font partie de la grande famille des perfluorés. Ce sont des substances chimiques dont les atomes de carbones sont saturés en fluor. Parmi la vingtaine de composés perfluorés, le PFOS et le PFOA sont actuellement ceux dont la toxicité est la plus importante. Pour ce qui est connu…
Le PFOS est inclu dans la Convention de Stockholm, donc réglementé, mais pas le PFOA. Cependant des pays comme la Norvège appellent à sa réglementation car sa grande toxicité ne semble plus faire de doutes.
Mais n’est-ce pas un peu tard? En 2015, Greenpeace a ainsi montré qu’on trouvait des composés perfluorés même sur le toit du monde.
Alors quelles sont les sources et que peut-on faire?
On a déjà parlé des poêles en téflon. On peut en trouver sans PFOA, mais se pose alors la question de la substances utilisée à sa place et de sa dangerosité? Sinon il est possible d’utiliser des poêles en fonte par exemple.
Cependant, les poêles ne sont de loin la source principale de composés perfluorés. Ils sont en effet utilisés largement dans les textiles pour leurs effets « repellents ». Vous savez, quand l’eau que vous versez sur votre canapé ne pénètre pas le tissu, mais coule dessus…
Ainsi, dans une autre campagne, Greenpeace a montré en 2013 que ces composés étaient présents dans la majorité des vestes de montagne…celles dont on veut qu’elles résistent à la pluie et à la neige. Par association, on peut se douter qu’on les trouvent aussi dans les vestes et les chaussures résistants à la pluie…que l’on utilise tout l’hiver.
Certes, ces vêtements et textiles high tech sont intéressants. Plus besoin de se préoccuper de prendre un parapluie ou de frotter pour détacher des salissures sur le tapis, le liquide coule sur le tissu et ne l’imprègne pas. Mais ce confort a peut-être un prix que nous ne connaissons pas encore au vu de la toxicité des composés perfluorés.
A mon sens, les composés perflorés devraient être réservés pour des utilisations spécifiques. Par exemple en médecine, il est important d’avoir des habits qui n’absorbent pas les liquides au contact du sang ou des vomissures des malades.
Mais nous n’en avons pas vraiment besoin dans nos habits de tous les jours.
Du cuivre à revendre!
En ce début d’année, parlons un peu de la pollution par les métaux, thème que je n’ai pas beaucoup abordé jusqu’à maintenant.
Les problèmes de pollution métalliques et leurs impacts sur l’homme et l’environnement ne sont pas nouveaux. Au Moyen-Âge déjà, les tanneries rejetaient leurs effluents dans les rivières, et notamment du chrome, très toxique pour le vivant. Actuellement, 1.8 millions de personnes dans le monde, et notamment en Inde et au Bangladesh, sont encore impactées par les effluents de tanneries (source: worstpolluted).
L’arsenic est également un problème pour la sécurité d’approvisionnement en eau dans le monde. Plusieurs communes valaisannes sont d’ailleurs concernées, ceci à la suite de la révision de la valeur limite de l’OMS pour l’eau potable. Notons cependant que dans le cas de l’arsenic, il ne s’agit pas d’une pollution environnementale. L’arsenic présent dans l’eau est de source géogène, non liée à des rejets anthropiques.
Mais parlons un peu du cuivre. C’est un métal qui pollue de manière récurrente nos cours d’eau. On connaît la source de pollution agricole, le cuivre étant utilisé dans la vigne pour lutter contre le mildiou. Mais en milieu urbain, on en trouve également beaucoup. Et ceci n’est pas dû au traitement de la vigne.
En 2011, nous avions établi un bilan du cuivre rejeté par la région lausannoise dans la Baie de Vidy. En tout, 1500kg y sont rejetés chaque année, dont quelques 900kg finissent dans les sédiments.
La majorité de ces rejets se font lors des pluies, soit environ 10kg par évènement de pluie.
Mais pourquoi le cuivre est-il emmené par la pluie?
Si on regarde en détail les sources de pollution, on s’aperçoit qu’environ 1000kg/an sont liés au trafic routier. En premier lieu l’usure des lignes aériennes de bus qui entraîne une pollution de 670kg/an. L’usure des freins des voitures contribue quant à elle pour pas moins de 140 kg/an.
Ces particules de cuivre se déposent sur les routes et sont entrainées vers le milieu naturel par les pluies. En effet, en milieu urbain, une grande parties des eaux de route est rejetée directement dans les cours d’eau lors d’évènements pluvieux.
Il existe des solutions pour limiter ces rejets. Le nettoyage des routes en est un. Il permet de récupérer les poussières et d’éviter la pollution des eaux. Un autre système consiste à placer des « chaussettes » filtrantes dans les bouches d’égouts. Assez cher, et demandant un entretien régulier, ce système n’en est pas moins efficace.
Les bateaux contribuent quant à eux pour près de 43kg par an. En effet, les coques sont maintenant recouvertes de cuivre pour éviter le développement d’algues ou de coquillages. Bien moins toxique que les précédents produits « anti-foulings » comme le tributhylétain ou l’irgarol, le cuivre n’en est cependant pas moins également un polluant.
Mais dans la région lausannoise, c’est l’usage du cuivre pour les toitures et les chenaux qui contribue le plus à la pollution de la Baie de Vidy. Pas moins de 840 kg par an sont ainsi entrainés par les eaux de pluie.
Dans la construction, le cuivre est utilisé pour limiter le développement d’algues ou de moisissures sur les toitures ou dans les évacuations d’eau. Comme pour les bateaux, ce métal est utilisé pour son action toxique. Il n’est donc pas surprenant qu’il puisse ensuite être également toxique pour l’environnement.
Comme dans le cas des routes, il existe des solutions pour retenir le cuivre au bas des façades par des matériaux filtrants. Malheureusement, cette pratique n’est que rarement mise en place.
Avec les estimations que nous avons faites, nous pouvons évaluer le pollution des sédiments de la Baie de Vidy à 250 mg/kg en moyenne, ce qui n’est pas loin de la réalité. Or cette valeur se situe en dessus des valeurs d’effets pour les organismes aquatiques. Le cuivre a donc certainement un impact non négligeable sur la biologie de la Baie.
Le cuivre, mais également d’autres métaux comme le zinc, peuvent donc être un problème pour nos écosystèmes en milieu urbain. Comme dans le cas des eaux de routes, des solutions sont cependant possibles pour réduire les charges de ce qui est rejeté dans les eaux. A nous de les mettre en place!
Référence:
Chèvre et al. 2011. Substance flow analysis as a tool for urban water management. Water Science and Technology 63: 1341-1348.
La procédure d’homologation des pesticides a-t-elle du sens?
Le journal le Monde titrait aujourd’hui sur les recherches biaisées qui ont permis au pesticide chlorpyriphos d’obtenir son autorisation de mise sur le marché en 1990, citant une étude scientifique parue dans la revue Environmental Health le 16 novembre.
L’occasion de revenir sur la procédure d’homologation des pesticides et ses contradictions.
Depuis le scandale du DDT dans les années 60, les gouvernements occidentaux ont mis en place des législations contraignantes pour la mise sur le marché des pesticides.
J’insiste sur les mots « gouvernements occidentaux« . En effets, de nombreux pays n’ont toujours pas de législations contraignantes et des pesticides interdits depuis longtemps chez nous y sont encore utilisés. C’est le cas du paraquat ou du diafenthurion, qui faisait l’objet d’un reportage de la rts en septembre dernier. Certes, me direz-vous, ils sont épandus bien loin de chez nous. Peut-être, mais ils nous reviennent parfois via la nourriture importée que nous mangeons. Ainsi le riz peut en contenir des traces.
Donc chez nous, la mise sur le marché des pesticides est régulée par un processus d’homologation bien défini. Nous devrions ainsi n’avoir dans le commerce que des substances qui, utilisées correctement, ne présentent de risque ni pour l’homme, ni pour l’environnement.
Malheureusement cette procédure bien rodée comporte des biais.
D’abord, les données de toxicité et d’écotoxicité des substances candidates sont générées par les industriels. Les gouvernements qui reçoivent les demandes n’ont pas les moyens de refaire les tests par eux-mêmes. Il faut savoir que ces tests coûtent plusieurs dizaines à plusieurs centaines de milliers de francs. Et que les résultats représentent une armoire pleine de classeurs fédéraux. Aucun moyen d’aller vérifier les données avec l’argent public.
Ensuite ces données sont en Suisse confidentielle. Tout scientifique qui voudrait comparer avec ses propres données n’y a pas accès.
Mais le point le plus critique est lié aux méthodologies utilisées pour créer ses données. En effet, les tests sont effectués dans des conditions réglementées, suivant des bonnes pratiques de la laboratoire. L’idée est que ces tests soient reproductibles et puissent être contrôlés (ce qui sur le fond est une bonne idée).
Ces règles sont fixées par des organismes comme l’OECD, ou encore AFNOR pour la France et DIN pour l’Allemagne. Or dans les comités qui fixent les normes siègent des scientifiques, des représentants de l’administration, mais également des industriels. Ces normes sont donc des consensus qui peuvent prendre en compte des critères économiques par exemple. Les tests doivent être courts pour ne pas coûter trop chers.
L’exemple récent des néonicotinoïdes et de leurs effets sur les abeilles, et maintenant la dénonciation des effets neurologiques du chlopyriphos sur les rats montrent bien les limites du système: les tests actuellement effectués pour l’homologation ne sont pas forcément adéquats pour protéger notre santé et notre environnement.
Alors quelles sont les solutions possibles?
Pour ma part, j’en vois en tout cas deux.
Premièrement, que les données des dossiers d’homologation soient accessibles au public et puissent donc être questionnées. C’est ce qui semble avoir été fait dans le cas du chlorpyriphos puisque les scientifiques ont ré-interprété des données différemment en utilisant d’autres statistiques.
Deuxièmement, que les normes de tests puissent être adaptées en fonction des problèmes actuels. De nombreux tests datent des années 70 et considèrent des effets sévères d’une seule substance sur de courtes périodes. Or les problèmes actuels sont liés à une exposition sur le long terme à un mélange de substances chimiques.
La procédure d’homologation, avant la mise sur le marché d’une substance, est un garde fou extrêmement important. Elle doit donc être crédible et scientifiquement fondée. Nous avons tous à y gagner.
Glyphosate ou pas glyphosate? Est-ce vraiment la question?
Depuis maintenant plusieurs années, le glyphosate déchaîne les passions. On ne compte plus le nombre de manifestations pour son interdiction.
Le journal le Monde publiait d’ailleurs le 19 octobre un article sur les députés de la République en Marche, en France, insultés par des citoyens pour avoir voté contre l’interdiction du glyphosate.
Le glyphosate est la molécule herbicide la plus utilisée en Suisse et en Europe. Dès que les méthodes pour la rechercher dans l’environnement ont été au point, on l’a trouvée partout, du milieu aquatique à l’alimentation en passant par les serviettes hygiéniques.
Depuis 2015, le débat fait rage autour de ces potentiels effets cancérigènes. Le Centre International de Recherche sur le cancer, organe de l’OMS, l’a classé comme cancérigène probable. Mais les études peinent à faire un lien entre cette molécule et un risque de développement de cancer.
On est tous d’accord. Une molécule présentant un risque pour la santé et/ou pour l’environnement devrait être retirée du marché.
Cependant, est-ce que seul le glyphosate doit être mis sur la sellette? Est-ce que son interdiction rendrait notre monde plus sain et plus sûr? Je suis loin d’en être convaincue.
Au contraire, focaliser le débat sur le glyphosate, c’est oublier les quelques 399 autres substances pesticides autorisées en Suisse.
Le glyphosate est peut-être cancérigène? Certes. Mais si ce danger a pu être mis en évidence, c’est que cette substance a été beaucoup étudiée. Alors quand est-il des autres pesticides? Avec le même nombre d’études scientifiques à la clé, ne découvrirait-on pas également des effets délétères graves pour l’être humain et l’environnement?
Ainsi l’atrazine, substance longtemps utilisée dans les champs de maïs en Suisse, a été mise en cause dans la féminisation des amphibiens aux Etats-Unis au début des années 2000. Comme dans le cas du glyphosate, les potentiels effets endocriniens de l’atrazine ont fait l’objet d’un débat très musclé au sein de la communauté scientifique et de l’industrie.
Cette substance est interdite en Suisse depuis 2010 (souvent remplacée par le glyphosate…). Mais ses cousins de la même famille, comme la terbuthylazine, encore utilisés, n’ont pas été étudiés pour des effets autres qu’herbicides. Aurons-nous alors les mêmes débats lorsqu’un(e) chercheur(se) se sera penché sur la question?
Une étude parue le 22 octobre dans le journal JAMA International Medicine fait un constat fondamental pour moi. Après avoir étudié près de 70’000 personnes pendant 7 ans, ils concluent que les personnes mangeant très régulièrement des produits bio (qu’on suppose contenir peu ou pas de pesticides) avaient moins de risque de développer un cancer. Ce résultat est particulièrement pertinent car les auteurs ont tenu compte d’autres facteurs (activité sportive, fumée, etc.) qui pourraient jouer un rôle dans le développement de cancer.
Il semble donc que c’est notre exposition à un mélange de pesticides qui pose problème, et non au glyphosate seul!
Arrivé à ce stade de mon article, vous pourriez penser que je suis contre l’interdiction du glyphosate. Ce n’est pas mon propos. Comme déjà mentionné, si une substance est dangereuse pour la santé ou pour l’environnement, elle doit être retirée du marché.
MAIS
Il ne faudrait pas réduire la question de la toxicité des pesticides au seul glyphosate. Il est nécessaire de réduire notre exposition à l’ensemble de ces substances (et même à l’ensemble des substances chimiques!). Les pesticides polluent l’environnement et notre corps via leur utilisation agricole, mais également via les autres usages que j’ai détaillé dans d’autres posts (peinture, bois, colliers anti-puces et autres anti-insectes, etc…).
Le monde agricole a pris conscience de ce problème et s’y attaque. Ainsi le canton du Valais vient d’annoncer un plan pour réduire de moitié l’utilisation de pesticides. Les autres cantons s’y attellent aussi. De nombreux agriculteurs cherchent par eux-mêmes des solutions.
Mais que font les autres secteurs qui emploient des pesticides, tel le secteur de la construction? A ma connaissance pas grand chose.
ET SURTOUT
L’histoire nous montre que l’interdiction d’une substance entraîne sa substitution immédiate (voir post sur les substances ignifuges). Aux Etats-Unis, c’est le dicamba qui a remplacé le glyphosate sur les plantes devenues résistantes à ce dernier. Or le dicamba fait des ravages sur les cultures avoisinantes des champs traités. Et à priori il n’est pas moins toxique que le glyphosate. Il y a juste moins d’études sur les effets sur la santé.
La polémique sur le glyphosate a le mérite d’avoir fait prendre conscience au public des effets sur la santé (et sur l’environnement) des substances pesticides.
Ces substances ont été développées pour tuer! Tuer des ravageurs certes, mais elles sont de fait très toxiques! Et leurs effets ne se limite malheureusement pas aux seuls organismes contre lesquelles elles sont sensées lutter (comme le prétendait la pub pour le glyphosate des années 90). Nous baignons dans ce que que nous utilisons.
Cette polémique a également le mérite d’avoir mis en évidence le pouvoir des multinationales de la chimie et l’importance des lobbys. Ce n’est pas rien.
Mais au-delà de l’interdiction du glyphosate, il est urgent de repenser notre utilisation massive de substances chimiques au quotidien. Certaines applications ont leur utilité, beaucoup n’en ont pas. Il temps de faire le tri!
Référence:
Baudry et al. 2018. Association of Frequency of Organic Food Consumption
With Cancer Risk. Findings From the NutriNet-Santé Prospective Cohort Study. JAMA International Medicine.
Sass and Colangelo, 2006. European Union Bans Atrazine, While the
United States Negotiates Continued Use. International Journal of Occupational Environmental Health 12: 260–267.
Traitement du bois et pesticides
Dans mon dernier article, je vous parlais de notre découverte, un peu par hasard, de l’usage des pesticides dans les peintures pour bâtiments.
A la suite de ces études, nous nous sommes penchés sur d’autres matériaux de construction. L’un d’entre eux nous semblait évident…le bois.
Pour ne pas pourrir trop vite, le bois doit être protégé contre les champignons et les insectes. La plupart des traitements sont à base de pesticides utilisés comme biocides (insecticides, fongicides, algicides, etc. voir article précédent). Le bois peut être imprégné avec ces produits ou il peut être peint. L’imprégnation se fait en général en scierie. Il y a deux procédés possibles: (1) le procédé en autoclave qui permet de protéger le bois jusqu’au centre de la pièce et (2) le procédé par trempage qui ne protège le bois que sur les premières couches. L’application externe, en revanche, se fait généralement avant la pose ou lorsque la pièce est en place.
Comme dans le cas des peintures, les substances utilisées peuvent être lessivées par les pluies et finir dans les lacs et les cours d’eau.
En 2008, nous avions essayé d’évaluer quelles étaient les pesticides les plus couramment utilisés pour protéger le bois, et quel pouvait être leur impact sur l’environnement. En effet, comme je l’avais également déjà mentionné dans plusieurs articles, il n’existe pas de liste des substances chimiques utilisées pour les différents usages. La démarche consiste donc à répertorier tout ce qui pourrait être potentiellement utilisé.
Nous nous sommes basés sur un « répertoire des produits utilisés pour le traitement du bois », répertoire publié par l’Office fédérale de l’environnement en 2008. Cette liste contenait 308 produits homologués (qui peuvent être mis sur le marché) et nous avons relevé 51 substances actives.
Parmi elles, 9 substances organiques de synthèse ont une toxicité très élevée. Il s’agit principalement de fongicides comme le propiconazole ou le carbendazime, ou encore d’insecticides neurotoxiques comme la permethrine.
Des molécules inorganiques comme le chrome ou plus communément le cuivres sont également inclues dans la liste. C’est d’ailleurs le cuivre qui colore en vert certaines pièces de bois que l’on peut acheter dans le commerce.
Tout cela reste cependant très théorique. Ce sont des substances que l’on retrouve dans des produits pour traiter de le bois, mais nous n’avons aucune idée lesquelles sont réellement utilisées et dans quelle quantité.
Cependant, il faut savoir que les fongicides et les insecticides cités ci-dessus sont régulièrement détectés dans les eaux de surface. Bien sûr, difficile de déterminer quelle est la part due à l’agriculture et celle due au traitement du bois.
Toutefois, de manière intéressante, les fongicides propiconazole et carbendazime sont régulièrement mesurés dans les eaux des stations d’épuration. Ils ont donc une source urbaine qui pourrait, en partie, être liée au traitement du bois.
En 2008, un étudiant de l’Université de Franche-Comté s’était penché sur les effets des substances utilisées pour le traitement du bois (fongicides et insecticides) en aval d’une scierie. Il avait montré que non seulement ces substances se retrouvaient dans l’eau de la rivière proche de la scierie, mais qu’on les détectait aussi dans les sédiments sur au moins 2km en aval. L’entrainement se faisait principalement lors des pluies. Il a également montré que ces substances, en particulier les insecticides, avaient un impact non négligeable sur les communautés d’invertébrés vivant dans ce milieu.
Que conclure de tout cela?
Ces exemples montrent que les sources de pesticides sont beaucoup plus variées que ce que l’on peut imaginer au premier abord. Et les sources non agricoles semblent bien contribuer de manière significative à la pollution des eaux, ceci au moins localement. Malheureusement, il n’existe pas de liste des différents usages pour ces substances chimiques. Et sans cela, nous continuerons de trouver, un peu par hasard, des sources inattendues.
Références:
Kleijer A, Chèvre N, Burkhardt M. 2008. Biocides et protection du bois. Liste des substances chimiques à surveiller. gwa 12: 965-973.
Adam O. 2008. Impact des produits de traitement du bois sur les amphipodes Gammarus pulex (L.) et Gammarus fossarum (K.) : approches chimique, hydro-écologique et écotoxicologique. Thèse de doctorat. Université de Franche-Comté.
Des pesticides dans les peintures
On associe volontiers les pesticides à l’agriculture. Or ceux-ci ne sont pas uniquement utilisés pour protéger les cultures.
C’est une découverte que nous avons fait au début des années 2000, un peu par hasard. A cette époque, je travaillais à Zürich, à l’Eawag. Les méthodes analytiques avaient fait de grandes avancées et nous étions capables de détecter plusieurs pesticides en même temps à des concentrations très faibles.
Nos collègues ingénieurs cherchaient à évaluer la pollution due aux eaux de ruissellement. Ces eaux qui « lavent » les routes finissent dans beaucoup d’endroits directement dans les cours d’eau. Or on savait qu’elles contenaient beaucoup de métaux (dépôts lié à l’usure des voitures et des bus) et de ce fait contaminaient les sédiments des rivières de manière importante.
Un peu par hasard, nos collègues nous ont demandé de mesuré des pesticides dans ces eaux de ruissellement. On s’attendait à ne rien trouver puisque ces eaux ne provenaient pas de régions agricoles.
Mais Oh surprise, les concentrations en certains pesticides, tel le diuron (un herbicide utilisé dans la vigne), étaient tout aussi élevées que dans les régions agricoles. Plus étonnant, on trouvait des pesticides non autorisés en agriculture comme la terbutryne.
Ceci méritait quelques investigations.
D’abord, on s’est rendu compte que la plupart des pesticides détectés étaient des herbicides qui inhibaient la photosynthèse, soit des substances sensées lutter contre le développement de plantes ou autres producteurs primaires. Ensuite, ces pesticides étaient principalement détectés dans les eaux de ruissellement, mais peu dans les eaux usées. C’était donc bien la pluie qui les amenaient avec elle.
De fil en aiguille, on en est venus à s’intéresser aux peintures de façades des bâtiments.
En effet, si vous regarder un mur qui a déjà quelques années, vous verrez qu’il se couvre d’une couche noire/verte par endroits. Ce sont des algues et des champignons. Aucun danger pour la structure du bâtiment, mais ce n’est pas très esthétique. On ajoute donc à la peinture des algicides (appelés aussi herbicides dans d’autres cas car ils agissent sur les producteurs primaires) pour lutter contre cette mousse verte.
Mais pourquoi retrouve-t-on ces substances dans les eaux?
Pour deux raisons principales:
– Pour que la substance exerce sa toxicité contre les algues, il faut qu’elle soit dissoute. Elle se dissout donc dans l’eau de pluie, et est entrainée par elle. De ce fait, l’action toxique diminue avec l’âge de la peinture car elle perd au fur et à mesure le pesticide.
– De plus, personne ne s’est jamais posé la question de la dose utile. On ajoute donc ce pesticide dans la peinture à XX% (je ne sais pas quel est ce pourcentage car il n’est pas déclaré sur l’étiquette) au petit bonheur la chance.
En 2009, une étude menée par un collègue de la HES de Rapperswil montraient que les concentrations dans les eaux ruisselant le long de nouveaux bâtiments étaient si élevées qu’elles devraient être diluées 10’000x à 100’000x pour respecter la valeur limite de 0.1 μg/l dans les eaux de surface.
A titre d’exemple, les eaux de ruissellement à la base d’un bâtiment de 10 mètres de haut, sans toiture, et âgé de 8 mois, contenaient des concentrations en terbutryne (algicide) sur les façades sud-ouest et nord-ouest entre 100 et 800 μg/l. Par événement de pluie, les quantités émises sont en moyenne de 600 μg pour la façade sud-ouest et de 1300 μg pour la façade nord-ouest, ceci par mètre courant.
Mais est-ce légal d’ajouter des pesticides dans les peintures de bâtiments?
Oui ça l’est. Il faut savoir que le terme « pesticide » n’existe plus pour la Loi. On distingue ainsi les substances phytosanitaires (ou phytopharmaceutiques…) utilisées en agriculture, des biocides, soit des substances permettant la conservation du produit. Cependant, cela peut être exactement les mêmes substances chimiques. Elles suivent juste des chemins différents pour être autorisées sur la marché Suisse. Les substances phytosanitaires tombent sous le coup de l’Ordonnance sur les produits phytosanitaires et sous l’égide de l’Office Fédérale de l’Agriculture, alors que les biocides sont sous le coup de l’Ordonnance sur les produits biocides et sous l’égide de l’Office Fédérale de l’Environnement.
Ainsi le cas de la terbutryne est intéressant. Elle n’est pas autorisée en agriculture. Je suspecte que c’est parce qu’elle est particulièrement toxique. En effet, appartenant à la même famille que l’atrazine (les triazines), elle est 10x plus toxique que cette dernière. La loi sur les produits biocides étant inexistante avant 2005 et moins stricte que celle sur les produits phytosanitaires après 2005, elle peut donc être inclue dans les peintures.
Le cas du mécoprop, un anti-racinaire incorporé dans les revêtements bituminueux est encore plus emblématique du grand flou qui régit la mise sur le marché des substances chimiques. Il est déclaré comme additif, et peut donc être utilisé sans souci et sans passer ni par l’Ordonnance sur les produits phytosanitaires, ni par celle sur les produits biocides.
Dix ans après ces études, des herbicides sont toujours utilisés dans les peintures de façade et on les détecte toujours dans les eaux de ruissellement.
Pourtant des alternatives existent. Par exemple, des chercheurs ont mis au point des revêtements poreux qui évitent la stagnation de l’eau sur les façades et donc le développement d’algues.
Autre solution, revenir à des bâtiments avec des avants-toits. Ceci évite le ruissellement de la pluie sur les façades et donc le lessivage des pesticides vers les cours d’eau.
Références:
Burkhardt M, Zuleeg S, Marti T, Boller M, Vonbank R, Brunner S, Simmler H, Carmeliet J, Chèvre N. 2009. Biocides dans les eaux de façades. Solutions à trouver. ARPEA 241: 13-16.
Vous reprendrez bien un peu de cet effet cocktail?
Récemment, plusieurs articles ont été publié sur l’effet cocktail. En juin 2018 notamment, des chercheurs de l’INRA et de l’INSERM en France ont mis en évidence les effets d’un cocktail de pesticides sur les souris. Ils ont exposé des mâles et des femelles à un mélange de 6 substances communément utilisées dans l’agriculture pendant environ une année. Pour chaque pesticide, la dose d’exposition correspondait à la dose journalière admissible pour l’homme. A la fin de l’expérience, ils ont observé que les mâles prenaient du poids et devenaient diabétiques. Les femelles semblaient mieux protégées, mais développaient d’autres symptômes.
La dose journalière admissible pour l’homme est calculée sur la base de tests effectués sur les souris et les rats. La concentration sans effets observés lors des tests est divisée par un facteur de sécurité compris entre 10 et 1000. Cette dose devrait donc est sûre…
…oui peut-être, mais pour une seule substance et pas pour un mélange ou « cocktail ».
Qu’est-ce donc que l’effet cocktail?
A la fin des années 90, un groupe d’écotoxicologues allemands se penche sur les effets combinés de substances chimiques. Ils reprennent un classification publiée dans les années 50 par Plackett et Hewlett, des chercheurs qui ont tenté de caractériser les effets des mélanges sur l’être humain. Les propositions sont restées théoriques, car coûteuses à valider sur des souris, et impossible bien sûr à valider sur l’homme.
Or en écotoxicologie, nous testons des organismes avec des cycles de vie très courts. C’est le cas de la bactérie marine luminescente Vibrio fisheri, qui donne une réponse en 10mn (on mesure la diminution de la luminescence).
Les chercheurs allemands ont donc eu l’idée d’utiliser ces bactéries pour évaluer les effets des cocktails de substances chimiques. Au début des années 2000, ils ont ainsi montré dans le projet européen BEAM que deux modèles permettaient de prédire les effets des mélanges: le modèle d’addition des concentration et le modèle d’indépendance des effets.
En bref, le premier considère que toutes les substances agissent de la même manière (par exemple toutes les substances inhibent la photosynthèse). Dans ce cas, l’effet du cocktail est dû à toutes les concentrations additionnées, pondérées par la toxicité intrinsèque de chaque substance. Le deuxième modèle considère que toutes les substances agissent dans l’organisme de manière différente (inhibition de la photosynthèse et action sur le système nerveux par exemple). L’effet cocktail correspond alors à une addition des effets.
Dans la réalité, les organismes sont exposés à des substances ayant des manières d’agir semblables et dissemblables. Le premier modèle sur-estime donc les effets des mélanges et le deuxième les sous-estime.
Dans un souci de sécurité, les auteurs suggèrent donc d’introduire dans la Loi des valeurs limites basées sur le premier modèle (addition des concentrations).
Or depuis 2003, et malgré les nombreuses publications allant dans le même sens, aucune modification de la Loi. Que ce soit pour les denrées alimentaires ou pour l’environnement, les normes sont toujours fixées pour chaque substance individuellement. Aucune prise en compte de l’effet cocktail à l’horizon.
Pourquoi en 15 ans, n’a-t-on donc pas été capable de prendre en compte cet effet de mélange pour protéger notre santé et les espèces de l’environnement?
Je n’ai pas la réponse à cette question.
Cependant, certainement que le facteur économique joue un rôle important. Si on prenait en compte les mélanges, les normes diminueraient drastiquement et un certain nombre de substances disparaîtraient du marché.
La mise en pratique est également délicate. Prenons le cas d’un cours d’eau dans lequel les concentrations des substances prises en mélange sont trop élevées. Lesquelles, dans ce mélange, devront être diminuées, voir supprimées? Cela semble faire le lit de discussions à rallonge.
Mais au-delà de ces aspects, force est de constater que nous-mêmes, scientifiques, sommes bien empruntés pour proposer des valeurs limites concrètes pour les mélanges. Comme je le mentionnais dans un blog récent (un manque criant de données), nous sommes, à l’heure actuelle, en mesure d’évaluer les effets des mélanges pour quelques 50 substances grand maximum (essentiellement des pesticides) et ceci pour quelques espèces seulement.
Or nous sommes entourés par plusieurs centaines de milliers de substances chimiques présentes dans l’air, le sol ou l’eau.
Par précaution, il semble donc important et urgent de diminuer au maximum l’utilisation des substances chimiques, de même que leur rejet dans l’environnement!
Je pense très sincèrement que la chimie à amené certains avantages (notamment en médecine et en agriculture), mais le développement et l’utilisation à tout va de substances chimiques est très préoccupant et mets sérieusement en danger notre futur et celui des écosystèmes.
A titre d’exemple, l’utilisation de déodorants d’air intérieur me laisse toujours perplexe. Ces produits sont allergènes et irritants, mais on les spray même dans la chambre des enfants.
Autre exemple, les bloc-wc servent peut-être à colorer l’eau des toilettes, mais ils envoient dans les eaux de surface des biocides toxiques et des colorants. Est-ce vraiment utile?
Il existe ainsi des dizaines d’exemples de substances qui sont utilisées pour rien ou pour un confort tout relatif, mais qui contribuent de manière non négligeable à la pollution de l’environnement.
Pour ne pas paraître trop pessimiste, l’Office fédérale de l’environnement est en train de plancher sur la prise en compte de l’effet des mélanges pour les pesticides et les médicaments dans les eaux. C’est un premier pas.
A noter: on confond souvent l’effet cocktail avec un effet synergique des substances chimiques. Ce n’est pas le cas. L’effet synergique signifie qu’une substance va aider une autre à agir. L’effet conjoint sera donc beaucoup plus important que les effets individuels. C’est ce qui est recherché dans les formulations de pesticides ou dans certaines thérapies médicinales. C’est le cas également du pamplemousse par exemple, qui ne doit pas être consommé en même temps que certains médicaments car il peut en augmenter l’effet. A l’inverse, l’effet antagoniste est la diminution de l’effet d’une substance par une autre. Dans l’environnement cependant, le nombre de substances chimiques et si important que les effets synergiques et antagonistes sont marginaux. Le modèle d’addition des concentrations suffit pour prédire les effets des mélanges.
Références:
Backhaus et al. 2003. The BEAM-project: prediction and assessment of mixture toxicities in the aquatic environment. Continental Shelf Research 23. Pages 1757-1769.
Gregorio V, Chèvre N. 2014. Assessing the risks posed by mixtures of chemicals in freshwater environments. Case study of lake geneva, Switzerland. Wires Water doi: 10.1002/wat2.1018.
Lukowicz C et al. 2018. Metabolic effects of a chronic dietary exposure to a low-dose pesticide cocktail in mice: sexual dismorphism and role of the constitutive androstane receptor. Environmental Health Perspectives.
Plackett and Hewlett. 1952. Quantal responses to mixtures of poisons. Journal of the Royal Statistical Society. Serie B. Volume XIV (2). Pages 143-163.
Les cosmétiques c’est fantastique
Dès l’après-guerre, les pesticides ont commencé à être utilisés à large échelle et ils ont largement contribué à ce que l’on appelle la « révolution verte« . Or ces substances ont été développées pour être toxiques, et après la mise en évidence des effets désastreux du DDT par Rachel Carson dans les années 60, les scientifiques et le public ont commencé à se méfier de l’utilisation des pesticides.
Dès la fin des années 1980, on a ainsi vu apparaître des législations pour réglementer la mise sur le marché des pesticides. En parallèle, les scientifiques ont commencé à chercher ces polluants dans l’environnement et les gouvernements ont mis en place des législations définissant des valeurs limites, notamment dans les eaux.
Ce travail n’était pas simple. Les techniques analytiques pour rechercher les substances chimiques dans l’environnement en étaient à leurs balbutiements et il n’était possible de ne chercher qu’une ou deux substances à la fois, et encore à des concentrations assez élevées.
Dès les années 2000, les outils analytiques se sont perfectionnés rapidement, et il a ainsi été possible à la fois de diminuer les limites de détection, mais aussi de chercher des dizaines de substances à la fois. C’est à cette époque que les scientifiques ont commencé à s’intéresser au médicaments dans l’environnement. On s’est ainsi aperçu que l’on trouvait de nombreux résidus dans les eaux, médicaments issus de la consommation humaine.
Mais pesticides et médicaments ne sont pas les seuls polluants issus de nos activités quotidiennes. Et depuis très récemment, nous avons commencé à nous pencher sur le cas des substances cosmétiques.
Or le défi est de taille: si il existe 400 pesticides et 2000 médicaments sur le marché, il y a plus de 6000 substances cosmétiques utilisées au quotidien. Il est à l’heure actuelle impossible de toutes les chercher, et encore moins d’évaluer leurs effets.
Donc si l’on veut s’intéresser aux cosmétiques, il faut d’abord faire un tri qui permettra de mettre en évidence les substances potentiellement les plus problématiques, ceci afin de les chercher dans l’environnement et notamment dans l’eau.
C’est un travail que nous effectuons en collaboration avec le Service de l’eau de la Ville Lausanne. Dans un premier temps, nous avons décidé de nous focaliser sur les shampoings pour cheveux normaux et les gels douches.
Première étape et non la moindre, il a fallu commencer par répertorier toutes les substances contenues dans ces cosmétiques. Heureusement, la loi suisse oblige les fabricants à mentionner toutes les substances contenues dans le produit. Toutes? Non pas tout-à-fait car les parfums sont mentionnés comme tels et la ou les substance(s) chimique(s) le composant ne sont pas nommée(s).
De manière intéressante, nous avons remarqué que le marché des cosmétiques est assez mouvant. En effet, les compositions changent très rapidement et il arrive que les ingrédients trouvés à une date donnée ne soient plus les mêmes quelques semaines après.
Qu’avons-nous donc appris?
L’essentiel des produits sont constitués à plus de 70% d’eau. L’eau est donc toujours en première position dans la liste des ingrédients. En effet, les composés sont donnés par ordre décroissant en terme de quantité, sauf pour les composés en dessous de 1% qui sont mélangés.
Gel douches et shampoings sont ensuite constitués de tensioactifs et de co-tensioactifs représentant jusqu’à 20% du produit. Environ 5% sont des adjuvants, soit des substances ajoutées à un produit pour améliorer ses propriétés, ainsi que des gélifiants.
Finalement, les ingrédients qui servent de support à la publicité pour le produit (odeur, par exemple abricot, et principes actifs, par exemple aloe vera), de même que les colorants et les conservateurs ne constituent que 0,5 à 3% du contenu.
Pas de grandes différences donc entre les différents gels douches, ou shampoings pour cheveux normaux. La base est la même et seuls quelques pourcents font la différence. Notons que c’est sur cette base (publicitaire) de que nous choisissons nos produits !
Après l’analyse de 252 gels douches et 52 shampoings, nous avons établi une liste de quelques 250 substances chimiques à étudier.
Ces substances ont été passées au crible des données connues de toxicité et d’écotoxicité et une liste prioritaire de 31 composés a été établie. Elle contient quelques tensio-actifs, mais surtout des adjuvants, des parfums et des conservateurs. Certains sont déjà connus comme le méthyl-paraben ou le phénoxyethanol.
Le Service de l’eau de la Ville de Lausanne est en train de développer des méthodes d’analyse pour chercher ces substances et d’ici quelques temps, nous devrions pouvoir savoir si on les trouve dans les eaux. Il faudra alors évaluer si elles présentent un risque important pour les écosystèmes aquatiques.
Référence:
Copin et al. 2018. Etude des gels douches et des shampoings. Que cache la liste des ingrédients des produits cosmétiques? Aqua & Gas no 6.
Des médicaments et des hommes
Au XXème siècle, la médecine a fait un bon en avant spectaculaire avec l’arrivée sur le marché de médicaments permettant de soigner de petits maux, mais également de sauver des vies. Antibiotiques, agents chimiothérapeutiques, substances agissant sur le système cardio-vasculaire, toutes ces molécules chimiques permettent de prolonger la vie, et leur utilisation ne saurait être remise en question.
Mais que se passe-t-il lorsque l’on ingère un médicament? Celui-ci va bien sûr avoir une action sur le symptôme que l’on souhaite traiter. Mais le corps va aussi se défendre contre cette substance étrangère et donc chercher à l’éliminer. Elle va ainsi être transformée, souvent pour la rendre plus soluble, et donc pouvoir être éliminée par les urines. Par exemple, un groupement polaire (soluble) peut être accolé à la substance (le paracétamol est éliminé par cette voie). Le foie, l’organe de détoxification de l’organisme, de même que les reins, sont ainsi en première ligne dans le mise en place de cette défense.
Les médicaments ingérés se retrouvent donc dans les urines, puis dans les toilettes, et vont suivre, avec les eaux usées, le long trajet jusqu’à la station d’épuration. Or les stations d’épuration ont été prévues pour éliminer le phosphore et l’azote, ainsi que la matière organique contenus dans nos déjections. Mais pas les substances chimiques de synthèse qui passent aisément les filtres physiques et biologiques. Pire, les bactéries des stations d’épuration peuvent casser la liaison avec les groupements polaires construits par le corps. On mesure ainsi une plus haute concentration de médicaments en sortie de station d’épuration qu’en entrée.
Les médicaments se retrouvent donc dans les milieux aquatiques, et ceci depuis maintenant des dizaines d’années. A l’échelle d’une ville, cela représente plusieurs kilos par jour qui sont ainsi rejetés dans le milieu naturel. Or même si elles se dégradent dans l’environnement, ces substances sont émises continuellement. On les appelle « pseudo-persistantes » car on les détecte de manière permanente dans les eaux. La vie aquatique y est donc continuellement exposée.
De manière générale, c’est la consommation humaine de médicaments qui représente la plus importante source de pollution des eaux. Mais pour certaines substances spécifiques, l’industrie contribue également, de même que l’agriculture via l’utilisation de médicaments vétérinaires.
Si la pollution des eaux par les médicaments est essentiellement liée à leur consommation, la mauvaise gestion des déchets y contribue également. Par exemple lorsque des restes de médicaments sont jetés dans les toilettes. Ramener ses médicaments périmés à la pharmacie ou à la déchetterie aide à diminuer leur entrée dans les systèmes aquatiques.
Il faut aussi souligner que contrairement à une idée reçue, les hôpitaux ne sont pas des sources très importantes de médicaments dans les eaux usées. A part pour certaines substances spécifiques, ils ne contribuent qu’à hauteur de maximum 5% à la pollution. Ceci s’explique par le fait que la plupart des traitements sont faits en ambulatoires. Les patients prennent donc les médicaments à l’hôpital, mais les excrètent à la maison.
Qu’en est-il donc de concentrations dans les eaux et des effets sur la faune et la flore?
Force est de constater que pour l’instant, on ne sait pas grand chose.
Sur les 2000 substances médicamenteuses existant sur le marché, on est capable d’en chercher une cinquantaine. Soit à peine 3%. On mesure donc actuellement la pointe de l’iceberg. On trouve des concentrations assez élevées proches des rejets des stations d’épuration, et celles-ci diminuent par dilution, voir par dégradation, lorsque l’on s’éloigne du point de rejet.
Et quels en sont les effets sur la vie aquatique me demanderez-vous?
Là encore, nous avons très peu de données et très peu de recul. Certainement que les effets se verront sur le long-terme, et qu’ils seront plutôt dus au cocktail de substances présentes, plutôt qu’à l’une d’entre elles en particulier.
Face à toutes ces interrogations et ces doutes, la Suisse a décidé de miser sur une meilleure élimination de ces substances en bout de tuyau, dans la station d’épuration, avant leur rejet dans l’environnement. Les techniques mises en place, soit une filtration avec du charbon actif, soit un dégradation par l’ozone, permettront de diminuer les rejets de médicaments dans les eaux.
Reste qu’il ne s’agit pas de solutions permettant une élimination complète des rejets médicamenteux. En effet, par temps de pluie, une partie des eaux usées sont rejetées directement dans le milieu naturel. De plus, certaines substances ne seront que peu éliminées par les techniques qui seront mises en place dans les stations d’épuration.
A mon sens, il convient donc de réfléchir également à la source, c’est-à-dire sur la consommation de médicaments. Et je pense que que le monde médical a un rôle clé à jouer ici. D’abord pour rappeler aux patients le bon usage des médicaments (ne pas les jeter dans les toilettes). Mais également pour sensibiliser le patient à l’impact sur le milieu naturel. Beaucoup de gens ont ainsi été effrayés par les traces de médicaments que l’on trouve dans l’eau potable en Suisse. Or ces traces proviennent avant tout des médicaments que nous consommons.
Photo de notre société, les eaux usées montrent que nous consommons énormément de médicaments contre les douleurs (anti-inflammatoires notamment) mais également d’anti-dépresseurs, de somnifères, d’anti-cholestérol, etc…
Une meilleure hygiène de vie et une consommation plus raisonnée de médicaments pourraient à long-terme préserver l’environnement, nos ressources en eau potable, mais certainement également notre santé.
Merci à John Steinbeck pour la libre interprétation de son titre « Des souris et des hommes »
Les 12 salopards
Le 22 mai 2001, 127 pays votent le texte de la Convention de Stockholm, issu du programme pour l’environnement des Nations Unies. Ce texte bannit 12 substances de la surface de la planète : les douze salopards. Il s’agit essentiellement de pesticides organochlorés, comme le DDT, mais aussi de produits industriels comme les PCBs ou encore d’impuretés comme la dioxine. La convention entrera en vigueur en mai 2004.
40 ans ! il a fallu plus de 40 ans pour que le monde prenne des mesures contre ces substances dont les effets ont été observés dès les années 60.
En effet, en 1962, « Silent spring », Printemps silencieux, fait grand bruit aux Etats-Unis. Rachel Carson, biologiste de formation, y dénonce les effets d’un insecticide le DDT. Cette molécule est utilisée à très large échelle depuis la fin de la deuxième guerre mondiale. Au Texas pour lutter contre les fourmis de feu qui remontent depuis le Mexique, au Nevada contre les sauterelles, ou encore quotidiennement contre les moustiques dans les maisons. Des images d’archives montrent même des enfants que l’on shampooing avec du DDT contre les poux.
Les conséquences sur la faune ne se font pas attendre. L’exemple du lac Clear en Californie est édifiant. Ce petit lac situé à 100km au nord de San Francisco est très prisé des pêcheurs. Malheureusement, il est aussi envahi par des moucherons dont les piqûres sont particulièrement désagréables. Une première application de DDD (un cousin du DDT) reste sans effet contre le moustique. Il est alors appliqué une deuxième fois avec une dose de 50mg/l, ce qui est très élevé. L’application est répétée une troisième fois. Rapidement, on retrouve une quantité d’oiseaux morts au bord du lac. Les concentrations de DDD dans les chaires de ces oiseaux atteignent 1600 mg/kg, soit des doses létales.
Quel est le problème ? Le DDT appartient à la famille des organochlorés. On y trouve le DDD, mais aussi l’hepatchlore, la dieldrin, etc…
Ces substances sont très toxiques, mais elles ont aussi la propriété d’être très lipophiles. En d’autres mots, elles se stockent dans les graisses. De plus, ce sont des molécules coriaces, très difficilement dégradables dans l’environnement.
Une fois dans les sols, elles vont être absorbées par les vers-de-terre et les insectes, eux-même consommés par les petits oiseaux, dont les prédateurs sont les oiseaux de proie. Comme ces substances sont accumulées dans les organismes, ce sont donc les super-prédateurs qui concentreront les quantités les plus élevées. Et c’est sur eux que l’on verra les effets les plus importants. C’est ce que l’on appelle la biomagnification.
Mais les effets de ces substances chez les superprédateurs ne sont pas seulement la mortalité.
Dans son livre, Rachel Carson documente un autre cas, celui des rouge-gorge sur le campus de l’Université du Michigan. En 1954, du DDT est appliqué contre les coléoptères. Dès 1955, on retrouve quantité de rouge-gorge morts (la dose léthale est atteinte après que l’oiseau ait consommé 11 vers-de-terres contaminés seulement…). Mais plus grave, dès 1956, la plupart des rouge-gorges du campus ne sont plus capables de se reproduire.
Rachel Carson a mis en évidence le premier « perturbateur endocrinien ». Le titre de son livre « Printemps silencieux » est en référence à ces printemps sans oisillons qui pépient.
Le livre de Rachel Carson fait donc grand bruit et Kennedy, alors président, nomme un comité scientifique pour vérifier les allégations de Rachel Carson.
Il faut dire que l’industrie a mis le paquet pour la faire passer pour une folle. En réponse à son livre, Monsanto publie un autre livre « The desolate year », envoyé à tous les décideurs américains, et qui traite Rachel Carson de « femme hystérique » ou de « vieille fille romantique ». Erza Taft Benson, secrétaire à l’Agriculture de 1953 à 1961 dira même : « Rachel Carson est probablement communiste, car sinon comment expliquer qu’une célibataire s’intéresse autant à la génétique? ».
Mais les travaux de la commission rendent justice à Rachel Carson. Et en 1953, elle propose à Kennedy une élimination progressive des pesticides persistants. Les travaux conduisent également à la création de l’US-EPA (agence de protection de l’environnement américaine), agence qui interdira l’usage du DDT en agriculture dès 1972.
L’Europe va suivre. Mais il faudra attendre près de 40 ans après la publication du livre de Rachel Carson pour voir émerger une réglementation mondiale, la Convention de Stockholm de 2001. Entre temps, le DDT et ses cousins ont atteints tous les points du Globe, transportés par les courants atmosphériques et marins.
Se concentrant au niveau des Pôles, ce sont les populations inuits qui sont les plus touchées, car elles consomment beaucoup d’animaux gras. Le lait maternel est très contaminé et met en danger la santé des nourrissons.
Malheureusement, Rachel Carson ne verra pas l’interdiction du DDT, puisqu’elle décède en 1964.
Depuis 2001, la Convention de Stockholm a été étendue à 21 substances, englobant d’autres produits industriels comme les polybromés, des retardateurs de flamme (voir article « substance ignifuges ») ou encore des perfluorés.
La prise de compte de chaque nouvelle substance est âprement discutée, car cela peut avoir des conséquences très importantes sur l’économie d’un pays. Ainsi, le cas de l’endosulfan, un insecticide organochloré utilisé pour la culture du riz. Proposé comme candidat, il n’a finalement pas été inclus dans la liste, sous la pression de pays producteurs de riz. Cela peut se comprendre aussi, c’est un pesticide bon marché qui peut être produit localement car le brevet est tombé. L’interdire pourrait contraindre les agriculteurs à acheter des produits beaucoup plus chers, sous brevets. Un exemple d’application du principe de réalité.
Je terminerai sur cette note. On me demande souvent pourquoi on n’interdit pas telle ou telle substance ? Je répondrais que le cas du DDT est emblématique de l’inertie du système: on a mis 40 ans à réglementer une substance donc les effets toxiques ont été très tôt reconnus…Cela montre pour moi qu’attendre des réglementations est souvent illusoire. D’autant que les nouvelles substances qui apparaissent sur le marché pour remplacer celles qui sont interdites se révèlent parfois bien pires (voir article « substances ignifuges »).
Personnellement, il me semble plus judicieux de réfléchir à une utilisation parcimonieuse des substances chimiques en général plutôt qu’à l’interdiction de quelques-unes. Il est également nécessaire de penser à un cycle de vie des substances plus respectueux de l’environnement, ceci allant de la production à la gestion des déchets.
Des contraceptifs et des poissons
La plupart d’entre vous ont entendu parlé du changement de sexe des poissons dû à la pilule contraceptive.
Mais qu’en est-il réellement? Est-ce que la pilule peut influencer le développement des poissons et par-là même leur reproduction?
La plupart des pilules contraceptives contiennent de l’ethynylestradiol, un composé similaire à l’estradiol, une hormone sexuelle féminine naturelle, importante pour la fertilité des femmes. Lors de la prise de la pilule, l’ethynylestardiol est absorbé par l’organisme, en partie transformé, puis éliminé, notamment via l’urine. La substance rejoint ainsi le réseau d’eaux usées via les toilettes, puis la station d’épuration. Or ces ouvrages, efficaces pour éliminer la matière organique, l’azote et le phosphore, ne sont pas conçus pour dégrader les substances chimique de synthèse. L’ethynylestradiol continue ainsi sont chemin vers les rivières et les lacs via les effluents de la station d’épuration.
Le premier groupe de recherche a avoir mis en évidence les effets induits par l’ethylnylestradiol dans l’environnement est l’équipe du Prof. Sumpter, au Brunel University à Londres. Ayant exposé des poissons à ce composé, ils se sont rendus compte que des concentrations très faibles, de l’ordre du ng/l*, empêchaient le développement de caractéristiques mâles chez les poissons de sexe masculin. Ainsi, le ratio mâles/femelles après 56 jours était de 50/50 chez les individus non exposés, alors qu’il était de 5/84 pour les individus exposés à une concentration de 4 ng/l, soit 17 fois plus de femelles. A cette même concentration, les mâles n’avaient pas développé de testicules après 172 jours.
De manière très intéressante, le Professeur Sumpter nous racontait, lors d’une conférence, qu’il avait dû soumettre son premier papier à plus de 3 journaux scientifiques avant qu’il ne soit accepté. Lui-même était persuadé qu’il tenait là des résultats majeurs, mais le monde scientifique n’était pas prêt à les entendre. L’avenir lui a cependant donné raison.
Pourquoi l’ethynylestradiol est-il si puissant?
Il faut savoir que ce composé synthétique est 10x plus actif que l’hormone naturelle féminine estradiol. Il a été développé dans ce but puisqu’il s’agit d’un composé « médicamenteux » dont on veut minimiser la dose à absorber. Sur les poissons, il est donc également bien plus toxique que l’hormone naturelle. Mais surtout il se dégrade moins facilement et donc reste actif plus longtemps.
En 2007, des chercheurs américains se sont lancé dans une expérience grandeur nature, certes discutable, mais qui a eu le mérite de montrer clairement les effets de l’ethynylestradiol sur les poissons.
Pendant 3 ans, ils ont ajouté 3x par semaine de l’ethynylestradiol dans un lac pour maintenir une concentration de 5 à 6 ng/l. Ils ont observés les populations de poissons pendant ces 3 ans, puis pendant encore 4 années supplémentaires. Comme ils le soulignent: cette exposition à amener à une féminisation des poissons mâles, à une baisse drastique de la reproduction et à une quasi extinction de la population de poissons.
Ces expériences ont un mérite. Elles ont fait prendre consciences aux scientifiques, mais également aux gestionnaires de l’environnement, que certaines substances chimiques de synthèse avaient des effets à des concentrations extrêmement faibles. L’ethynylestradiol en est un exemple, mais il y en a d’autres.
Dans notre laboratoire, nous avons par exemple testé un autre composé médicamenteux ayant des effets hormonaux, le tamoxifen, utilisé dans les traitements du cancer du sein chez la femme. Nous avons ainsi montré que des concentrations de l’ordre de quelques ng/l engendraient des effets sur des microcrustacés, les daphnies. Ces organismes n’étaient plus capables de produire des bébés viables.
Donc que faire pour limiter ces substances dans l’environnement, et donc le risque qu’elles représentent?
Dans le cas présent, il est clair pour moi que l’idée n’est pas d’interdire ces composés. La pilule contraceptive a permis aux femmes de gagner une certaine liberté en leur permettant de contrôler leur fertilité. Et que dire du droit d’être soigné par des médicaments efficaces comme le tamoxifen?
Non, dans ce cas, il s’agit d’agir pour limiter l’entrée de ces substances dans l’environnement. Par exemple en améliorant les traitements dans les stations d’épuration. C’est ce qui va être mis en place en Suisse dans les prochaines années. Et si cela ne résout pas complètement le problème (il y aura encore des rejets d’eaux non traitées dans le milieu naturel, j’y reviendrai), c’est une étape vers une amélioration de la qualité des eaux et une meilleure protection des écosystèmes, et donc des populations piscicoles.
A noter encore que je ne connais pas, en Suisse, de cas de changements de sexe observés chez les poissons dus à l’ethynylestradiol. Les seuls cas répertoriés de malformations des gonades chez les poissons mâles l’ont été sur les Corégones pêchés dans le lac de Thoune. Les études menées à l’Université de Berne à la fin des années 2000 montraient que ces malformations n’étaient certainement pas dues aux substances chimique ayant des effets hormonaux, mais plutôt à la nourriture et aux types d’algues absorbées par les poissons. Expliquer des effets observés dans l’environnement sur les espèces est complexe…
* Un ng/l représente 1 grain de sucre dilué dans une piscine olympique
Références:
Länge R. 2001. Effects of the synthetic estrogen 17 alpha-ethinylestradiol on the life-cycle of the fathead minnow (Pimephales promelas). Environmental Toxicology and Chemistry 20: 1216-27.
Borgatta M et al. 2015. The anticancer drug metabolites endoxifen and 4-hydroxy-tamoxifen induce toxic effects on Daphnia pulex in a two-generation study. Science of the Total Environment 520: 323-340.
Un manque de données criant
Peut-être vous demandez-vous pourquoi nous n’avons pas plus de connaissances sur les substances chimiques présentes dans notre environnement. Pourquoi ne savons-nous pas quels composés nous entourent? Dans notre air ou dans notre eau?
Ce sont des questions récurrentes lors des conférences publiques que je donne.
En effet, idéalement, nous devrions être capables de prédire quelles substances nous pouvons trouver dans les eaux, dans les sols et même dans l’air. Cela permettrait de focaliser sur les plus problématiques et ainsi permettrait de prendre les mesures adéquates en cas de problème.
Mais pour faire de telles prédictions, il faudrait avoir accès à des données concernant le type de substances utilisées dans les différents produits, ainsi qu’à des données sur les quantités consommées.
Or, même en temps que chercheur, nous n’avons aucun accès à ces informations.
Prenons quelques exemples.
Dans le cas des pesticides, le problème se pose déjà au niveau des produits vendus. En effet, si vous lisez consciencieusement l’étiquette au dos du produit, vous verrez que l’ingrédient actif est déclaré (par exemple le glyphosate), mais qu’il ne constitue qu’un petit pourcentage de la composition (souvent inférieur à 5%). Le reste, se sont des additifs, et nous n’avons aucun moyen de savoir lesquels. Aux Etats-Unis, l’Agence de protection de l’environnement (US EPA) recense plus de 1000 additifs entrant dans la composition des produits pesticides. Ce chiffre est supérieur aux 400 ingrédients actifs sur le marché en Suisse!
Même situation dans le cas des médicaments. L’ingrédient actif est déclaré, mais les autres composants (colorants, bactéricides, etc…) ne le sont pas. En 2011, le Monde publiait ainsi un article sur la présence de parabènes (une famille de conservateurs dont certains sont des perturbateurs endocriniens) dans les médicaments.
Dernièrement, nous avons travaillé sur les cosmétiques.
Voici un cas de produits où toutes les substances sont déclarées me direz-vous!
C’est en tout cas ce que l’on peut imaginer en lisant la longue liste de composés figurant sur l’étiquette au dos du produit. Malheureusement, même dans ce cas, la déclaration n’est pas complète, le type de parfum ne devant pas être spécifié (le terme « parfum » suffit).
Nous voyons donc qu’il nous manque des données fiables sur le type de substances utilisées tous les jours pour développer un programme de surveillance pertinent.
De plus, pour les substances que nous connaissons (les ingrédients actifs des médicaments ou des pesticides), nous n’avons aucune données sur les quantités utilisées. A nouveau, cela nous empêche d’évaluer les composés les plus problématiques à surveiller.
Concrètement, il y a deux manière d’estimer les quantités utilisées:
- Sur la base des données de vente
- Sur la base des habitudes des consommateurs
Reprenons les cas des pesticides. Les données de vente sont confidentielles, aucune firme de souhaitant que ces concurrents ne connaisse son marché. Nous reste donc les sondages auprès des utilisateurs. Cela signifie demander à un certain nombre d’agriculteurs de transmettre leurs données d’épandage. Même avec de la bonne volonté, cela prend du temps, et tous les agriculteurs ne sont pas d’accord de participer. Il faut donc espérer que le petit nombre sondé soit représentatif de l’ensemble des utilisateurs.
Pour les médicaments, il est possible d’obtenir des données de ventes, mais moyennant finance. Pour les données d’une année de consommation (en Suisse) pour un seul médicament, cela représente 15’000.- Impossible pour un chercheur d’acheter ces données pour les quelques 2000 médicaments sur le marché. A nouveau, reste alors les sondages auprès des médecins, des pharmaciens ou des patients…avec un taux de réponse pas vraiment plus élevé que chez les agriculteurs.
On le voit, sur la base des données accessibles dans les domaine public, impossible de développer des approches pro-actives pour la surveillances des substances chimiques dans l’environnement. Nous devons nous contenter de découvertes au gré des améliorations de la chimie analytique.
Un bon exemple est celui de la metformine, une anti-diabétique, largement présent dans les eaux de surface. Il n’y en a pas moins de 20 tonnes dans le lac Léman.
Sa présence a été découverte par hasard, parce que le laboratoire qui faisait les analyses d’eau pour la CIPEL l’avait ajouté à sa liste des substances recherchées.
De mon point de vue, le risque que représentent les substances chimiques de synthèse pour la vie à long-terme est réel. Il me paraîtrait donc urgent que les données de composition de produits, de même que les données de leur utilisation, puissent être connues. Si je peux comprendre les craintes des industries liées à la concurrence, l’enjeu en terme de santé publique et environnemental me semble suffisant pour que, au moins les chercheurs et les organes de surveillance de l’environnement puisse avoir accès de manière confidentielle à ces données.
Non, les agriculteurs ne sont pas forcément des pollueurs
Ces dernières années, j’entends souvent dire que les agriculteurs sont des pollueurs. N’est-ce pas à eux que l’on doit la pollution de nos eaux par les pesticides?
Mais est-ce vraiment le cas?
S’il est vrai qu’en zone agricole, les pesticides détectés dans les rivières sont largement dus à l’agriculture, ce n’est plus le cas dès que ces mêmes rivières traversent des zones urbanisées.
Dans nos villes, nous sommes nombreux à sprayer des pesticides dans nos jardins, contre les pucerons ou les champignons. On considère que 5% des pesticides vendus sont utilisés dans les jardins privés. Or, ces pesticides, comme les pesticides agricoles, sont entrainés par les pluies vers les cours d’eau. Ceci est encore plus rapide en zone urbaine qu’en zone agricole car les terrains sont fortement imperméabilisés et les grilles d’égouts conduisent souvent directement dans les cours d’eau.
De plus, les villes utilisent des pesticides pour entretenir les parcs et jardins. En raison du risque que présentent ces substances pour l’environnement, certaines d’entre elles ont d’ailleurs renoncé à ces produits chimiques, non sans difficultés (voir article du Temps, 9 mars 2017). Rajoutons que les terrains de sport ainsi que les golfs sont des gros consommateurs de pesticides.
Mais au delà de cette utilisation pour protéger les jardins, il existe d’autres usages dont on se doute moins. Ainsi, les pesticides sont incorporés dans les peintures de façades comme biocides, pour les protéger du développement d’algues et de moisissures. Lorsqu’il pleut, ces substances sont également entrainées vers les eaux de surface. Tel est le cas du diuron, un herbicide également utilisé pour le traitement des vignes. Dans les rivières urbaines, les concentrations issues de cet usage sont du même ordre de grandeur que celles liées à l’agriculture. Il faut noter qu’en Suisse, jusqu’à 300 tonnes de pesticides sont utilisés dans les peintures chaque année (Projet Urbic, OFEV).
On peut également citer le mecoprop, un herbicide qui empêche le développement des racines et qui est largement utilisé comme additif dans les revêtements bitumineux. De même que le diuron, on le trouve dans les effluents de stations d’épuration dû à son utilisation en milieu urbain. Idem pour les insecticides et les fongicides utilisés pour le traitement du bois de construction. Plusieurs études ont d’ailleurs montré que les ruisseaux en aval des scieries étaient souvent de mauvaise qualité chimique et biologique, dû à la présence d’insecticides en concentrations élevées. Or les insecticides sont parmi les pesticides les plus toxiques.
A cela, rajoutons encore que les industries produisant ces mêmes pesticides sont elles aussi sources de pollution des eaux. En 2005, la Commission pour la protection des eaux du Léman (CIPEL) a mis en évidence des concentrations très importantes de sulfonylurées (une classe d’herbicides) dans le Léman. Les quantités dépassaient très largement les quantités issues de l’agriculture. Il s’est avéré que les industries produisant ces substances, lors des changements de processus et notamment lors du lavage des cuves servant à la production, rejetaient des quantités importantes de pesticides dans les eaux usées. Non traitées par les stations d’épurations, ces substances se rejetaient ensuite dans le Rhône, lui-même les emmenant jusqu’au Léman. Si la situation s’est améliorée depuis lors, elle n’est pas résolue pour autant, et les contrôles de la CIPEL montrent que l’on trouve toujours des pesticides issus des industries dans le Léman.
Alors oui, l’agriculture est l’une des sources de pollution des eaux par les pesticides, mais ce n’est pas la seule.
Ceci n’est pas une raison pour ne rien faire me direz-vous. C’est vrai. Des actions ont d’ailleurs lieu à différents niveaux pour réduire l’utilisation des pesticides en agriculture. Pour la protections des eaux, mais aussi pour la protection de la santé des consommateurs.
D’abord, je dirais que beaucoup d’agriculteurs ont pris conscience de cette problématique et cherchent eux-mêmes des solutions. Pour donner régulièrement des conférences sur le sujet, je peux dire qu’en 20 ans, l’intérêt va grandissant. J’ai souvent à répondre à des agriculteurs qui me demandent comment substituer un pesticide problématique pour l’environnement par un autre.
Ensuite, il existe des initiatives locales pour réduire les rejets de pesticides dans les eaux. C’est le cas du projet mené par le Canton de Vaud sur le Boiron de Morges. Comme je l’ai entendu dernièrement dans une conférence, une amélioration de la qualité des eaux de la rivière Boiron a pu être observées entre 2005 (début du projet) et 2016.
Plusieurs mesures ont été prises: des mesures pour réduire la perte au champ (remplacement des pesticides les plus toxiques, lutte contre le ruissellement, désherbage mécanique), une formation continue des agriculteurs, et une réduction des pertes lors du lavage des cuves. Ce dernier point est très intéressant. En effet, lors de nos études sur les concentrations en pesticides dans les eaux pendant mon séjour à l’Eawag, nous nous étions aperçus que les concentrations les plus élevées étaient observées juste après l’épandage. Il s’avère que lorsque l’agriculteur lave sa cuve dans la cour de la ferme, les eaux de lavage partent directement dans la rivière via les grilles d’égouts. Dans le cas du Boiron, un place de lavage avec un traitement des eaux a été mis en place et est utilisée régulièrement par les agriculteurs. Cette mesure a contribuer à diminuer les pics de concentrations de pesticides dans la rivière.
Donc si il est vrai que l’agriculture contribue à la pollution des eaux par les pesticides, ce n’est pas le seul secteur qui y participe. Le bâti et les industries y amènent également leur part. Et si des initiatives se mettent en place pour réduire la part liée à l’agriculture, ce n’est pas vraiment le cas pour le bâti. Quant aux industries, si certaines d’entre elles prennent des mesures, ce n’est de loin pas le cas de toutes.
Références:
Milano M, Reynard E, Chèvre N, Rubin JF. 2017. Diagnostic des eaux de surface. Application du système modulaire gradué au Boiron de Morges. Aqua & Gas 2: 58-64. Février 2017
Chèvre N, Niwa N. 2015. Phytosanitaires et fertilisants. Dans: « Dictionnaire de la pensée écologique ». Bourg D et Papaux A. Editeurs. Presses Universitaires de France. pp 769-772.
Chèvre N, Klein A. 2013. Suivi de la pollution du Léman. Des années 60 à nos jours. Aqua & Gas 5: 26-34.
Burkhardt M, Zuleeg S, Marti T, Boller M, Vonbank R, Brunner S, Simmler H, Carmeliet J, Chèvre N. 2009. Biocides dans les eaux de façades. Solutions à trouver. ARPEA 241: 13-16.
Un pas en arrière pour la protection des eaux
Le 22 novembre 2017, le DETEC (Département Fédéral de l’Environnement, des transports, de l’énergie et des communications) a mis en consultation une révision de l’Ordonnance sur la Protection des eaux (OEaux).
Cette révision est pour moi un grand pas en arrière pour la protection des eaux de surface en Suisse et j’y suis fermement opposée. Mais cela mérite quelques explications.
Au début des années 90, la Suisse s’est dotée d’une Loi sur la Protection des Eaux visant à (art.1) « protéger les eaux contre toute atteinte nuisible. » Afin de garantir cette protection, l’OEaux fixe des exigences (ou critères de qualité) pour différents polluants.
La révision mise en consultation propose de nouveaux critères de qualité pour des pesticides, des médicaments et d’autres substances industrielles. Dans sa version actuelle, l’OEaux fixe une exigence de 0.1 microg/l pour tous les pesticides. Elle ne formule pas de valeurs limites pour les autres substances chimiques organiques.
Donc, cela pourrait être une révision positive puisqu’elle englobe plus de polluants qu’actuellement. Sauf que…
…comme le souligne le rapport qui accompagne la proposition de révision, les valeurs limites proposées sont supérieures à l’actuel 0.1 microg/l pour la plupart des pesticides, parfois d’un facteur très élevé (200 fois pour le fongicide métalaxyl et 1200 fois pour le glyphosate, voir article Temps, décembre 2017).
Et le rapport ajoute: « en conséquence, le nombre des dépassements effectifs des seuils fixés aura plutôt tendance à diminuer dans les eaux superficielles par rapport à maintenant. »
C’est effectivement mathématique. Si on élève la valeur limite, il y aura moins de dépassements…et donc moins de problèmes.
L’OEaux (Annexe 1, alinéa 3c) mentionne que la qualité de l’eau doit être telle que les substances pouvant polluer les eaux et y aboutir par suite de l’activité humaine « n’entravent pas les processus biologiques qui permettent aux végétaux et aux animaux de couvrir leurs besoins physiologiques fondamentaux, tels que les processus du métabolisme, la reproduction et le sens olfactif de l’orientation» et « aient des concentrations pratiquement nulles lorsqu’elles ne sont pas présentes dans les eaux à l’état naturel ».
Pour accepter des critères de qualité plus élevés qu’actuellement pour les pesticides, il faudrait donc pouvoir prouver scientifiquement que les écosystèmes aquatiques et les ressources en eau peuvent être protégés malgré ces concentrations plus élevées. Or les études scientifiques sur les effets et les risques des mélanges de substances sur l’environnement montrent clairement que ce n’est pas le cas.
Depuis le début des années 2000, de nombreux écotoxicologues se sont intéressés aux effets des mélanges sur les espèces de l’environnement. Avec le projet européen BEAM (toutes les références sont données ci-dessous) déjà, les auteurs ont montré que les substances ne peuvent pas être considérées indépendamment les unes des autres et qu’elles agissent en mélange (le fameux effet cocktail). Ces mêmes auteurs ont d’ailleurs proposé en 2013 des critères de qualité pour les eaux basés sur les mélanges pour l’Union européenne.
Dans une récente étude sur les pesticides présents dans le Léman, nous avons montré que le mélange d’herbicides détecté dans le lac avait une influence aussi importante que les concentrations en phosphore sur les communautés de phytoplancton, ceci alors même que les herbicides étaient présents à des concentrations inférieures à 0.1 microg/l. Nous avons également montré que chaque substance présente dans le lac peut contribuer au mélange et donc qu’il est indispensable de maintenir les concentrations des substances organiques les plus basses possibles .
D’autre part, accepter des critères de qualité plus élevés signifierait que ceux-ci sont basés sur des modèles de calcul robustes, ce qui n’est de loin pas le cas. Dans une étude faite conjointement avec le Centre d’écotoxicologie à Dübendorf en 2011, nous avons montré que ces valeurs seuils dépendaient fortement du set de données écotoxicologiques à disposition, et surtout de celles qui sont acceptées comme valables. Ainsi, en fonction des données retenues et des facteurs de sécurités sélectionnés, un facteur de 30 peut exister entre le critère de qualité le plus bas et le plus élevé.
De plus, les données écotoxicologiques existantes évaluent des effets sur le court terme, et ne considèrent pas les effets sur le long terme, c’est-à-dire les effets multigénérationnels. Or dans les eaux, les organismes sont exposés à des faibles concentrations certes, mais pendant tout leur cycle de vie, et celui de leurs descendants. Dans une étude avec un médicament, le tamoxifen, nous avons ainsi montré que les effets toxiques (ici des effets tératogènes) ne pouvaient être observés que sur la deuxième génération des organismes exposés.
Un autre problème concerne les antibiotiques. Plusieurs d’entre eux figurent dans la liste des substances médicamenteuses pour lesquelles des critères de qualité ont été définis. Or les seuils proposés sont parfois très hauts (30 microg/l pour la sulfamethazine soit 300 fois 0.1 microg/l) . Mais les données utilisées pour définir ces seuils ne tiennent pas compte des risques d’antibiorésistance! Or le risque de développement d’antibiorésistance est réel et plusieurs médecins n’hésitent pas à parler d’une ère post-antibiotiques d’ici une dizaine d’année puisque certaines bactéries seront devenues résistantes à tous les antibiotiques connus. Une stratégie visant à limiter le phénomène d’antibiorésistance en Suisse a donc été mise en place (OFSP) et le Fonds National Suisse pour la Recherche a créé un Pôle de Recherche (PNR 49) sur la résistance aux antibiotiques vu l’urgence de ce problème. Il semblerait donc tout-à-fait inadéquat de proposer des exigences sans tenir compte de ce risque.
Enfin, il convient encore de relever l’importance des eaux superficielles comme ressources en eau potable. Or l’Ordonnance sur les Denrées Alimentaires fixe une limite de 0.1 microg/l pour les pesticides individuellement dans l’eau potable, et de 0.5 microg/l pour la somme de ceux-ci. Accepter une augmentation des seuils pour des substances chimiques dans les eaux superficielles est susceptible de mettre en danger la qualité des eaux de boisson ou demandera des traitements encore plus sophistiqués qu’actuellement. Rien qu’autour du Léman, plus de 600’000 personnes sont alimentées par l’eau du lac.
En conséquence, je considère que la révision proposée va à l’encontre des buts de la LEaux et de l’OEaux et constitue un pas en arrière pour la protection des eaux. Pour ma part, je propose que la valeur de 0.1 microg/l soit gardée pour les pesticides, sauf pour ceux dont les valeurs d’effet sont inférieures à ce seuil comme certains insecticides très toxiques. D’autre part, le cas des antibiotiques devrait être examiné plus spécifiquement et ne peut faire l’objet d’une évaluation classique du risque, c’est-à-dire sans tenir compte du risque de développement d’antibiorésistance. Pour les antibiotiques, le seuil devrait être fixé le plus bas possible, soit à la limite de détection. Enfin, il est urgent de considérer l’effet cocktail dans la définition de critères de qualité.
A écouter:
Prise de Terre, RTS: 13 janvier 2018. Bientôt 1200 fois plus de glyphosate dans les eaux de surface en Suisse?
Références :
Backhaus M, Altenburger R, Faust M, Frein D, Frische T, Johansson P, et al. 2013. Proposal for environmental mixture risk assessment in the context of biocidal product authorization in the eu. Environmental Sciences Europe 25:4.
Backhaus T, Altenburger R, Arrhenius A, Blanck H, Faust M, Finizio A, et al. 2003. The beam-project: Prediction and assessment of mixture toxicities in the aquatic environment. Cont Shelf Res 23:1757-1769.
Borgatta M, Waridel P, Decosterd L, Buclin T, Chèvre N. 2015. The anticancer drug metabolites endoxifen and 4-hydroxy-tamoxifen induce toxic effects on daphnia pulex in a two-generation study. Science of the Total Environment 520:323-340.
Gregorio V, Büchi L, Anneville O, Rimet F, Bouchez A, Chèvre N. 2012. Risk of herbicide mixtures as a key parameter to explain phytoplankton fluctuation in a great lake: The case of lake geneva, switzerland. Ecotoxicology 21:2306-2318.
Gregorio V, Chèvre N. 2014. Assessing the risks posed by mixtures of chemicals in freshwater environments. Case study of lake geneva, switzerland. Wires Water doi: 10.1002/wat2.1018.
Junghans M, Chèvre N, Di Paolo C, Eggen RIL, Gregorio V, Häner A, et al. 2011. Aquatic risks of plant protection products: A comparison of different hazard assessment strategies for surface waters in switzerland. Study on behalf of the swiss federal office for the environment.Swiss Center for Applied Ecotoxicology.
Klimisch H-J, Andreae M, Tillman U. 1997. A systematic approach for evaluating the quality of experimental toxicological and ecotoxicological data. Regulatory Toxicology and Pharmacology 25:1-5.
Substances ignifuges: on joue avec le feu
Vous ne vous en doutez peut-être pas, mais nous baignons dans les substances ignifuges, aussi appelés retardateurs de flammes. Ces composés chimiques sont en effet présents dans nos vêtements, nos meubles, notre voiture, nos portables, etc…
Depuis la seconde moitié du XXème siècle, ces substances ont été très largement utilisées comme additifs dans les polymères (plastiques), ces derniers étant très facilement inflammables. En 2012, le marché global des retardateurs de flamme était ainsi de 1.8 millions de tonnes. Très concrètement, les retardateurs de flamme sont ajoutés au plastiques ou textiles synthétiques pour inhiber la réaction en chaîne de la combustion et ainsi empêcher, par exemple, que notre canapé prenne feu, même si il se trouve en contact avec une source de chaleur comme une cigarette ou une bougie.
Alors, c’est plutôt une bonne chose me direz-vous.
Oui, on pourrait arriver à cette conclusion si les retardateurs de flamme n’étaient pas des substances particulièrement problématiques pour l’être humain et pour l’environnement.
En effet, ces additifs ne sont pas liés aux polymères et donc passent très facilement du matériel à l’air ou à la peau de la personne qui le touche. On les trouve donc dans des concentrations non négligeables dans les espaces confinés comme les appartements ou les habitacles de voiture. De plus, une fois dans l’environnement, ils se dégradent très lentement (il faut souvent plusieurs dizaines, voir centaines d’années), ils se déplacent loin de leur source d’émission (les concentrations maximums sont observées aux Pôles), ils s’accumulent dans la graisses des organismes et le long de la chaîne alimentaire, et ils ont des effets toxiques (effets hormonaux, cancérigènes) sur les être vivants. Les espèces les plus à risque sont donc les super-prédateurs, comme nous.
Les premiers retardateurs de flamme apparus sur le marché sont les PCBs ou polychlorobiphényles. Produits par Monsanto, cette famille de substance est composée de 209 « cousins » appelés congénères. En effet, autour d’un même noyau biphényle vont se greffer des atomes de chlores (il y a 10 places disponibles) qui vont donner ses caractéristiques à chaque molécule. Il existe des PCBs dit légers, avec peu d’atomes de chlore, et des PCBs dit lourds, avec un nombre important d’atomes de chlore. Interdits depuis les années 80 dans la plupart des pays occidentaux , ils sont régulés par la Convention de Stockholm au niveau mondial depuis 2001. Le problème est qu’ils sont encore émis quotidiennement dans l’air et dans l’eau même en Suisse. Ainsi les joints des anciens bâtiments sont une source non négligeable de PCBs, de même que les décharges. C’est le cas de la Pila dans le canton de Fribourg. Néanmoins, les concentrations sont en diminutions de manière générale.
Reste un problème, les PCBs sont interdits, mais nous avons toujours besoin de retardateurs de flamme pour éviter que notre canapé ne parte en fumée. On les a donc remplacés par des polybromés ou PBDEs. Comme les PCBs, il s’agit d’une famille de molécules cousines, avec cette fois des atomes de bromes à la place des atomes de chlore. Rapidement, dès les 2000, on s’est rendus compte qu’ils posaient exactement les mêmes problèmes que les PCBs, c’est-à-dire qu’ils étaient persistants, s’accumulaient dans la chaîne alimentaire et étaient toxiques pour les êtres vivants. Ils ont donc été inclus dans la Convention de Stockholm à la fin des années 2000. Le cas du déca-BDE (celui qui contient le plus d’atomes de brome, soit 10) a fait longtemps débat. En effet, l’industrie automobile pensait ne pas pouvoir s’en passer. Il est depuis tout récemment réglementé également.
Nouveau problème, les PCBs et les PBDEs sont interdits, mais nous avons toujours encore besoin de retardateurs de flamme (le fameux canapé). Depuis le début des années 2000, on s’est donc rabattus sur les organophosphates, notamment ceux contenant des atomes de chlore (encore lui). Les organophosphates cela vous dit quelque chose? Ils sont aussi utilisés comme insecticides dans l’agriculture. Ce groupe de molécules est issu de la chimie de la seconde guerre mondiale et inclut le fameux gaz sarin. Ces substances sont certes moins persistantes que les PCBs et les PBDEs, mais elles sont hautement neurotoxiques.
Donc si nous résumons, nous obtenons le graphique suivant:

Cette figure, adaptée de la publication donnée en référence ci-dessous donne une idée des tonnages utilisées pour les PCBs (en rouge), les PBDE (en vert) et les organophosphates (en bleu – attention l’échelle a un facteur 10 de différence avec celle des PCBs/PBDEs) depuis 1950 à nos jours.
Alors, les retardateurs de flamme, une histoire sans fin? Le prix à payer pour se protéger des flammes?
A mon sens, l’utilisation de ces additifs n’est pas une fatalité. D’une part, les normes recommandant leur utilisation massive datent souvent des années 60 et de nombreux progrès ont été fait depuis lors. Par exemple, les sources de chaleur dans les téléviseurs ou les appareils électroménagers sont bien moins importantes qu’avant. Travailler sur les doses utiles d’additifs nécessaires pour protéger nos vies paraît donc urgent. Des efforts peuvent également être fait en terme de prévention des incendies (généralisation des détecteurs de fumée par exemple) en lieu et place de l’utilisation systématique de retardateurs de flamme.
A mon sens, avoir une réelle réflexion sur l’utilisation de ces substances à risque semble indispensable, sachant que l’air et la poussière de nos appartements nous y exposent tout les jours.
Référence
Gruffel P, Chèvre N. 2017. Retardateurs de flamme: une histoire sans fin? Aqua&Gas no 6. Pages 96-107.
Peut-on encore boire de l’eau du robinet?
our mon premier post, j’avais envie de commencer par discuter une question qui revient systématiquement lors de mes conférences publiques: « Peut-on continuer à boire de l’eau au robinet? »
Je ne vais pas vous faire languir, pour ma part, je bois de l’eau issue de la tuyauterie de ma cuisine tous les jours.
Mais me direz-vous, depuis 10 ans, on ne compte plus les articles de presse qui montrent que cette eau contient des pesticides et des médicaments!
C’est vrai, ces 10 dernières années, les techniques analytiques ont fait de tels progrès que les chimistes trouvent tout ce qu’ils cherchent, et ceci partout. Partout cela veut dire dans l’eau de boisson, mais également dans l’air que nous respirons (notamment dans l’air intérieur des voitures…or va-t-on du coup arrêter de prendre sa voiture?), dans les aliments que nous mangeons (résidus de pesticides dans les pâtes, les herbes aromatiques, les pommes et j’en passe…), dans les vêtements, dans la neige sur les montagnes aussi bien que dans les fonds marins.
Alors cette soupe de substances chimiques dans laquelle nous baignons, est-ce grave? Et surtout, boire de l’eau en bouteille améliorerait-il les choses par rapport à l’eau du robinet?
Pour résumer la situation, on peut dire que: « Si l’on sait que nous sommes entourés par des substances chimiques, nous n’avons aucune idée des effets que cette exposition peut avoir sur le long-terme« . Cependant, les quelques études sur les autres espèces que l’espèce humaine semblent montrer que ce cocktail ne serait pas anodin, et pourrait engendrer stérilité ou augmentation des cancers. Se basant sur le principe de précaution, il faudrait donc veiller à réduire notre exposition aux substances chimiques. Mais est-ce vraiment en buvant de l’eau en bouteille que nous réduirions cette exposition?
Une récente étude de M. Enault et de ses co-auteurs tente de faire le point sur la situation (les références complètes sont données plus bas). De manière très intéressante, ils ont comparé l’exposition d’un homme à quelques 450 polluants tels que pesticides, métaux lourds et métalloïdes, mais aussi polluants organiques persistants (dangereux car très toxiques et s’accumulant dans les organismes et réglementés par la Convention de Stockholm) tels que PCBs et PBDEs, ou encore HAPs (résidus produits par combution dont plusieurs sont cancérigènes), et ceci via trois voies d’exposition: l’air, l’alimentation et l’eau. Leur étude a notamment montré que l’eau représentait moins de 1.5% de l’exposition au pesticides, l’alimentation représentant 98.5% (dans un rapport eau/alimentation uniquement). Pour les métaux et méthalloïdes, l’eau représente généralement moins de 9% (Sauf pour le plomb car il s’agit d’une étude française, et la France, contrairement à la Suisse, compte encore beaucoup de conduites d’eau en plomb).
Bien sûr, il s’agit d’une seule étude, mais elle confirme ce que je suppose, soit que notre exposition aux substances chimiques via l’eau potable est négligeable par rapport à notre exposition via l’air que nous respirons, les vêtements que nous portons, les cosmétiques que nous utilisons chaque jour, etc. Donc avant d’arrêter de boire de l’eau du robinet, il conviendrait plutôt de faire le tri dans nos cosmétiques et de réfléchir aux aliments que nous mangeons.
Une dernière remarque sur l’eau en bouteille. Les quelques rares études qui ont analysés les mêmes substances dans les différentes eaux de boisson montrent qu’il n’y a pas vraiment de différence entre l’eau prise au robinet ou en bouteille, sauf pour celles qui ont des sources dans des bassins versants protégés. Par contre, il y a de plus en plus d’évidences que les composés du plastique peuvent migrer vers l’eau qui y est contenue et que certains de ces composés, tels les phtalates, ne sont pas anodins pour la santé.
Références
Enault J et al. 2017. Eau potable, aliments, air intérieur: comparaison de la contribution à l’exposition aux micropolluants de l’environnement. TSM numéro 3, pages 34-45
Enault et al. 2015. Drinking water, diet, indoor air: comparison of the contribution to environmental micropollutants exposure. International Journal of Hygiene and Environmental Health 218, pages 723-730.
