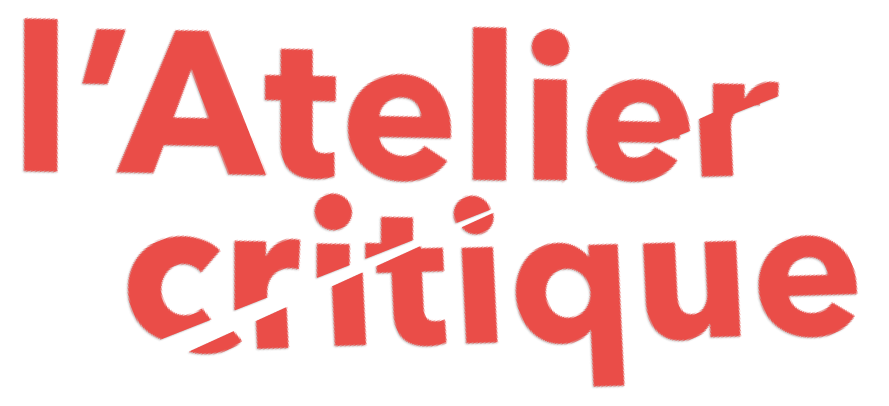Par Johanna Codourey
Une critique sur le texte de la pièce :
Un siècle assassiné / De Julien Mages / Plus d’infos

Dans son dernier texte Un Siècle assassiné, Julien Mages nous projette dans l’histoire sombre de la Shoah. Mais, en même temps qu’il en évoque l’horreur, il développe une histoire d’amour entre deux jeunes gens. Entre le ton dur et violent d’un camp de concentration et la voix pleine d’espoir de jeunes amoureux, Julien Mages esquisse une poésie touchante qui tente de parler de « l’insoutenable ».
Après Les Perdus ou Janine Rhapsody, l’auteur et metteur en scène Julien Mages propose une œuvre dramatique qu’il conçoit comme le premier volet possible d’un roman-fleuve. Dans un format très court – une trentaine de pages – il organise huit scènes encadrées par un prologue et un épilogue, dans un texte essentiellement versifié, où les silences sont prédominants. Les marqueurs spatiaux et temporels y sont presque absents, la réalité concrète placée à distance, les locuteurs souvent flous : les paroles, en flottement, donnent au texte une dimension poétique, un peu à la manière de Wajdi Mouawad.
Un Siècle assassiné présente la rencontre de deux personnages, deux jeunes amoureux, seuls personnages de la pièce, qui ne dialoguent presque jamais directement. Ils s’adressent des monologues dans lesquels toute la chaleur de l’amour s’oppose à l’expérience du camp. Les huit scènes sont encadrées par une voix lyrique vaguement verlainienne, qui ouvre puis, comme affaiblie, ferme la pièce dans un épilogue : les phrases du prologue y sont reprises, mais certains mots se sont « perdus en chemin ».
« Ça danse encore / Entre les arbres / tristes sourires / errants fantômes / du brouillard / où perce / un soleil mal fin… »
La perte structure aussi l’action : celle du père, celle du poids, celle de la vie et finalement de l’espoir. Malgré l’amour, les personnages de Julien Mages sont en survie, comme dans les récits sur les camps écrits par Primo Lévi – dont le lexique est ici repris à l’identique – ou Charlotte Delbo – avec l’œuvre de laquelle les ressemblances stylistiques sont abondantes. À travers les monologues de personnages toujours sur le fil entre la vie et la mort, Julien Mages évoque aussi la déchéance d’un professeur de physique renommé et celle de milliers d’autres êtres humains dans une langue qui rappelle parfois une certaine poésie de la guerre – comme celle d’Apollinaire – alliant horreur et naïveté. Adresses au public, adresses à l’autre, adresses à l’absent, la pièce semble destinée tant aux vivants qu’à la mémoire des disparus.
Lorsque la représentation floue de l’univers concentrationnaire devient pesante, les discours amoureux en forment un contrepoint. La libération arrive – à la fin de la pièce – et les jeunes gens s’écrient « Tenir encore » : pour l’amour qu’ils se vouent naïvement l’un à l’autre, dans ces silences répétés qui donnent une dimension fortement émotionnelle à la pièce.
Le rythme change souvent de tempo – ce que marquent les changements dans la typographie, parfois en majuscules, parfois décalée sur la page, et les variations, marquées dans les didascalies, entre cri, chant et silence, nous ballotant entre soupirs amoureux et souffles d’effroi. Les corps sont aussi impliqués, le mouvement des personnages – leur danse notamment – est évoqué. L’équilibre se crée ainsi entre cette variété des rythmes de l’énonciation et la répétitivité des énoncés.
« Je ne veux pas écrire un drame historique, je veux mentionner des personnages qui n’en sont d’ailleurs pas non plus. »
Même si cette évocation de l’univers concentrationnaire durant la Seconde Guerre mondiale fait appel à des images et à des situations qui, au regard de la littérature testimoniale de première main sur ce sujet, s’apparentent ici à des clichés, Julien Mages crée une œuvre personnelle en plaçant non plus l’Histoire au centre, à l’instar de Georges Perec, mais l’individu. Une originalité dont la réalisation sur scène risque d’être pour le moins émouvante.