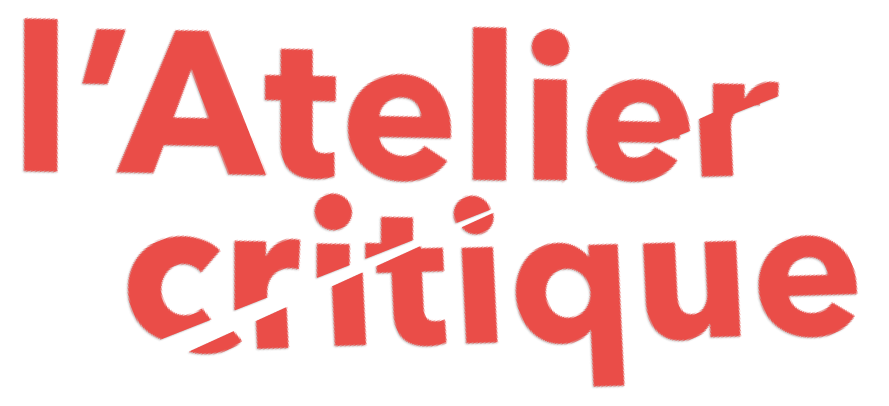Par Maxime Hoffmann
Un entretien autour de la pièce La Chute des comètes et des cosmonautes / De Marina Skalova / Le 2 avril 2019 / Plus d’infos

Loin des comètes et des cosmonautes, assis dans un bar en périphérie de la ville de Genève, j’ai rencontré Marina Skalova. Nous avons échangé sur sa première pièce théâtrale : La Chute des comètes et des cosmonautes.
Maxime Hoffmann, pour l’Atelier Critique (MH) : Au début, je vous avoue avoir eu de la peine à entrer dans la pièce, car je sentais que quelque chose me dépassait. Puis je me suis aperçu que votre pièce était aussi un long poème. Qu’en pensez-vous ?
Marina Skalova (MS) : La tendance théâtrale actuelle voudrait que l’on produise plutôt des matériaux bruts pour le plateau que des textes écrits par des auteurs vivants, valorisant l’importance de la langue sur scène. Or je trouve important de défendre le fait que la littérature dramatique est d’abord de la littérature, au même titre que la poésie et le roman. Mon écriture est d’abord et avant tout un travail sur la langue. Je suis donc très heureuse que La chute… soit publiée, et ne soit pas uniquement jugée à l’aune de la représentation.
MH : Dans votre pièce, il y a un aspect lyrique. Les mots s’accumulent, parfois jusqu’à rendre floue la frontière des phrases. Ce à quoi s’ajoute de la versification en vers libres, et même des versets délimités par de la ponctuation blanche. Est-ce une manière de laisser beaucoup de place au metteur en scène et au comédien ?
MS : Il y a surtout une écriture du rythme et de la scansion. J’écris à l’oral, il y a une dimension masticatoire, sonore, avec de nombreuses allitérations, assonances, et des processus d’accélération. L’absence de ponctuation dans les monologues correspond pour moi à une vitesse de diction, une rapidité de parole et de pensée qui serait ralentie par les virgules, et qui exprime la frénésie, l’obsession, la dimension circulaire du traumatisme… Et en contrepoint, la versification de la parole du père peut renvoyer à une poésie narrative, documentaire. Un souffle plus lent. Sa trajectoire serait plutôt de l’ordre de l’épopée, avec une gradation d’étapes et d’épreuves. Dans les deux cas, la présence ou l’absence de ponctuation propose un souffle, s’adresse à la diction du comédien. Idéalement, le texte de théâtre est une partition. Il s’agit d’écrire les silences.
MH : À la lecture, on se rend assez vite compte d’un décalage dans les paroles des personnages. Tous deux semblent poursuivre des images, peut-être fantasmées, dans une quête qui les a fatigués et qui les plonge dans une forme de désintérêt face au monde. Vous êtes vous-même une femme qui a voyagé et vécu dans différents pays. Vous êtes née à Moscou, puis vous êtes partie en France. Déjà là, on ne peut pas s’empêcher de faire un parallèle avec le personnage féminin de la pièce – est-ce qu’on a le droit ?
MS : Oui, on a le droit de faire ce parallèle. C’est vrai qu’il y a des éléments autobiographiques dans la pièce. Mais il y a surtout tout ce qui se transforme lorsque le réel devient langue, et ainsi devient fiction. Tout est vrai et tout est faux. Au final, le réel est un matériau comme un autre, qui s’entremêle avec des éléments fictionnels. Ce qui est authentique, c’est la situation initiale du personnage féminin, le fait d’avoir grandi avec des valeurs issues d’un univers soviétique englouti, qui ne sont plus en adéquation avec le monde d’aujourd’hui. La problématique de base, qui m’a guidée dans la pièce et qui découlait d’un sentiment personnel, était mon impression d’avoir grandi sur un ilôt soviétique, hors-sol, avec des parents déboussolés et sans repères en Occident, sans savoir comment faire dans ce monde. Les deux personnages de la pièce sont face à leur solitude, ils se débattent avec un individualisme très fort dans leur société d’arrivée. La question de la liberté, entrevue et rêvée à la sortie de l’URSS, mise sur le même plan que la liberté de marché, était centrale pour moi. L’échec des espoirs liés au libéralisme est illustré pour moi par le personnage de la fille, qui se heurte à la marchandisation des relations humaines.
MH : Est-ce que vous n’avez pas peur d’évoquer un univers qui est peut-être éloigné du public francophone d’aujourd’hui ? ou alors, espérez-vous donner une image de ce que l’on ressent lorsqu’on est associé à un pays qui a vécu sur un fantasme et qui s’est écroulé ?
MS : Ce qui me faisait peur, c’était une forme de folklorisation dans la mise en scène. Que la pièce soit abordée avec des clichés un peu « exotisants », les clichés de l’Occident face à l’Europe de l’Est. Cela pose la question des représentations auxquelles la pièce renvoie les metteurs en scène, la façon dont on montre un autre que l’on ne connaît pas forcément…
MH : Justement, la pièce a été jouée au Poche [du 04.02 au 17.03 2019], qu’en avez-vous pensé ?
MS : J’ai plutôt pensé du bien de la mise en scène. J’ai particulièrement apprécié le travail visuel, les images projetées sur scène, mais aussi le traitement des « CATA-STROPHES » comme des bulles oniriques, des moments hors du temps. La metteure en scène, Nathalie Cuenet, avait à cœur de respecter ce que j’ai fait, ce qui n’est pas toujours le cas avec d’autres metteurs en scène. Après, c’est toujours une expérience un peu violente, il y a eu pas mal de coupes, donc forcément une altération. En tant qu’auteure de théâtre, il faut répondre d’un travail qui nous échappe.
MH : Maintenant que vos textes sont édités et que votre pièce se joue, pouvez-vous nous dire ce que cela fait d’être écrivaine ?
MS : Disons que c’est un chemin plein de doutes, pas très simple. Je sais ce que cela m’a coûté d’écrire mes textes, donc un peu de reconnaissance ne fait pas de mal. Néanmoins, à chaque nouveau texte on commence à zéro, c’est toujours un peu la traversée du désert. On ne peut pas se reposer sur ses réussites, l’écriture est une pratique exigeante et fondamentalement insécurisante. C’est aussi pour cela que c’est magnifique. Je suis heureuse d’avoir pu en faire mon métier – et j’espère pouvoir continuer à écrire.
MH : Vous avez commencé par de la poésie, puis le récit, puis le roman, maintenant le théâtre : est-ce que vous explorez systématiquement les genres ?
MS : J’écris surtout de la poésie, qui se retrouve classée par hasard dans un rayon ou un autre. Mes textes Amarres et Exploration du flux auraient aussi pu porter la mention « poésie ». Mes éditeurs m’ont proposé d’écrire « Roman » sur la couverture de ces deux livres, ce que j’ai refusé, car je ne me sens pas romancière. Mais cela montre à quel point la question du genre est flottante aujourd’hui. Le marché littéraire continue à être divisé selon des genres canoniques, qui ne veulent pas dire grand-chose lorsque l’on écrit. La particularité pour La Chute des comètes et des cosmonautes est que j’avais une commande d’écriture théâtrale du POCHE/GVE, dans le cadre du dispositif Stücklabor. Je devais écrire une pièce de théâtre, donc je voulais bien faire les choses, écrire une « vraie » pièce de théâtre avec des dialogues et tout. Mais fondamentalement, ma démarche d’écriture est la même. Les métaphores et le travail sur la langue comme flux se retrouvent d’un texte à l’autre.
MH : Vous maîtrisez trois langues assez bien pour être capable de les traduire. En lisant, j’ai cru remarquer des expressions allemandes traduites en français, il y a aussi ces mots russes prononcés par le père. Est-ce que vous cherchez à faire circuler les langues entre elles, à rendre les frontières un peu plus floues ?
MS : Ce n’est pas nécessairement un militantisme, c’est juste que les choses se passent en plusieurs langues dans ma tête. En écrivant, j’essaie de trouver une expression qui est au plus proche de ma façon de penser. Selon la langue, une phrase ou un mot peuvent avoir telle couleur, telle intensité… Parfois, un mot en allemand ou une expression en russe m’apparaissent comme justes, même s’ils ne sont pas nécessairement lisibles hors traduction pour le lecteur. Il y a différentes stratégies par rapport à ça, on peut effectivement le laisser tel quel et soumettre le lecteur à une expérience de l’altérité, on peut aussi se questionner sur les déplacements produits par la traduction. Mon premier recueil a été écrit entre deux langues. J’adorerais rendre les frontières entre les langues plus floues, mais cela pose aussi la question du lecteur : à quel point puis-je lui imposer de l’incompréhension tout en restant dans une forme de communication ?