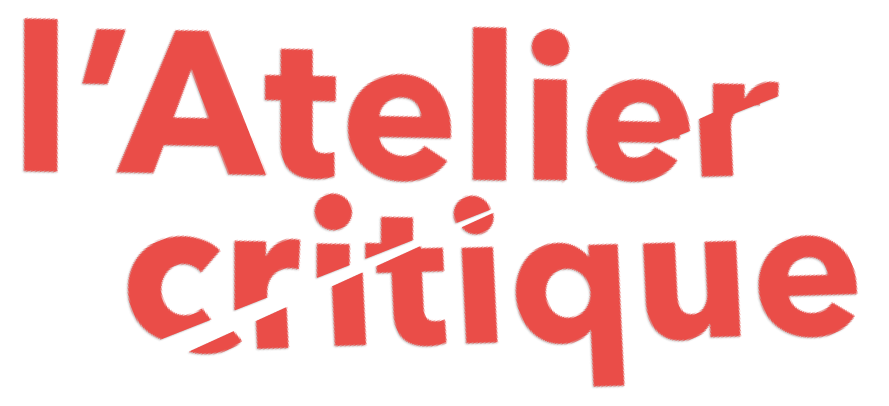Par Lucas Lauth
Une critique sur le spectacle :
Una Costilla Sobre la Mesa : Madre / Création et mise en scène d’Angélica Liddell / Théâtre de Vidy / du 27 mars au 6 avril 2019 / Plus d’infos

Comment faire face à la mort ? Celle de sa mère ? Que faire de toute cette insupportable douleur, celle qui ravage intérieurement ? Le dernier spectacle d’Angélica Liddell s’attaque à une thématique intime et prend la forme d’une tentative de mise à distance de la douleur intérieure. Mais le deuil d’une fille pour sa mère n’est pas le seul élément suggéré. Liddell rend ici hommage à sa mère défunte et questionne les liens entre mort et croyances dans un rapport ambivalent aux traditions chrétiennes. Structurée par l’extrême vieillesse, la mort et l’enterrement de la mère, le spectacle suggère aussi un possible retour à l’équilibre par la maternité, la génération à venir. Une grande richesse émotionnelle envahit la scène : tout ce mal-être rendu visible et audible, accompagné de textes poétiques aux allures d’écriture automatique, est bouleversant.
La douleur intérieure est exposée crûment, à vif. Elle est criée, répétée, imagée et exhibée.
Tout d’abord, il y a le monologue d’Angélica adressé à sa mère, proche du décès. Dans cette profération intense, entrecoupée de coups violents qu’elle se porte à la poitrine, les nombreuses références bibliques accompagnent un discours qui interroge avec véhémence la vieillesse. Par une hystérie extrêmement bien portée à la scène et un texte touchant par l’intimité et l’authenticité qu’il dévoile, le public vit les derniers instants partagés entre une mère impotente et sénile, et sa fille effondrée.
Angélica Liddell et le chanteur et musicien Nino de Elche interprètent ensuite par une alternance de champs lyriques et de cris de lamentations toute la violence du ressenti de la fille, restée seule une fois sa mère décédée. Ils se déplacent entre les six figures drapées présentes sur scène depuis l’ouverture. Le portait de la mère est déposé au bas de la septième forme drapée, non humaine. Des femmes nues sont présentes sur scène. S’ajoutent à ces lamentations les phrases bibliques martelées par Nino de Elche. Il y a ici comme une volonté de pousser la langue à ses limites. Notre mode d’expression et de communication principal, tout comme le texte sacré, sont ici questionnés par les répétitions infinies de certains groupes de mots. Les sons se déforment, se confondent pour ne devenir finalement qu’une masse de plaintes sonores qu’endure le public. Et parfois les mots manquent. Le langage est insuffisant pour exprimer le supplice enduré. Le chanteur n’émet alors que des sons, entrecoupés de crachats et de gémissements.
Quant aux costumes, ils ont une importance capitale dans cette perspective. L’auteure fait ici le choix de rendre hommage à sa mère défunte par un retour aux vêtements traditionnels de sa région d’origine : l’Estrémadure. Le chanteur est le premier comédien à entrer en scène vêtu de la sorte. Vient plus tard une danseuse habillée en vêtements traditionnels de la région qui se meut avec légèreté et s’oppose à la danse saccadée d’un homme drapé de noir, portant un masque. À la fin de la pièce, c’est Angélica Liddell, en venant s’allonger près du portait de sa mère, qui portera de multiples couches de robes traditionnelles de cette région du sud-ouest de l’Espagne.
La performance corporelle est aussi un élément central du spectacle. Angélica Liddell devient « empalaos de vaverde de la vera ». Il s’agit là d’un rite religieux de repentance. Le martyre, sur scène, se fait volontairement lent et intense, accompagné de cris de douleur et d’envolées lyriques. La scène est amplifiée et les sons sont modifiés par de la réverbération et un effet d’écho, ce qui donne une profondeur nouvelle, une sensation d’au-delà. Un homme, sans identité ni expression, visage maquillé et habillé de vêtements traditionnels de l’Estrémadure, ligote Angelica à une poutre. Elle forme une croix et incarne alors cette figure d’« empalaos de vaverde de la vera ». La musique, toujours présente, se fait pesante et de plus en plus forte jusqu’à la limite du supportable. L’éclairage devient incertain. Il prend une teinte cuivrée et, lorsque l’intensité est à son comble, des flashs éblouissent scène et salle. L’atmosphère angoissante s’accentue encore lorsque des émanations de fumée, de bois brûlé, agissent sur notre sens olfactif. Le supplice se fait donc pluri-sensoriel. Nous souffrons en la voyant souffrir.