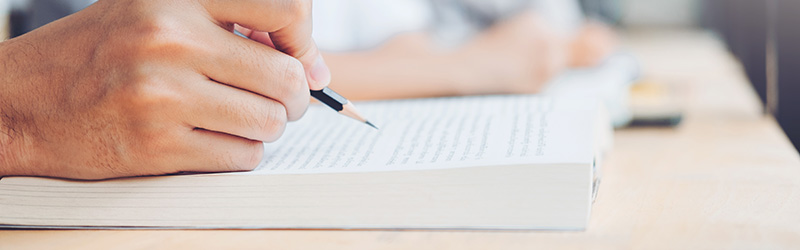Le curriculum en pleine modernisation
Comment former les médecins à l’horizon 2050? Des réflexions sont menées depuis plusieurs années à l’École de médecine et plusieurs grands chantiers ont été lancés : la réforme du Master vient d’entrer dans sa phase active et la révision du Bachelor est à mi-chemin. État des lieux.

La réforme du Master est lancée!
La réforme du Master en médecine à Lausanne répond à un besoin clair: adapter notre formation aux profondes transformations de la pratique médicale, aux attentes de la société, à l’évolution du système de santé et aux avancées en pédagogie médicale. Elle vise aussi un meilleur alignement avec le référentiel national PROFILES, qui définit les compétences attendues à l’issue du cursus.
Le travail de conception de cette réforme s’est appuyé sur des cadres pédagogiques reconnus et sur une analyse critique et rigoureuse du curriculum existant. Il inclut – entre autres – les évaluations du cursus par les étudiant·es et un recensement détaillé de l’année MMed2 (voir plus bas). Cette phase conceptuelle a permis de dégager les grands axes d’une réforme ambitieuse, validés au printemps 2025 par un comité de pilotage réunissant membres du décanat, direction de l’École de médecine, corps professoral et étudiant·es.
La participation des enseignant·es et des étudiant·es sera assurée à chaque étape, via une représentation dans le comité de pilotage et dans les équipes de projet, ainsi que lors de moments réguliers de consultation et de co-construction. Une communication plus détaillée sur le programme de réforme est prévue prochainement.
La 2e année de Master sous la loupe de trois étudiant·es.
Lors de l’année 2023-2024, trois étudiant·es ont recensé tous les enseignements structurés de l’année MMed2 pour mieux cerner la pertinence des formats pédagogiques utilisés, identifier les répétitions, ainsi qu’évaluer leur utilité. Les résultats ont montré qu’une grande proportion d’enseignements sont peu interactifs et ciblent peu le raisonnement clinique. Nous avons d’autre part identifié un certain nombre de répétitions peu utiles sur la base de ce recensement. Ces résultats, précieux pour la réforme à venir, ont déjà été transmis aux responsables des modules concerné·es avec des pistes pour faire évoluer les enseignements dès aujourd’hui. Il s’agira de privilégier des approches plus interactives et de stimuler le raisonnement clinique à partir de vignettes ainsi que d’inciter les enseignant·es abordant des thématiques similaires à mieux se coordonner.
La révision du Bachelor à mi-chemin
Après le projet pilote orienté sur le module B2.4 (circulation, respiration) et mené avec succès (voir l’article de la newsletter de février 2025), le travail de révision du Bachelor s’est poursuivi durant l’année 2024-2025 avec les modules B2.5 (digestion, métabolisme) et B2.6 (système urogénital et homéostasie), tandis que les modules B2.2 (sang, immunité, microbes) et B2.3 (neurosciences) seront abordés lors de l’année académique 2025-2026. La BMed3 sera révisée en dernier lieu, en coordination étroite avec le projet de réforme du cursus de Master.
Comment ce travail de révision s’inscrit-il dans une démarche pédagogique réfléchie et structurée?
L’EM a mis le concept d’alignement pédagogique, tel que défini par John Biggs, au centre de ses réflexions. Cette approche constitue le fil conducteur de cette révision du Bachelor et repose sur le principe d’un continuum cohérent entre les objectifs d’apprentissage, les contenus enseignés, les méthodes pédagogiques mobilisées, ainsi que les formes et critères d’évaluation.
Lorsque les objectifs visent plus que la simple mémorisation – en intégrant l’application, l’analyse ou la réflexion critique – et que les évaluations sont conçues en conséquence, les étudiantes et étudiants sont naturellement amenés à adopter des stratégies d’apprentissage en profondeur. Ce type d’apprentissage favorise la compréhension durable et le développement de compétences transférables, au-delà de la seule réussite aux examens.