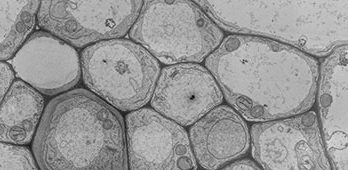Au moment où la hausse des primes d’assurance-maladie et des coûts de la santé fait débat, on oublie souvent que les médecins tentent eux aussi de lutter contre la surmédicalisation. Ils souhaitent faire évoluer la médecine pour la rendre «plus intelligente».
Ce n’est certes pas une révolution, mais c’est un profond changement dans les mentalités qui s’amorce. Des médecins ont décidé de traquer les interventions inutiles qui sont pratiquées dans les domaines de la prévention, du diagnostic et de la thérapie. «Il s’agit de faire preuve d’humilité et renoncer au discours triomphant, en questionnant nos pratiques à la lumière des données scientifiques», souligne Jacques Cornuz, médecin-chef, directeur de la Policlinique médicale universitaire (PMU) à Lausanne et professeur à la Faculté de biologie et de médecine de l’UNIL.
Tout a commencé aux états-Unis où le concept Choosing Wisely (choisir avec sagesse) a été créé en 2012. Très rapidement, d’autres pays anglo-saxons, Grande-Bretagne et Canada en tête, ont suivi le mouvement. Cette démarche est aussi connue sous le slogan Less is more (moins c’est mieux) ou Slow Medicine, par analogie à la Slow Food qui s’oppose à la restauration rapide. En Suisse, c’est sous la bannière de la Smarter Medicine que se sont regroupés tous ceux qui, comme le patron de la PMU, tentent de lutter contre la surmédicalisation.
Patients exposés inutilement
A l’origine de cette démarche, il y a ce constat que certains médicaments sont peu ou pas efficaces et que d’autres ont des effets secondaires qui surpassent les bénéfices. Ou encore que des examens radiologiques sont pratiqués alors «qu’ils ne modifient ni le pronostic, ni le traitement de la maladie. Ils sont parfois faits uniquement pour objectiver la raison de la douleur; ils n’amènent rien et exposent inutilement le patient à des radiations» (lire ci-dessous).
On pourrait aussi mentionner les surdiagnostics et les excès de dépistage. «En tant que médecins, constate Kevin Selby, chef de clinique à la PMU, nous avons de la peine à renoncer à des tests et des traitements qui, contrairement à toute logique, ne sont pas utiles. Par exemple, on croit toujours que la détection précoce des cancers est bénéfique, mais des études à large échelle montrent que, dans le cas du cancer de la thyroïde, des ovaires ou de la prostate, cela peut parfois provoquer plus de mal que de bien.»
Certes, précise Jacques Cornuz, le problème n’est pas simple car «lorsque l’on soumet cent personnes à un test de dépistage, on ne sait pas à l’avance qui va en bénéficier ou sera surdiagnostiqué et n’en tirera donc finalement aucun avantage». Mais dans ce dernier cas, «on colle une étiquette au patient et on génère chez lui une angoisse qui peut même péjorer sa qualité de vie».

Le biais «du regret anticipé»
Cette surmédicalisation «résulte d’une culture qu’il faut modifier». Du côté du corps médical d’abord, qui «fait parfois preuve d’une certaine inertie quand il faut changer les pratiques», selon le spécialiste de médecine interne générale qui constate que «parfois, il est plus difficile de ne rien faire que de continuer à prescrire un médicament ou un examen».
On pourrait aussi évoquer ce que Jacques Cornuz nomme «la médecine défensive» qui consiste à effectuer des interventions de peur d’être, par la suite, accusé de négligence. «Il est possible que certains le fassent pour se prémunir, y compris d’une éventuelle plainte judiciaire. Mais je pense que la principale motivation est ce que l’on nomme “le biais du regret anticipé: si l’on renonce à un dépistage ou à un examen et que, quelques années plus tard, le patient développe un cancer qui aurait pu être dépisté, on aura des regrets”.
Il faut aussi tenir compte des fausses croyances de certains patients qui restent persuadés que plus ils reçoivent de tests et de soins, meilleure sera leur santé, ainsi que des «forces du marché, que ce soit pour les médicaments ou les instruments de radiologie».
Une médecine plus efficiente
Pourquoi avoir tant attendu pour se préoccuper de cette surmédicalisation? Il y a plusieurs raisons à cela, répond Jacques Cornuz. D’une part, la recherche avance, et «nous avons maintenant des données que nous n’avions pas auparavant qui montrent que les bénéfices d’une intervention ne sont pas aussi élevés que ce que l’on escomptait». D’autre part, «il y a maintenant en Suisse un nombre suffisant de médecins formés à l’épidémiologie clinique et qui sont donc en mesure de questionner l’impact des interventions et d’interroger la pratique médicale sur des bases scientifiques».
A cela s’ajoutent les préoccupations liées à l’augmentation constante des coûts de la santé. Certes, précise le directeur de la PMU, «nous ne visons pas une médecine plus économe, mais une médecine plus efficiente. Il reste que «le monde médical a pris conscience qu’il ne pourra pas offrir des traitements onéreux à tout le monde. Il faut donc arrêter de proposer des actes coûteux qui n’apportent qu’un bénéfice marginal, si tant est qu’il existe.» Les circonstances étaient donc favorables pour que la Smarter Medicine puisse être mise sur les rails.
Une première liste d’interventions inutiles
Il en va de la médecine comme des chemins de fer. «Lorsqu’un train est en marche, il est difficile de l’arrêter. Il faut que quelqu’un entre dans la cabine et commence à freiner», constate Jacques Cornuz. En Suisse, Jean-Michel Gaspoz, chef du Service de la médecine de premier recours des Hôpitaux universitaires de Genève, a été le premier à jouer les machinistes. «Il a initié la démarche en 2014 en inscrivant le concept de Smarter Medicine à l’agenda de la Société suisse de médecine interne générale (SSMIG) dont il était alors le président.» Pour entrer dans le concret, il a chargé la PMU et son directeur de dresser une première liste d’interventions considérées comme inutiles dans le domaine des soins ambulatoires (lire ci-dessous).
«Nous avons eu le souci de l’établir en ayant une approche scientifique. Nous avons d’ailleurs publié les résultats de nos travaux dans une revue scientifique de renom, le Journal of American Medical Association (JAMA) dont les articles font l’objet d’un Peer Review» (évaluation par des pairs, ndlr).
Concrètement, les médecins de la PMU ont utilisé la méthode Delphi, une procédure «qui vise à trouver, entre experts, un consensus sur des sujets controversés», explique Jacques Cornuz. «Nous avons d’abord fait une revue de la littérature médicale et nous y avons cherché des preuves scientifiques concernant chacune des interventions qui étaient mentionnées dans les listes établies dans d’autres pays», précise Kevin Selby qui a mené l’étude Delphi. Cette recherche a permis de dégager un certain nombre de «recommandations-candidates que nous avons soumises à une cinquantaine d’experts suisses chargés d’évaluer celles qui auraient le plus fort impact dans notre pays», poursuit le chef de clinique. «Au départ, nous avions retenu trente-huit interventions», ajoute Jacques Cornuz. Puis, à la suite d’éliminations successives, «nous en avons identifié cinq qui ont fait l’objet d’un large consensus parmi les experts».
Des mesures bien accueillies
Ce «Top 5» dans le domaine ambulatoire, de même que celui établi dans la foulée par les hôpitaux universitaires pour le secteur hospitalier, est d’abord destiné aux professionnels de la santé. «Les trois-quarts d’entre eux leur ont fait bon accueil. Surtout en Suisse romande, précise le directeur de la PMU, sans doute parce que la dynamique a été lancée en Romandie.»
Ces listes ne sont toutefois pas réservées au corps médical. «Elles doivent aussi être connues des patients qui sont amenés à questionner les soins qu’on leur prodigue.» A cette fin, un site accessible à tous a été créé (smartermedicine.ch). En outre, «à la PMU, nous collaborons avec la Fédération romande des consommateurs. Par la suite, nous envisageons de faire participer des patients-citoyens à l’établissement de futures listes de recommandations.»
Car l’initiative Smarter Medicine ne devrait pas en rester là. Depuis son lancement, le mouvement a pris de l’ampleur, notamment lors de la création d’une association faîtière réunissant la SSMIG, l’Académie suisse des sciences médicales, des soignants non médecins, des patients et des consommateurs. En outre, après la SSMIG, plusieurs sociétés médicales (notamment la gériatrie et la chirurgie) ont à leur tour dressé leur propre liste. D’autres devraient suivre. De son côté, Jacques Cornuz a l’intention de remettre l’ouvrage sur le métier «dans un an, en questionnant cette première liste et, éventuellement en en rédigeant une deuxième qui pourrait être plus étoffée».
Pas de retour en arrière possible
Il reste toutefois quelques défis à relever pour que le concept de Smarter Medicine entre réellement dans les mœurs. L’un d’eux concerne la formation des étudiants et des jeunes médecins qui doivent «intégrer très tôt dans leurs attitudes professionnelles cette médecine de l’humilité et faire preuve de scepticisme éclairé», souligne Jacques Cornuz.
Dans le domaine de la recherche, il faudra aussi développer «des études de phase 4», comme les appelle le médecin, par analogie avec les 3 phases d’essais cliniques nécessaires pour la mise sur le marché d’un nouveau médicament. Cela permettra de «vérifier si le bénéfice d’une intervention, obtenu dans les conditions idéales d’un essai clinique, est confirmé dans des conditions standards, celles du terrain, de la médecine de tous les jours». Mais qui financera ce travail? «La meilleure option serait que les parlements fédéral et cantonaux mettent cette thématique à leur agenda, afin notamment d’en tenir compte lors de l’attribution des budgets publics pour la recherche, comme le FNS (Fonds national suisse).»
Quoi qu’il en soit, «il ne faut pas ralentir le rythme, conclut le patron de la PMU. Nous étions plusieurs à dire qu’en médecine, on peut faire mieux avec moins. Maintenant, le concept est formalisé, il a une dynamique, et on ne pourra pas revenir en arrière.»
Les 10 interventions à éviter
Ces deux listes, l’une concernant le domaine ambulatoire, l’autre le secteur hospitalier, dressent l’inventaire de tests et prescriptions que la Société suisse de médecine interne générale (SSMIG) «recommande de ne pas pratiquer». Avec les commentaires de Jacques Cornuz.
Liste «Top 5» domaine ambulatoire
Un bilan radiologique chez un patient avec des douleurs lombaires.
En l’absence de «drapeau rouge» (de symptômes inquiétants), cet examen «ne modifie pas la prise en charge ni le pronostic». Mais il augmente l’exposition aux radiations et il est coûteux.
Le dosage du PSA pour dépister le cancer de la prostate sans en discuter les risques et bénéfices avec le patient.
«Il y a une grande incertitude dans les données scientifiques sur le bénéfice de ce dépistage.» Les médecins doivent donc «partager leurs incertitudes avec leurs patients».
La prescription d’antibiotiques en cas d’infection des voies aériennes supérieures sans signe de gravité.
Dans la majorité des cas, il s’agit d’infections virales contre lesquelles les antibiotiques sont inefficaces.
Une radiographie du thorax dans le bilan préopératoire en l’absence de suspicion de pathologie thoracique.
Ce type d’examen est parfois pratiqué «chez des patients qui font l’objet d’une opération bénigne, alors qu’il ne change en rien la prise en charge».
La poursuite à long terme d’un traitement d’inhibiteurs de la pompe à proton pour des symptômes gastro-intestinaux.
«Au départ, ces médicaments étaient destinés à traiter des personnes qui avaient des aigreurs gastriques aiguës. Puis, progressivement, on les a prescrits à long terme, ce qui peut entraîner des risques de pneumonie, d’ostéoporose, voire de fractures.»
Liste «Top 5» secteur hospitalier
Faire de prises de sang à intervalles réguliers ou planifier des batteries d’examens sans répondre à une question clinique spécifique.
Lorsqu’ils font la visite au lit du malade, les médecins – les jeunes surtout – «ont le souci de documenter les choses, ce qui est souvent inutile».
Poser ou laisser en place une sonde urinaire pour des raisons de commodité en dehors des soins intensifs.
Ces sondes sont en effet «une source importante d’infections».
Multiplier les transfusions sanguines pour soulager les symptômes liés à l’anémie, ou pour normaliser le taux d’hémoglobine selon des seuils définis.
Selon la SSMIG, les transfusions sanguines inutiles «génèrent des coûts et exposent les patients à des effets indésirables potentiels sans aucun bénéfice».
Laisser les personnes âgées alitées pendant leur séjour à l’hôpital.
Rester couché à l’hôpital favorise la perte d’autonomie pour la marche, ce qui augmente les durées de séjour, le recours à des services de réhabilitation, les risques de chute et même la mortalité.
Utiliser des benzodiazépines ou autres sédatifs-hypnotiques chez les personnes âgées pour le traitement de l’insomnie, de l’agitation ou d’un état confusionnel aigu.
L’emploi de ces médicaments peut doubler le risque d’accidents de la route, de chutes et de fractures de la hanche.