
Depuis l’Antiquité, les êtres humains ont fait preuve d’incroyables astuces pour pouvoir calculer. Ils ont utilisé des cailloux, des jetons, des boules et même leurs doigts avec lesquels ils pouvaient compter jusqu’à 9999! Puis sont apparus les chiffres arabes, d’origine indienne en fait, qui ont enfin permis les calculs écrits. C’est cette histoire méconnue et passionnante qu’Alain Schärlig, professeur honoraire à l’UNIL, conte au fil de ses livres.
Nous les utilisons quotidiennement, sans leur prêter la moindre attention. Rien, en effet, n’est plus banal pour nous que d’écrire les nombres à l’aide de chiffres arabes et de les disposer en colonnes pour faire les quatre opérations élémentaires. 1, 2, 3… et même le fameux O: ces symboles qui nous sont aujourd’hui familiers ne sont arrivés en Europe qu’au XIIe siècle.
Alors, comment faisait-on auparavant? Cette question, Alain Schärlig a été l’un des premiers à la poser. «J’ai toujours été intéressé par le concret», dit ce professeur honoraire de l’UNIL, qui enseignait à HEC les «méthodes quantitatives d’aide à la décision, c’est-à-dire l’art d’utiliser les maths pour améliorer les choix dans la gestion des entreprises».
Une fois à la retraite, ce mathématicien, qui est aussi titulaire d’un doctorat en Economie politique, s’est passionné pour l’histoire du calcul. Il a déjà écrit à ce sujet huit livres (tous publiés aux Presses polytechniques et universitaires romandes), dont deux avec Jérôme Gavin, professeur de mathématiques au Collège Voltaire à Genève.
Difficile de compter avec des lettres?
«Comment les anciens Grecs se débrouillaient-ils pour faire une addition, alors qu’ils avaient une numération qui, pour nous, est aberrante?» En déchiffrant une stèle funéraire que lui avait confiée le Musée d’art et d’histoire de Genève, Alain Schärlig y a découvert une table de Pythagore sur laquelle figuraient des chiffres. Mais ceux-ci étaient représentés sous forme de lettres qui étaient les initiales de leur nom: par exemple la lettre ? (delta) est l’initiale de «déka» qui signifie dix, et ? celle de «penté», c’est-à-dire cinq. Cette numération permettait certes d’écrire des nombres. Mais une fois ceux-ci placés les uns en dessous des autres, il était impossible de les additionner. Imaginez un écolier à qui l’on demanderait combien font ???+ ?????
Additionner avec des cailloux…
Les Grecs ont trouvé la parade. Comme l’a découvert le mathématicien, «ils s’en tiraient en mettant des cailloux sur une plaque de marbre sur laquelle étaient gravées des colonnes». L’une d’elles correspondait aux unités, une deuxième aux centaines, une troisième aux milliers, etc. et d’autres encore aux fractions. On plaçait alors des cailloux dans ces colonnes pour former des nombres, «puis en faisant glisser les cailloux les uns contre les autres, on obtenait le résultat de l’addition». C’est ainsi qu’est né l’abaque (du nom de la plaque de pierre utilisée), une machine qui est en fait le lointain ancêtre de nos calculettes.
… ou des jetons
«En poursuivant mes recherches, je me suis rendu compte que les Romains, puis les gens du Moyen Age, avaient le même problème que les anciens Grecs, car ils utilisaient des chiffres romains», dit Alain Schärlig. Des lettres encore – C (cent), L (cinquante), X (dix), I (un)… – qu’il était tout aussi impossible d’additionner que des ? et des ?.
Eux aussi se sont tirés de ce mauvais pas en ayant recours à des tables de calcul, conçues sur le même principe que celui des abaques, «à cette différence près qu’ils employaient des jetons et qu’ils avaient remplacé les colonnes par des lignes».
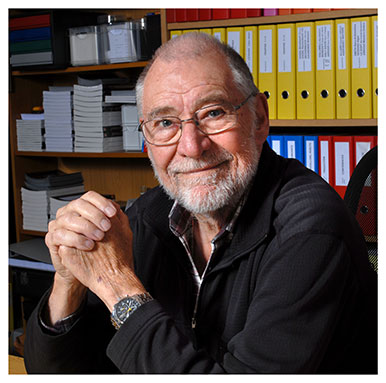
Le boulier russe est toujours utilisé
Des cailloux et des jetons aux boules, il n’y a qu’un pas que le professeur honoraire de l’UNIL s’est empressé de franchir pour s’intéresser aux bouliers. Ceux-ci sont faits de cadres en bois renfermant des tiges sur lesquelles on déplace les perles de bois.
Le boulier russe comporte quatre tiges horizontales, chacune d’elles comprenant quatre perles claires, suivies de deux noires, puis de quatre autres claires. «Cela répond au “phénomène pas plus de quatre” qui tient compte du fait que l’œil humain ne peut pas dénombrer plus de quatre objets d’un coup», explique Alain Schärlig. Ce boulier est toujours utilisé en Russie, «parfois même pour vérifier les calculs faits avec des calculettes ou des caisses enregistreuses». Il suffit d’ailleurs d’entendre les cliquetis dans certains magasins pour s’apercevoir de la dextérité de celles et ceux qui les emploient.
Chinois et Japonais calculent aussi avec des boules
Apparu vers le XIIe ou le XIVe siècle, le boulier chinois est lui aussi fondé sur le «phénomène pas plus de quatre». Chaque tige, verticale cette fois, «contient, dans un cadre intérieur, cinq perles noires ou foncées qui valent 1 et, dans un cadre supérieur, deux autres qui valent 5». Le principe est le même que celui que l’on utilise au jeu de jass pour compter les points, lorsqu’on trace quatre coches parallèles barrées par une oblique, pour indiquer qu’une équipe a cinq points.
Les Japonais ont ensuite simplifié le système et leur boulier ne renferme que quatre boules inférieures valant 1 et une seule supérieure valant 5. Dans les trois modèles de boulier, on retrouve toutefois la méthode de calcul inventée par les Grecs: une colonne représente les unités, une autre les dizaines, etc. et il suffit de faire glisser les perles pour faire des additions – «ou les soustractions, qui sont les opérations inverses».
La fausse position: poser le faux pour calculer le vrai
Parmi les astuces qu’avaient inventées les mathématiciens de l’Antiquité pour compter, il y avait aussi une étonnante méthode nommée «la fausse position». Elle consiste, lorsqu’on doit résoudre un problème (que nous appelons du premier degré), à poser un résultat dont on sait qu’il est faux. Lorsqu’on fait la preuve, on sait que le nombre que l’on trouve n’est pas le bon, mais il suffit alors de faire «une règle de trois pour avoir la solution, explique Alain Schärlig. On raisonne ainsi: si le nombre que j’ai choisi me donne tel résultat, quel est celui qui conduit à la réponse que je cherche?».
Cette technique était déjà utilisée par les Egyptiens 2000 ans avant notre ère, puis elle a traversé les siècles en passant par la Chine et le monde arabe jusqu’à la Renaissance. «Elle a permis, pendant des millénaires, de se passer de l’algèbre.» On peut toujours s’amuser à l’utiliser et ainsi «résoudre de tête les problèmes de robinets qui rebutent tant les écoliers».
Vieux livre d’arithmétique
Le hasard fait parfois bien les choses. En parcourant un marché aux puces, Alain Schärlig est tombé sur un ouvrage écrit en 1619 par un Bernois, Johann Rudolf von Graffenried. «C’est l’un des premiers livres d’arithmétique en allemand et il contient toutes les opérations nécessaires aux commerçants de cette époque.» C’était une découverte, car même en Allemagne, pays pourtant réputé dans l’histoire du calcul, «mes collègues ne connaissaient pas cet ouvrage».
Mais une autre surprise attendait le mathématicien genevois. «Ce bouquin de 700 pages commence en définissant les chiffres que nous appelons arabes.» Signe qu’à l’époque, ceux-ci étaient encore mal connus. Cette observation a conduit le professeur honoraire à s’intéresser à l’arrivée des chiffres arabes en Europe.
De l’Inde à l’Europe, en passant par Bagdad
Ces chiffres que l’on appelle arabes sont en fait nés en Inde, avant le Ve siècle de notre ère. Mais ce n’est que bien plus tard que nos ancêtres ont commencé à les utiliser. «Ils sont arrivés à Bagdad au IXe siècle et ils ont fait l’objet d’un ouvrage publié par le mathématicien perse Al-Khwarizmi, aux alentours de 825. Ce livre est parvenu chez les moines de Tolède, en 1143, puis il a été popularisé par Léonard de Pise, dont le manuscrit date de 1202.» Ce n’est donc qu’au XIIIe siècle que les chiffres arabes, «dont la graphie s’était entre-temps un peu transformée», ont pu être utilisés par les Européens.
Les premiers calculs écrits
«Les nombres écrits par ce moyen sont plus concis, mais leur principal avantage est d’avoir permis le calcul écrit», souligne Alain Schärlig. Leur invention a en effet changé la face du calcul et des mathématiques. «En chiffres romains, trois cents s’écrivait CCC (trois fois cent), trente, XXX (trois fois dix) et trois, III (trois fois un). Personne n’avait pensé que dans chaque cas, il y a le mot “trois”. Les Indiens ont donc trouvé un signe indiquant combien il y avait d’unités, de dizaines, de centaines, etc.» En l’occurrence, le symbole 3.
La naissance du zéro
Pour faire des additions, il suffisait alors de tracer des colonnes (représentant de gauche à droite les milliers, les centaines, les dizaines et les unités) à l’intérieur desquelles on plaçait les nombres les uns au-dessous des autres. Mais au Ve siècle de notre ère, «il s’est trouvé quelqu’un pour constater que ces colonnes n’étaient pas très pratiques et qu’on pouvait les abandonner», constate Alain Schärlig. Cependant, si l’on écrit deux mille vingt-trois, en l’absence de colonnes, «cela ne fonctionne plus. Il fallait donc créer un chiffre qui signifie “rien”». De là est né le 0, qui nous est, lui aussi, venu par Bagdad au IXe siècle. «Ce “rien” était toutefois considéré comme diabolique par l’Eglise, et c’est sans doute pour cette raison que les chiffres arabes ont mis tant de temps à s’imposer en Europe.» Où ils ont permis le développement des mathématiques. Mais c’est une autre histoire.
Article suivant: Compter sur les doigts jusqu’à… 9999



