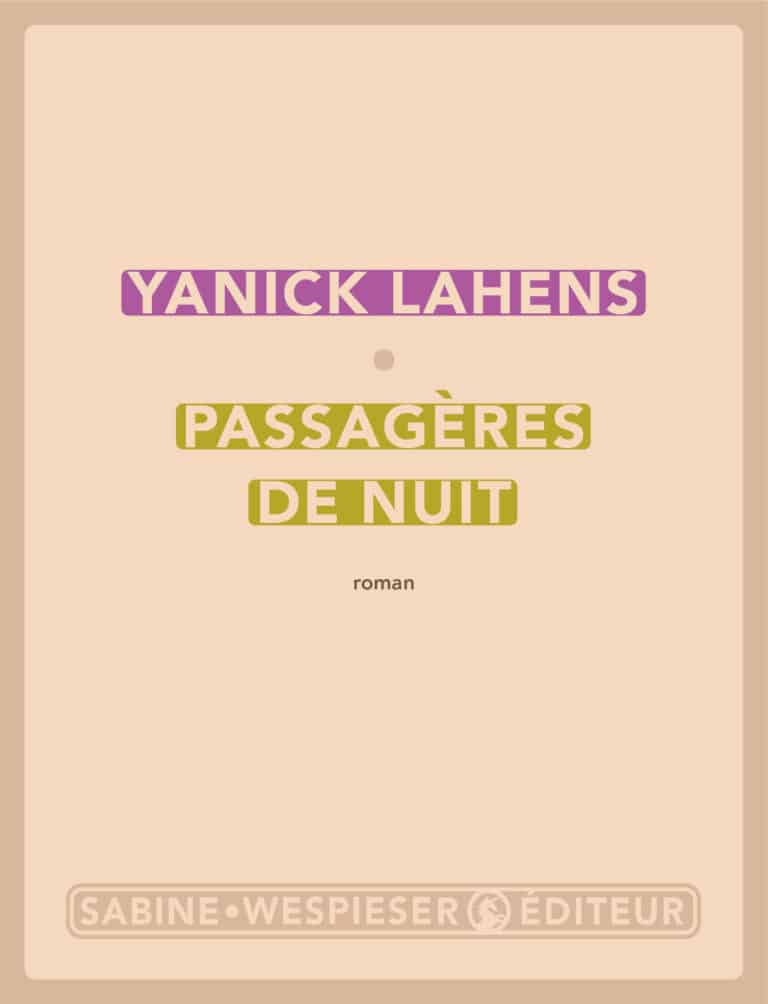Le récit s’ouvre dans les années 1840, dans la Louisiane coloniale. Elizabeth Dubreuil, fille d’affranchis d’origine haïtienne, vit à La Nouvelle-Orléans sous la tutelle du propriétaire blanc Maurice Parmentier. Ayant jeté son dévolu sur elle, il tente à deux reprises de la violer. Elizabeth, en quête de justice et de dignité, se venge : déguisée, elle l’attaque et le blesse grièvement. Cet acte de rébellion précipite son exil vers Haïti. Mais plus que le geste, ce sont ses résonances que scrute Lahens : à travers celui-ci se déploie tout un héritage de domination, de silence et de violence sexuelle.
Autour d’Elizabeth gravitent d’autres femmes : sa mère Camille, enfermée dans la maison familiale comme dans une cage dorée ; surtout, sa grand-mère Florette, dont le récit remonte aux origines de la lignée. Exilée, violée, arrachée à sa mère, Florette a connu la cale du bateau négrier, la servitude et les avortements forcés. Lahens refuse pourtant d’en faire une figure sacrificielle : la douleur devient chez elle une lucidité aiguë, un savoir transmis de femme en femme. Dans cette mémoire descendante, la survie n’a rien d’héroïque ; elle est une résistance intérieure, faite de dignité et d’attention au monde :
« Parce que le maître est persuadé que tu ne sais rien, que tu n’es rien. Alors tu le laisses à sa foi trompeuse. Cette foi fait ton affaire. Son ignorance est ta force. »
En tissant ces voix, Lahens rejoint une généalogie littéraire où les femmes sont les gardiennes de la mémoire collective. Passagères de la nuit s’articule autour d’une figure centrale des littératures antillaises : le « poto-mitan », cette femme-pilier qui maintient l’équilibre malgré la défaite. Si l’on retrouve chez elle le créole, la prière et le rituel, Lahens s’écarte du lyrisme épique : elle écrit contre l’héroïsme masculin, au plus près de la fatigue et du silence.
La seconde partie du roman s’ouvre à Haïti, plusieurs décennies plus tard, sur la voix de Régina Jean-Baptiste, qui, dans son lit de mort, revisite son existence. Fille de domestique, ancienne esclave devenue marchande, elle incarne une résistance plus discrète, mais tout aussi inébranlable. Dans une longue adresse posthume à son amant, le général Corvaseau, fils d’Elizabeth Dubreuil, Régina déroule sa vie entre oppression et désir, humiliation et amour.
Ce récit, plus introspectif, adopte une langue poétique, presque incantatoire. Les morts y parlent, les songes s’entrelacent au réel, et la mémoire devient un espace spirituel. Le merveilleux n’adoucit rien : il souligne au contraire le tragique d’une condition. En confrontant rêve et Histoire, Lahens montre le paradoxe d’une liberté arrachée au prix d’une nouvelle hiérarchie sociale, celle de l’île d’Haïti au XIXᵉ siècle, un territoire marqué par la violence et les survivances coloniales
Lahens écrit ainsi contre le mythe d’une république noire unifiée. Son roman révèle les fractures d’une société née de la révolution haïtienne, où la pigmentation, le lieu de naissance ou le degré d’ascendance africaine orientent encore les destins. Le « miracle » haïtien s’effrite, mais demeure la dignité. Régina, comme Florette et Elizabeth avant elle, appartient à la lignée des « passagères de la nuit » : femmes sans gloire, mais non sans grandeur.
Par la densité de son écriture, Lahens redonne chair à une parole longtemps confisquée, et dans les nuits de l’Histoire, ces voix murmurent, se souviennent, et de ce murmure naît une mémoire collective à l’épreuve des violences les plus profondes. Lahens ne recoud pas le passé : elle en écoute les tremblements, dans la chair, la parole et les silences. La douleur y retrouve ses nuances, et les femmes, leur présence.
En restituant à l’esclavage et à l’après-esclavage leurs voix féminines, Lahens accomplit un geste essentiel : rendre aux marges le droit de dire l’Histoire. De la cale du bateau à la maison Dubreuil, du marché de Port-au-Prince au lit de mort de Régina, la romancière tisse une polyphonie d’ombres et dresse une mémoire sans monument. Dans cette nuit qu’elles traversent, les femmes de Lahens ne demandent pas la lumière : elles la portent.