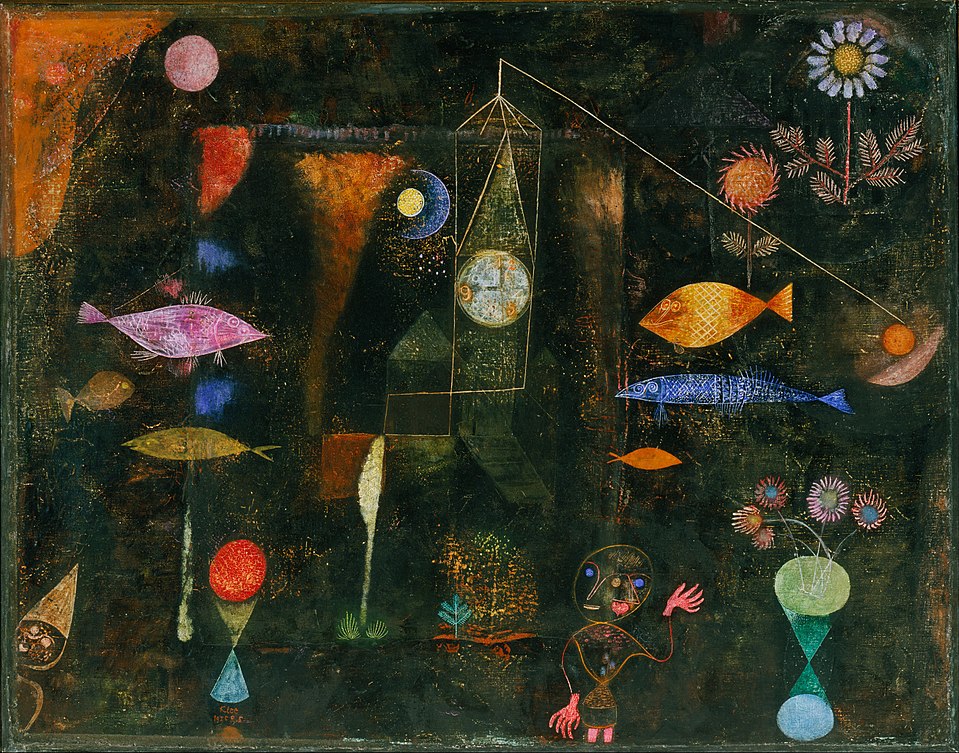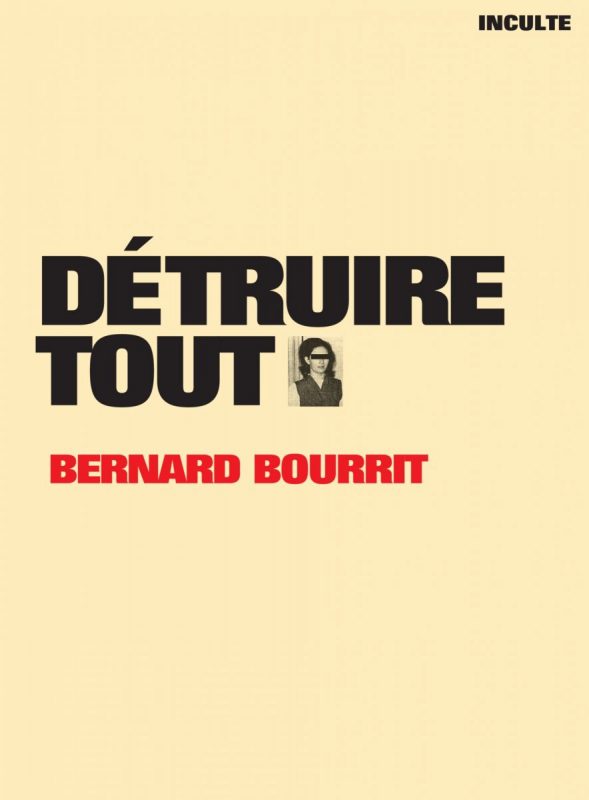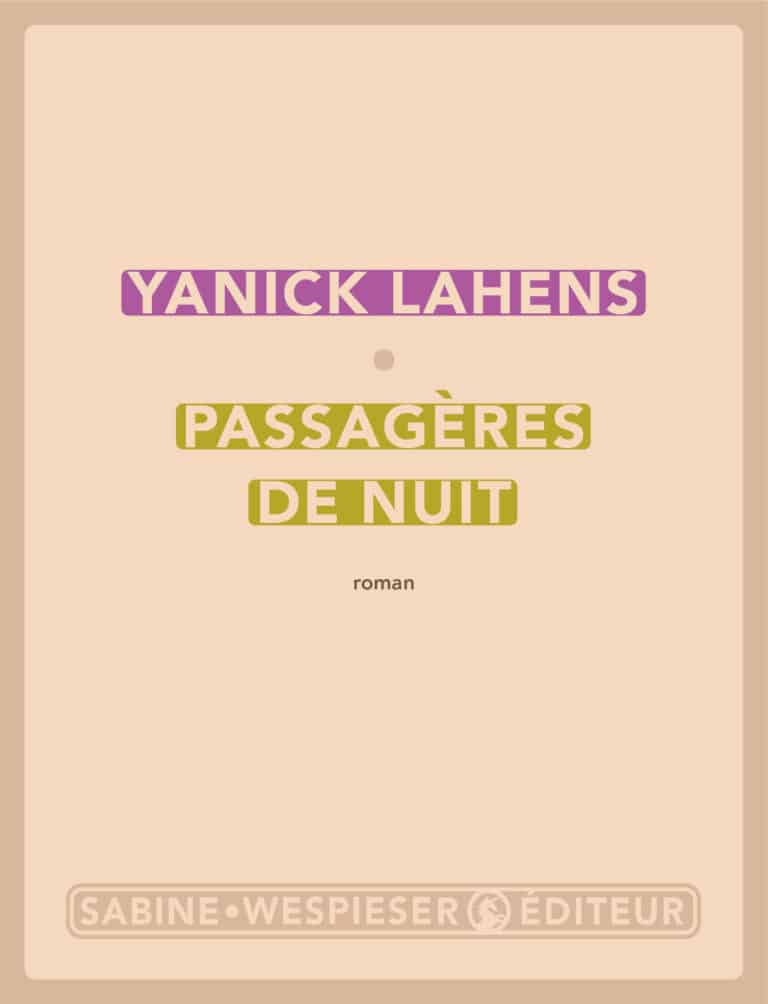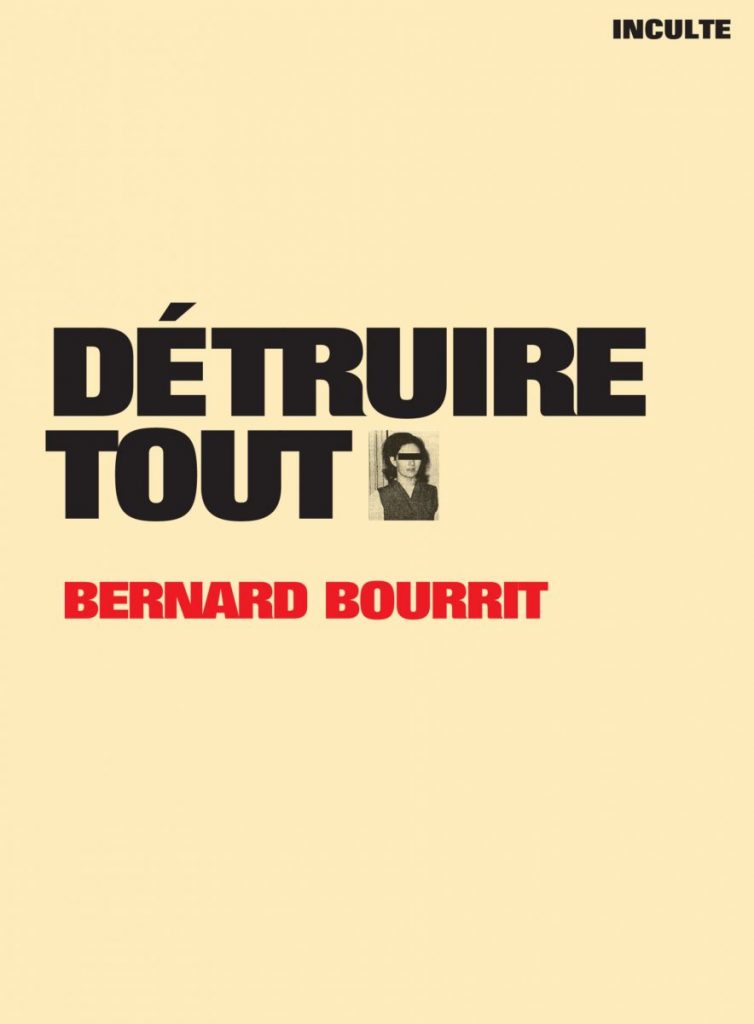La mise en parallèle de ces trois romans ouvre un espace où mon geste critique trouve sa place. Mes lectures préalables du Nom des rois et de Passagères de la nuit, auxquelles s’ajoutera bientôt la critique en cours de Passage du soir, nourrissent ce travail et permettent de préciser ce que ces textes révèlent des formes de la mémoire et des modalités de sa transmission.
Dans ma critique du Nom des rois, j’ai insisté sur la manière dont Charif Majdalani organise une oscillation entre deux régimes d’expérience : d’un côté, la rêverie solitaire et presque mythologique de l’enfance ; de l’autre, l’irruption brutale de la guerre civile qui déchire cette continuité imaginaire. J’y montrais comment l’écriture « se tient dans l’espace fragile entre la splendeur et la ruine », comment la guerre fissure la fabrique narrative, et comment la phrase elle-même porte les secousses de l’Histoire. Le roman demeure extrêmement maîtrisé, ample et musical, mais sa force réside moins dans une modernisation du traitement mémoriel que dans sa capacité à faire sentir la vulnérabilité du monde par la matière même du langage. Si j’ai relevé certains effets peut-être plus traditionnels dans sa construction, c’était pour mieux faire apparaître la beauté d’un récit suspendu entre légende et effondrement.
À l’inverse, ma critique de Passagères de la nuit soulignait la puissance politique d’une mémoire collective et descendante. Lahens ne se contente pas de représenter des trajectoires individuelles : elle active une constellation de voix féminines qui, de la servitude à l’exil, traversent la violence coloniale et postcoloniale. Dans mon appréciation, j’ai choisi d’insister sur la façon dont cette polyphonie fait surgir une mémoire qui passe moins par les archives que par les corps, les gestes et la circulation de la parole. Lahens sollicite la mémoire comme un matériau vivant, chargé d’une intensité politique singulière : une mémoire qui, loin de se borner à commémorer, devient un véritable outil d’empouvoirement, un espace où la dignité surgit malgré l’effacement. C’est, parmi les trois textes, celui qui mobilise le plus frontalement la mémoire comme force d’émancipation et comme récit fondateur d’un sujet collectif.
Ces deux lectures font déjà apparaître un axe essentiel : Majdalani et Lahens travaillent tous deux la mémoire dans un espace de tension, mais selon des orientations inverses. Chez Majdalani, l’imaginaire se délite sous la pression de l’Histoire ; chez Lahens, c’est au contraire la profusion des voix qui répare, ou du moins rend audible, une histoire cruellement lacunaire. Dans les deux cas, la littérature devient un outil pour penser la fragilité des mondes, mais aussi leur persistance à travers la résilience des individus.
La critique de Passage du soir, encore en cours d’élaboration, s’inscrit dans cette continuité tout en la déplaçant. Adrover propose un troisième régime mémoriel, fondé sur une transmission explicitement ritualisée. La mémoire y existe comme relation première, comme pacte narratif entre celles qui savent et celles qui reçoivent. Là où Majdalani fait résonner l’enfance solitaire et Lahens les voix collectives féminines, Adrover met en scène un passage conscient : un fil confié, un geste d’adresse qui devient la condition même du récit. Certains choix formels et le déroulement narratif, sans doute liés au fait qu’il s’agit d’un premier roman, apparaissent moins maîtrisés que chez les deux autres auteurs, mais cette spontanéité participe aussi de la sincérité et de l’énergie du texte. Cette dimension relationnelle souligne que la mémoire n’existe jamais isolée : elle circule, se fragmente, se recombine et se réinvente dans un espace partagé.
Ainsi, mon geste critique se déploie à travers ces lectures. Il consiste à observer comment chaque texte de ce corpus élabore un régime mémoriel singulier et à quelles fins esthétiques il le mobilise. La lecture conjointe de ces trois romans, qui partagent un même horizon mémoriel tout en s’appuyant sur des dispositifs narratifs profondément distincts, permet de saisir la fragilité des récits, leur capacité à résister à l’effacement, et la manière dont la littérature rend sensibles les enjeux de la mémoire. Un regard comparatiste sur ces œuvres ne vise donc pas seulement à repérer des similitudes et des écarts : il éclaire la façon dont la mémoire devient un agent narratif, un moteur éthique et un espace politique, tout en révélant ce que les récits cherchent à préserver.