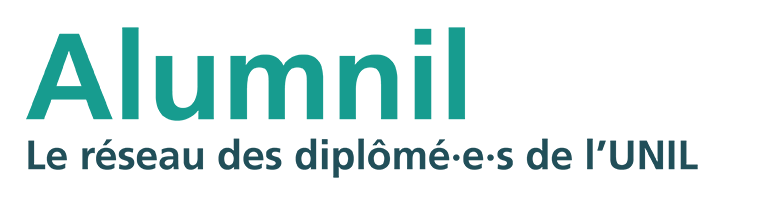Son moteur: l’interaction
Parce que sa formation universitaire ne le destinait pas à une activité spécifique, ce lettreux a débuté sa carrière professionnelle par l’enseignement avant de rejoindre le CICR, pour une décennie. En 2003, Marc de Perrot revient sur le campus pour prendre la fonction de Secrétaire général de l’UNIL. Une grande organisation, une mission au sein du service public, un nombre incalculable de projets et de rencontres: l’environnement idéal pour entretenir la motivation et l’ouverture d’esprit de cet alumnus, un peu plus unilien que les autres. Portrait de Marc de Perrot (Lettres, 1987)
Enfant, quel était le métier de vos rêves?
Jusqu’à l’âge de 16 ans, je voulais être archéologue. Tout ce qui avait un lien avec l’antiquité classique m’attirait. J’ai ainsi participé à des stages d’archéologie où, accroupi sur le sol, je brossais délicatement des morceaux de murs enfouis dans la terre.
Quel est votre job actuel?
Je suis Secrétaire général de l’Université de Lausanne, depuis 2003. Une fonction qui me fait toucher à quantité de choses et évolue constamment. Mon rôle est d’assurer que les membres de la Direction disposent des meilleures conditions pour réaliser leur mission, en termes d’organisation, d’accès à l’information et d’interaction tant avec les entités variées dont est constituée l’UNIL qu’avec les nombreuses instances, autorités, partenaires et publics qui entrent en contact avec elle.
Vous avez choisi d’étudier à la Faculté des Lettres par vocation, poussée par vos parents, pour faire comme vos amis?
Par vocation! Non pas poussé par mes parents mais avec leur soutien. Au sortir du gymnase, contrairement à mes amis, j’avais le sentiment de n’être pas encore allé au bout de ce que pouvait m’apporter l’étude de l’Antiquité. A cette époque bénie, la question des débouchés professionnels ne constituait pas un réel souci pour un jeune bachelier !Pendant mes études, j’ai exercé de nombreux jobs d’étudiants : cours privés, tri du courrier à la Poste, moissons aux Stations agronomiques de Changins, ou assistant étudiant, avant de trouver un poste fixe d’enseignant de latin dans une école privée de préparation à la matu. Pour un étudiant se lançant dans un domaine en apparence peu en lien avec la réalité quotidienne, ça a été une bonne manière d’entrer en contact avec le monde professionnel. Ces expériences ont contribué, plus tard, à mon recrutement, tout spécifiquement au CICR qu’il fallait convaincre, qu’à 27 ans, j’étais parfaitement en mesure d’évoluer dans un milieu autre qu’académique.En outre, ces jobs m’ont permis de nombreux voyages sac au dos. Le plus marquant et initiatique aura certainement été un périple de trois mois au Pakistan et au Rajasthan. Observer d’autres modes de vie si éloignés du mien offrait un complément à l’étude des Anciens, dont les valeurs étaient si différentes des nôtres, avant l’avènement du christianisme puis, en ce qui me concerne, de la Réforme. Mon mémoire de licence (master) a conclu l’épisode estudiantin en se penchant sur la manière dont un géographe grec allait chercher – parmi les populations exotiques et inconnues de la Mer Rouge – un miroir à sa propre civilisation. Avoir voyagé – puis ensuite séjourné – à l’étranger aura contribué de manière significative au développement de ma carrière professionnelle: j’ai appris à relativiser des acquis qu’à mon entrée dans l’âge adulte je croyais incontestables. C’était une condition nécessaire pour vivre et interagir en bonne intelligence avec des personnes dont les fondements culturels divergeaient fondamentalement des miens et une source d’auto-questionnement constant nécessaire pour ne jamais cesser d’évoluer.
Votre état d’esprit au moment de l’obtention de votre diplôme?
J’ai éprouvé une immense fierté et le sentiment d’avoir constitué un acquis qu’il ne me restait plus qu’à exploiter. Le monde m’attendait même si j’ignorais encore comment j’allais m’y prendre. J’ai bénéficié d’une bourse d’études d’une année à Pérouse, en Italie (Erasmus n’existait pas et la mobilité en cours d’études n’était pas encore entrée dans la pratique). Si je ne suis pas parvenu au terme de l’étude sur un sujet en grec ancien que j’avais planifiée, j’ai pu réaliser mon projet d’apprendre une seconde langue latine… et constater qu’une carrière académique consacrée à l’étude et à l’approfondissement d’un savoir n’était pas ce que j’envisageais comme futur. Je voulais plutôt utiliser ma formation universitaire pour passer à un mode plus opérationnel et interactif, dans la recherche d’un but partagé.
Que s’est-il passé par la suite?
A mon retour d’Italie, je suis passé par ce qui était l’équivalent de l’actuelle HEP, pour enseigner le français, le grec et l’histoire à des jeunes de 10 et 15 ans. J’ai ressenti qu’enseigner à des jeunes est en fait une immense responsabilité! L’adulte posté face à une classe de vingt individus en devenir exerce une influence prédominante sur leur quotidien et sur leur avenir. Il peut déterminer une vocation, comme la briser. L’enseignant est le premier adulte que les enfants voient opérer dans un cadre professionnel. Je n’ai pas toujours eu l’impression que ce ressenti était partagé par l’ensemble de mon entourage. Mais j’ai eu du plaisir à exercer ce métier; il permet de développer une créativité et une interaction orientées vers des apprentissages qui vont au-delà de la seule matière enseignée, pour interpeller et déclencher des mécanismes de réflexion autonome. J’ai également pris conscience que cette activité puisait fortement dans mes ressources personnelles sans m’offrir assez pour me régénérer. J’aurais craint l’assèchement à l’exercer trop longtemps. En revanche, j’ai réalisé, a posteriori, à quel point l’expérience pédagogique est formatrice en matière de gestion de groupe, tant d’enfants que d’adultes.
Ainsi, après deux ans passés dans un collège, j’envisageais mal d’entamer un nouveau cycle annuel sans voir poindre un début de démotivation. Je n’avais pas trente ans, j’étais célibataire, libre et je sentais l’appel du large. Mais je ne voulais plus traverser le monde en voyageur, spectateur détaché du quotidien des gens rencontrés passagèrement; je voulais participer à ce quotidien et les faire participer au mien. Je voulais également restituer un peu de la chance qui m’avait été donnée de bénéficier de la formation reçue. Depuis de nombreuses années, l’idée de travailler au CICR me titillait. Toutes les conditions semblaient réunies pour passer à l’acte.
J’ai effectué trois missions à l’étranger pour le CICR: dans la Bande de Gaza (1990-1991) à la fin de la 1ère Intifada, puis au nord de l’Irak au sein des populations kurdes, dans l’immédiat après-guerre du Golfe (1991-1992) et, finalement, en Croatie et Bosnie-Herzégovine (1992-1993), lors du conflit d’ex-Yougoslavie.
Ceci m’a amené à évoluer au milieu des conflits, Conventions de Genève en poche, protégé (il faut y croire !) par le seul symbole de la Croix rouge, avec mission d’inciter des combattants en armes – plus ou moins organisés et disciplinés – à respecter les populations livrées à leur pouvoir, à organiser le passage de convois humanitaires au travers de lignes de fronts actives puis la distribution de biens de première nécessité aux populations démunies, à faire respecter le droit humanitaire et exiger des conditions le plus décentes possibles au sein de lieux de détentions, à organiser la circulation de « messages croix-rouges », par lesquels les familles éclatées pouvaient garder la trace de leurs chers, éparpillés par la guerre, détenus, émigrés, malades ou décédés. Le premier rôle d’un délégué est de savoir activer la parole, son principal outil, pour convaincre de faire appliquer les Conventions de Genève. Mon activité principale pendant ces années aura été d’argumenter, expliquer et tenter de convaincre tous les acteurs pris dans la folie des conflits ou tirant parti de celle-ci, du chef de guerre, au détenu et à l’activiste de la société locale de la Croix-Rouge, en passant par le petit chef obtus et agressif d’un check-point isolé, dont la volonté d’affirmer son pouvoir très local peut mettre en échec des journées entières de négociation.
Partager ce vécu est difficile. Les circonstances en sont trop éloignées de ce que peuvent intégrer des personnes qui ne les ont pas vécues. A tenter de le raconter on éprouve presque toujours un sentiment d’échec à faire comprendre ce que l’on voulait faire passer. Mon cercle d’amis a d’ailleurs changé après mon retour en Suisse. Ma dernière mission, dans un contexte européen moins exotique que les précédents, a probablement été la plus éprouvante psychologiquement, en raison de l’identification facilitée avec les divers protagonistes, victimes ou perpétrants. La récompense à exercer ce métier est l’occasion qu’il offre de rencontrer des personnalités exceptionnelles qui, bien que prises dans la tourmente comme tous leurs congénères, parviennent à se sublimer pour résister à la barbarie et aux clivages nationalistes afin d’apporter toute l’aide possible à leur communauté. Avec cette question insoluble du rôle que l’on aurait joué soi-même, pris dans les mêmes circonstances. C’est également la satisfaction, souvent désabusée, d’avoir soulagé un peu de souffrance, immédiatement relativisée par le doute que l’on aurait dû et probablement pu en faire plus.
Ensuite, j’ai encore travaillé sept ans au siège du CICR, à Genève. D’abord dans l’unité de coordination des opérations dans les Balkans. Il devait s’agir d’une mission de deux ans, suivie d’un retour sur le terrain. Elle s’est finalement prolongée à sept ans, jusqu’à mon départ de l’institution. J’avais en effet réalisé que mon mariage (heureux !), survenu entre temps, constituait un choix à mes yeux, incompatible avec la disponibilité et l’exposition au risque justement requises d’un délégué. Mais ma formation de lettreux m’avait rattrapé: l’opération en ex-Yougoslavie, à propos de laquelle de nombreux gouvernements demandaient à être constamment informés, nécessitait une production abondante de rapports, rédigés par une personne sachant produire des textes structurés et connaissant les opérations. Appelé donc à rédiger de plus en plus ce type de textes, je me suis retrouvé de fil en aiguille à la tête d’une unité de 5 ou 6 rédacteurs anglophones, chargés du reporting aux gouvernements donateurs sur l’ensemble des opérations du CICR dans le monde.
Cette nouvelle activité est passée par une restructuration de l’unité de reporting, de ses missions et de ses modalités de travail, ainsi que de tout le concept du reporting aux donateurs, avec le soutien d’un consultant. Une expérience très formatrice en termes de management, de structuration d’équipe et de définition d’une stratégie. J’y ai ajouté une formation continue au SAWI pour l’obtention d’un brevet fédéral en relations publiques. Mon problème d’alors était que j’avais certes à mon actif plusieurs années d’expérience professionnelle et des compétences assez variées, mais que je ne connaissais pas les attentes et opportunités du marché de l’emploi hors CICR. La formation en emploi au SAWI m’aura été très utile pour me mettre en contact avec les métiers de la communication. Ce n’est toutefois que trois années après l’obtention du brevet que je me suis mis en recherche d’emploi. Et j’en ai trouvé un dans une agence de relations publiques à Genève.
J’ai alors exercé pendant deux ans et demi la fonction de « senior consultant » en relations publiques. Le passage d’une grande organisation humanitaire à une petite entreprise à but lucratif n’est pas anodin: l’archétype du délégué se bat sans relâche pour une noble cause, avec ses collègues réunis autour de la bannière frappée de la croix rouge, dans l’urgence perpétuelle des conflits et négocie pour sauver des vies. La première raison d’être d’une PME est – comme il se doit – de générer du profit pour faire vivre son patron et ses employés. Le consultant loue ses services à des clients pour des causes qui ne sont pas les siennes: si son travail et ses conseils amènent au résultat espéré, il n’est pas vraiment membre de l’équipe gagnante… et doit même parfois se battre encore pour que son dû lui soit payé ! En outre l’humanitaire m’avait appris à faire face à l’avalanche de travail qui m’arrivait, mais pas à consacrer une partie de mon temps à chercher et négocier des mandats pour obtenir du travail. Sans parler du fait que l’activité de certains clients n’était pas toujours en totale adéquation avec mes valeurs.
Ce poste aura eu cela d’intéressant qu’il m’a mis en contact avec des clients issus de toutes les branches du monde associatif, économique et politique. Il m’aura également permis d’intégrer la logique du fonctionnement dans le privé, dont les objectifs sont souvent à bien plus court terme que ce dont j’avais l’habitude.
C’est dire que j’ai été heureux de rejoindre l’UNIL avec la fonction de Secrétaire général. C’est manifestement dans un environnement institutionnel, au sein d’une organisation de grande dimension dont il faut constamment fédérer les différentes composantes que je suis le plus à l’aise. C’est également le sens de la mission de service au public, redevable à la communauté, qui me motive: être le moteur qui donne aux gens les conditions pour qu’ils puissent réaliser au mieux leur mission au bénéfice de la société. A quoi s’ajoute le défi d’interagir en milieu universitaire avec des personnes d’un très haut niveau d’exigence intellectuelle et de savoir contribuer à ce qu’elles disposent des conditions de travail requises, sans jamais interférer sur leur champ de compétence académique. Cette préférence déclarée n’est bien entendu pas motivée par l’idée – que j’entends parfois exprimer – d’une supériorité morale qu’aurait la fonction publique sur le secteur privé.
Si c’était à refaire, que changeriez-vous?
Je me suis souvent posé la question… et n’y ai pas trouvé de réponse. Face à l’incroyable variété de formations offertes par notre système je pense qu’il y a deux options envisageables: soit suivre son inclinaison (ou passion) pour une matière, soit choisir une formation en fonction d’une carrière visée. Je ne sais pas si l’une est plus juste que l’autre, toutes deux demandent une certaine audace et l’envie de se lancer. Le fait est que les études ne couvrent qu’une courte période de notre vie d’adulte; il faut donc s’assurer qu’elles nous permettront d’évoluer dans le système de manière à exercer à une activité motivante durant de longues années. Aujourd’hui, je vois certains de mes contemporains qui, la cinquantaine passée, n’ont plus la même énergie et ne sont plus très sûrs que leur activité soit porteuse de tout le sens qu’ils en attendraient. Ceci à un moment où il devient difficile de se réorienter et qu’il leur reste encore une quinzaine d’années d’activité professionnelle.
Les formations en sciences humaines et sociales sont souvent remises en cause par le monde politique. On trouve absurde de former des psychologues ou des littéraires, qui seraient voués au chômage. Ce que contredisent les statistiques qui montrent qu’en Suisse, ces formations donnent clairement accès à des emplois divers. On préconise une sélection accrue, dès le plus jeune âge, pour orienter les personnes le plus tôt possible vers des domaines prédéterminés, « utiles » au sens strictement économique. Quelle triste jeunesse on propose ainsi à la nouvelle génération, en ne la considérant que comme une force de production. Force de production qu’elle saura très certainement constituer de manière beaucoup plus riche après avoir préalablement investigué des champs de développement et d’ouverture de l’esprit, offerts par les branches dites classiques. Sans parler du triste projet de société exclusivement matérialiste que cela sous-tend!
Ma propre expérience me convainc qu’il est possible de suivre avec profit, tant pour soi-même que pour la société, des formations qui ne sont pas directement orientées sur un débouché professionnel spécifique. Cette option demande que l’on soit prêt ensuite à procéder à des réorientations, souvent par le biais de formations continues. Les deux plus importantes que j’ai suivies, en communication puis en direction de projet – additionnées de plus courtes et spécifiques, par exemple en gestion des personnes – ont été l’occasion d’acquérir de nouvelles compétences métier, mais aussi de me mettre en contact avec les environnements et modes de fonctionnements professionnels des autres participants, très différents des miens. A être atypique, il m’a fallu faire la translation entre les champs d’application présupposés des nouveaux acquis et ceux de mon propre environnement.
Finalement je constate que la formation littéraire m’a permis de progresser dans ma carrière parce qu’elle m’a appris à développer et exprimer clairement des concepts, puis à les organiser et articuler de manière cohérente et anticipatrice. Dans mon statut actuel de « senior », elle doit alimenter l’ouverture d’esprit requise pour intégrer et soutenir les nouveaux modes de fonctionnement apportés par mes collègues de la nouvelle génération, m’évitant aussi de me constituer, à mon insu, comme force de pérennisation des innovations, apportées par moi-même, mais progressivement en phase d’obsolescence.
Article de Jeyanthy Geymeier, Bureau des alumni, 9 novembre 2017