Complexes et difficiles à traiter, les tumeurs cérébrales représentent un énorme défi médical. Une équipe menée par la professeure Johanna Joyce a réussi à disséquer le microenvironnement des tumeurs et à analyser les différents facteurs qui favorisent la prolifération des cellules cancéreuses. Elle a ainsi ouvert la voie à des thérapies plus efficaces et réellement personnalisées.
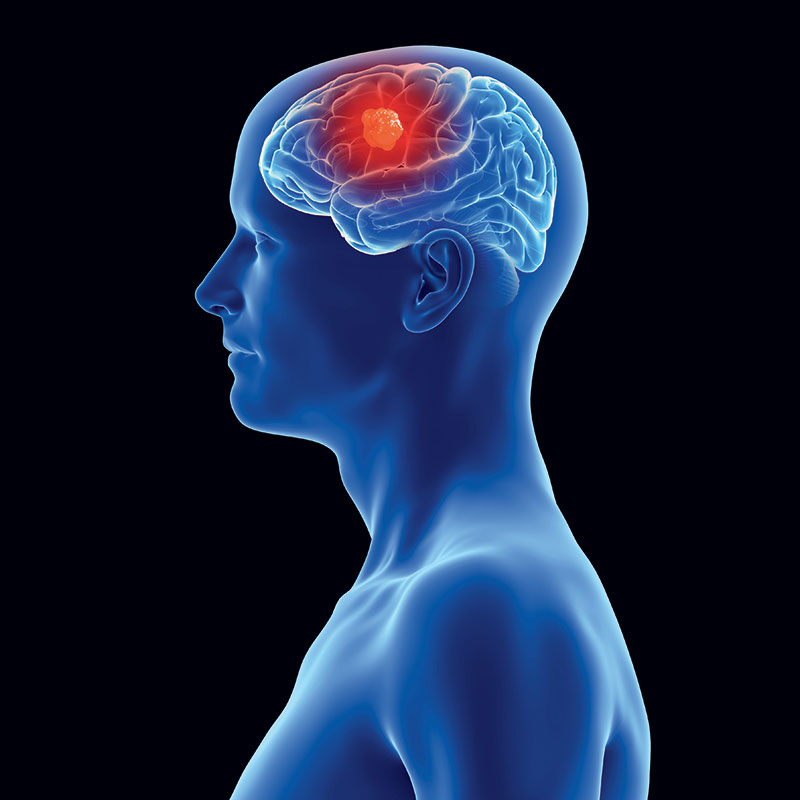
Le cancer du cerveau, qui affecte chaque année plusieurs centaines de personnes en Suisse, constitue un véritable défi pour les oncologues, car son pronostic est le plus souvent mauvais: 90 % des patients décèdent moins de cinq ans plus tard. C’est l’une des raisons qui ont poussé Johanna Joyce, professeure ordinaire à l’UNIL auprès de la branche lausannoise de l’Institut Ludwig pour la recherche sur le cancer, à s’y intéresser. Cette biologiste et généticienne de formation menait des recherches sur les tumeurs du sein et du pancréas lorsque, il y a une dizaine d’années, elle a décidé de se focaliser sur celles affectant le cerveau. Elle s’est penchée tout particulièrement sur les plus agressives auxquelles les patients ne survivent guère au-delà d’une année. «J’ai pris conscience, dit-elle, que nous avions vraiment besoin d’en savoir plus sur ces cancers, afin de concevoir de nouvelles thérapies et d’améliorer ces consternantes statistiques de survie.»
Un organe unique et complexe
Le cerveau est un organe unique en bien des points. «C’est le plus important de notre corps. De ce fait, la présence d’un cancer a un énorme impact sur tout notre être: il modifie non seulement nos fonctions physiologiques, mais aussi nos comportements et notre personnalité», souligne Johanna Joyce. En outre, le cerveau renferme différentes familles de cellules comme les neurones, les astrocytes et quelques autres «que l’on ne trouve nulle part ailleurs dans notre corps et qui le rendent particulièrement complexe».
À cela s’ajoute l’existence de la fameuse barrière hémato-encéphalique qui protège le cerveau. «Il s’agit en fait d’une porte qui s’ouvre pour laisser passer dans le cerveau l’oxygène et les nutriments circulant dans le sang et qui se ferme pour empêcher les toxines et les agents pathogènes – mais aussi les médicaments anti-cancéreux – d’y pénétrer.» Pourtant, des métastases de tumeurs venant d’autres organes parviennent à forcer le passage et à se disséminer dans le cerveau. «Nous avons constaté que, dans ce cas, les cellules cancéreuses utilisaient les mêmes mécanismes que les cellules du système immunitaire pour faire des petits “trous” dans la barrière et la franchir», précise Johanna Joyce.

Des cellules réellement malignes
Il est vrai que les cellules cancéreuses portent bien leur nom de «malignes». Elles n’ont pas leur pareil pour modifier, à leur profit, leur microenvironnement. Non seulement elles font croître de nouveaux vaisseaux sanguins qui viennent les nourrir, mais elles s’en prennent aussi aux cellules immunitaires venues les attaquer et les détruire. «Les cellules tumorales parviennent à corrompre ces dernières. Elles les incitent à sécréter des protéines, des enzymes, des facteurs de croissance qui vont leur permettre de proliférer et d’augmenter la malignité de la tumeur.»
Il y a une décennie, ces phénomènes étaient étudiés dans d’autres cancers, celui du sein notamment, mais très peu dans celui du cerveau. «Nous avons donc estimé qu’il était important de disséquer la complexité des différentes cellules et structures qui composent le microenvironnement des tumeurs cérébrales.»
Johanna Joyce et ses collègues se sont attelés à la tâche en commençant par «déconstruire» le microenvironnement des tumeurs. Ils ont isolé, puis analysé les différents types de cellules présentes dans ce magma – il y en a des centaines – «afin de savoir quelles protéines ils produisent, quels facteurs ils relâchent, etc.». Puis, à l’aide d’analyses informatiques sophistiquées, les chercheurs ont «reconstruit» le microenvironnement tumoral. Ils ont dressé des cartes qui leur permettent de savoir «quels types de cellules sont proches les unes des autres, ce qui signifie probablement qu’elles interagissent entre elles».
L’exploration du paysage immunitaire
Le cerveau peut abriter deux types de cancers: des tumeurs primaires (les gliomes), qui se sont développées à partir de ses propres cellules, et des métastases venues de tumeurs nées dans d’autres organes (souvent le poumon, le sein ou la peau). Les biologistes de l’Institut Ludwig ont voulu savoir si les premières et les secondes avaient, ou non, le même «paysage immunitaire», comme Johanna Joyce nomme l’ensemble des cellules immunitaires présentes dans le microenvironnement des tumeurs. Cela a en effet «de grandes répercussions sur le développement des thérapies utilisées contre ces tumeurs malignes dévastatrices». La réponse est en fait en demi-teinte: «Nous avons trouvé quelques similarités, mais aussi de grandes différences».
Les macrophages mangeurs des cellules mortes
Poursuivant plus avant l’exploration de ce paysage immunitaire, la chercheuse et ses collègues ont focalisé leur attention sur les macrophages. Ces cellules sont très abondantes dans le cerveau, mais aussi dans l’ensemble de l’organisme. «Des études récentes ont révélé que, chez une personne de taille et de corpulence moyennes, l’ensemble des cellules du système immunitaire du corps pèse 1 kilo 200 et que les macrophages représentent la moitié de ce poids (600 g). Incroyable, non?», constate la professeure en riant.
Nombreux, les macrophages associés aux tumeurs jouent aussi un rôle important, car ils interviennent dans la réponse aux thérapies. Lorsqu’un patient est traité par chimiothérapie, radiothérapie ou immunothérapie, la plupart de ses cellules cancéreuses sont tuées. Les macrophages arrivent alors rapidement sur les lieux et jouent les éboueurs. «Comme leur nom l’indique – en grec, macrophage signifie gros mangeur – ils “mangent” les débris et les cellules mortes», explique Johanna Joyce.
Toutefois, il arrive que les thérapies ne détruisent pas toutes les cellules cancéreuses. Celles qui en réchappent corrompent alors les macrophages et les incitent à produire tous les facteurs – notamment de nouveaux vaisseaux sanguins – les aidant à proliférer. C’est ainsi que le cancer peut récidiver et/ou devenir résistant aux thérapies. En utilisant un type particulier d’IRM (l’IRM au fluor 19), la biologiste et son équipe ont pu observer les différentes populations de macrophages et suivre leur comportement, dans l’ensemble de la tumeur et au cours du temps, par exemple après une radiothérapie. «L’IRM au fluor 19 est actuellement en cours d’évaluation clinique dans le domaine des maladies cardiovasculaires. Pour faire nos recherches, nous avons d’ailleurs employé l’instrument que le CHUV utilise pour faire de l’imagerie de certains de ses patients.» On peut donc imaginer que cette technique pourrait servir dans les services d’oncologie pour suivre l’évolution de la tumeur cérébrale d’un patient après un traitement.
Suivre un seul groupe de cellules
Les biologistes ont eu recours à ce type particulier d’IRM pour étudier les macrophages associés aux glioblastomes, les cancers cérébraux les plus agressifs chez les adultes. Ils souhaitaient savoir si le microenvironnement de ces tumeurs évoluait au cours du temps et comment l’abondance, la fonction et le comportement des macrophages étaient modifiés en réponse au traitement.
L’IRM au fluor 19 leur a permis «d’obtenir l’image d’un seul groupe de macrophages, parmi les centaines de milliers présents dans le microenvironnement de la tumeur, et de le suivre pendant plusieurs semaines», précise Johanna Joyce. Une première!
Cela pourrait avoir des implications dans la pratique clinique. «Imaginez le scénario suivant: lorsqu’un patient arrive à l’hôpital, sans avoir à faire de biopsie et en n’utilisant que cette technique d’imagerie non invasive, on pourrait voir si sa tumeur compte de nombreux macrophages et savoir s’il est un bon candidat pour des thérapies qui ciblent ces cellules immunitaires. Par ailleurs, si un patient dont le cancer a déjà été traité – souvent par immunothérapie avec laquelle les macrophages interfèrent – fait une récidive, on peut savoir si la thérapie a échoué, ou non, à cause des macrophages, et décider quel est le meilleur traitement adapté à son cas.»
Vers un pronostic à l’aide d’un test sanguin
Les neutrophiles, qui constituent une autre famille de cellules immunitaires, sont eux aussi très abondants à la fois dans la circulation sanguine et dans le microenvironnement des tumeurs cérébrales. Leur rôle est plus complexe que celui des macrophages car, «selon le contexte, ils peuvent s’attaquer à la tumeur en produisant des molécules toxiques (des dérivés réactifs de l’oxygène) ou, au contraire, favoriser son développement», explique Johanna Joyce.
En les étudiant de près, la biologiste et son équipe ont constaté que ces cellules immunitaires «qui ne vivent habituellement que vingt-quatre heures quand elles circulent dans le sang, ont une durée de vie beaucoup plus longue quand elles passent dans le microenvironnement de la tumeur cérébrale. Elles ont donc plus de temps de s’adapter à ce nouveau milieu.» Elles ont ainsi tout le loisir de produire des protéines inflammatoires et des facteurs qui favorisent le développement de nouveaux vaisseaux sanguins. En outre, comme les chercheurs l’ont découvert, «les neutrophiles cessent alors de produire des molécules toxiques». C’est dire qu’ils aident de multiples façons la tumeur à proliférer.
Les chercheurs ont aussi observé que, chez les patients souffrant d’un cancer primaire cérébral très agressif, le nombre de neutrophiles présents dans la tumeur était beaucoup plus important que chez les personnes saines ou ayant un cancer de faible grade. Cela implique que, «à l’aide d’une simple analyse de sang, on devrait pouvoir connaître l’agressivité d’un cancer et poser un pronostic», souligne la professeure de l’UNIL. Ayant accumulé un grand nombre de données sur les différents composants du microenvironnement des tumeurs, la chercheuse et son équipe vont maintenant s’attacher à rassembler toutes les pièces du puzzle. «Nous allons tenter d’intégrer toutes les informations, afin de découvrir, pour chaque tumeur, son talon d’Achille.»
Sur le plan fondamental, la professeure de l’UNIL a permis plusieurs avancées majeures dans la compréhension des tumeurs cérébrales, ce qui lui a déjà valu de recevoir de nombreuses distinctions, en particulier les Prix Cloëtta et Robert Bing décernés à des chercheurs d’exception en Suisse. Mais ses travaux pourraient aussi, et surtout, avoir un fort impact clinique. Johanna Joyce en est persuadée: pour traiter cette «maladie dévastatrice», comme elle la nomme, «on ne peut pas se contenter d’une approche du type “prêt-à-porter”. Il faut faire du sur-mesure.» Ses recherches ont jeté les bases de futures stratégies thérapeutiques adaptées à la tumeur de chaque patient. Elles contribuent ainsi à l’émergence de cette fameuse médecine personnalisée que le milieu médical et les patients appellent de leurs vœux./



