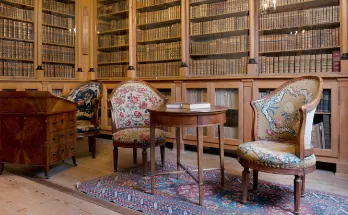Un ouvrage retrace les travaux de restauration menés de 2007 à 2020 à l’Abbatiale de Payerne. Nos connaissances au sujet de cet édifice roman exceptionnel y sont également résumées, sous les angles de l’histoire, de l’histoire de l’art, de l’archéologie et de l’architecture.
Dès que l’on entre dans la nef de l’Abbatiale de Payerne, un sentiment d’équilibre domine. Touches de couleur dans la clarté des lieux, le grès coquiller gris et la chaleur du calcaire jaune des piliers rythment l’avancée dans les sept travées, jusqu’au chœur. Édifié entre le XIe et le XIIe siècle, puis transformé (et maltraité) plusieurs fois, ce monument roman d’importance internationale possède une histoire riche. Quelle est-elle?
Un ouvrage collectif soigné, doté de nombreuses photographies, plans et documents, nous la raconte. Fruit de contributions de spécialistes de différents domaines, il marque un jalon après d’importantes rénovations, qui se sont étendues de 2007 à 2020.
Comme souvent, tout commence par les Romains. L’Abbatiale est construite en partie à l’emplacement d’une vaste villa du IIIe siècle. Un bloc de calcaire, réutilisé dans la chapelle de Grailly (on parle de «remploi»), porte une inscription en latin avec mention de P. Graccius Paternus.
Grâce aux plans, on découvre comment une première église, bâtie entre la fin du VIIIe et le début du IXe siècle, s’est vue «encerclée», plus tard, par les murs d’un bâtiment ambitieux, celui que l’on connaît actuellement. Sur la base des recherches archéologiques, les différentes campagnes de travaux menés à l’époque romane sont présentées.
Au Moyen Âge déjà, le point faible de l’Abbatiale est connu. Il s’agit de son mur nord, le premier construit. Dans l’ouvrage, les scientifiques supposent qu’à l’origine, le couvert de la nef devait être réalisé en bois, mais que le programme a changé en cours de route pour de la pierre, bien plus lourde. Tout ce qui a été tenté depuis des siècles pour renforcer cette paroi est exposé. En 2006, un risque d’effondrement est révélé. Le problème a été réglé au moyen de neuf tirants verticaux, soit des câbles qui passent à travers les piliers pour s’ancrer douze mètres sous terre, afin d’empêcher l’édifice de se désolidariser. Près de la moitié du livre est consacrée à présenter les patientes démarches de restauration, qu’il s’agisse des décors sculptés ou des toits. L’état d’esprit qui les a guidées, dans une optique de conservation, est également expliqué, tout comme la conception du parcours muséal actuel.
Enfin, des pages sont évidemment consacrées au monastère, fondé au Xe siècle et rattaché à l’Abbaye de Cluny par l’impératrice Adélaïde (lire également l’article). La vie quotidienne des religieux est traitée au travers de leur régime alimentaire bien doté en cholestérol, dans un chapitre étonnant.