En 2008, la dette avait mauvaise réputation: les organisations internationales, le FMI par exemple, faisaient pression sur des pays comme la Grèce pour qu’ils adoptent des plans d’austérité et effacent au plus vite une partie de leur ardoise. En pleine crise de la Covid-19, treize ans plus tard, la plupart des économistes plaident pour que l’État emprunte et ouvre plus largement son portemonnaie pour soutenir l’économie. Y a-t-il des dettes meilleures que d’autres? Les réponses de Philippe Bacchetta, professeur de macroéconomie à la Faculté des HEC de l’UNIL.
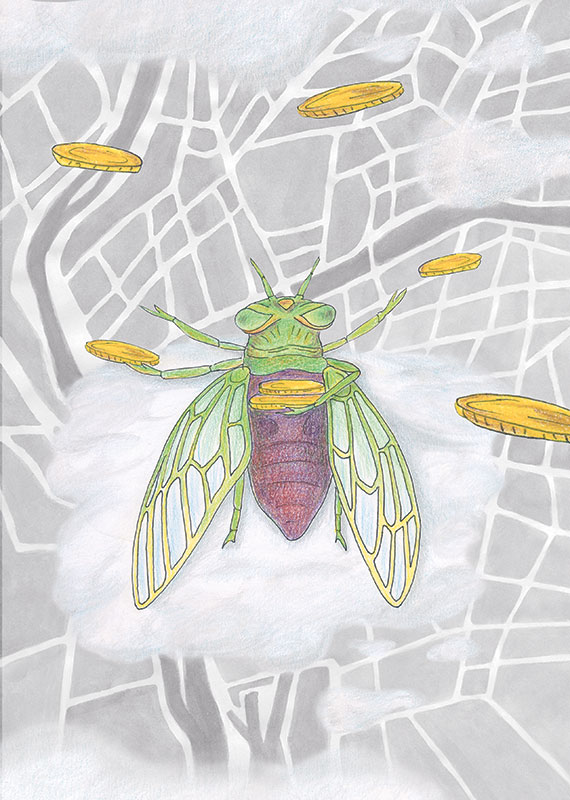
Après la crise des subprimes de 2008, les pays qu’on appelait plutôt péjorativement les PIGS (pour Portugal, Irlande, Grèce et Espagne – Spain) ont subi de grosses pressions pour réduire leur dette et présenter des plans d’austérité drastiques, au point que les résidants de ces pays manifestaient en disant qu’on allait les étrangler.
Pourquoi la dette avait-elle si mauvaise presse?
Le niveau de la dette était insupportable pour ces économies. Ces pays avaient en partie caché leur comptabilité, la Grèce notamment. Sa situation économique ne lui permettait même plus d’assumer les intérêts de la dette.
À partir de quand un pays est-il trop endetté?
En général, on s’intéresse au ratio entre la dette et le PIB. Si on prend comme référence ce qui était demandé par Maastricht, on tourne autour des 60%: tant que votre dette se monte à peu près à ce pourcentage-là de votre PIB, ça va. Mais d’autres paramètres entrent en ligne de compte. Le Japon par exemple vit très bien avec une dette de 200%. Cela est accepté par les marchés parce que la dette est détenue en grande partie par les Japonais eux-mêmes. Et on suppose qu’ils ne vont pas lâcher leur pays, comme pourraient être tentés de le faire des investisseurs étrangers, qui seraient susceptibles de vouloir investir ailleurs – c’était d’ailleurs un des risques qui menaçait la Grèce. Il y a aussi la confiance qu’inspire l’économie d’un pays dans sa capacité à supporter le poids de la dette. De ce point de vue, l’Italie, dont le taux est supérieur à 150%, a une crédibilité moins grande que le Japon. Les capacités du gouvernement à gérer la situation sont aussi un élément important: s’il décide d’augmenter les impôts pour assainir la situation, que se passera-t-il? Les pays dans lesquels l’évasion fiscale est courante peuvent moins se permettre une dette importante.
La Suisse dispose d’un frein à l’endettement. Qu’est-ce que c’est exactement?
D’autres pays ont des mécanismes comparables, par exemple certains États des États-Unis, ou l’Allemagne – ce n’est pas une exclusivité suisse. Le but est de veiller à ce qu’un pays ne s’endette pas trop, qu’il navigue dans une fourchette acceptable. En période de récession, on admet qu’elle soit plus élevée, pour aider à passer le cap, et quand l’économie se porte mieux, on veille à ce qu’elle diminue à nouveau. L’objectif étant qu’elle reste constante à moyen-long terme. Mais en Suisse, ce mécanisme n’a pas fonctionné comme il aurait fallu. Plutôt que d’instaurer un frein à l’endettement, on a opéré une véritable marche arrière pour réduire la dette – alors qu’une fois encore, le but d’un tel instrument n’est pas de la diminuer, mais de garder l’endettement sous contrôle. En Suisse, depuis le début des années 2000, on est passé d’environ 60% à environ 30% aujourd’hui.
Ce qui est très peu en comparaisons internationale – et on entend en Suisse de plus en plus de voix qui disent que la dette, c’est formidable, surtout en cette période de taux négatifs, et qu’il ne faudrait pas hésiter…
Non, ce n’est pas formidable, d’ailleurs je ne crois pas que quiconque défende cette idée. Simplement, actuellement les besoins sont immenses. Lutter contre la pandémie, soigner les gens malades coûte cher, et certaines mesures ont placé des pans entiers de l’économie dans une situation catastrophique. Je pense par exemple à la restauration, mais il y en a beaucoup d’autres, sans compter les entreprises qui gravitent autour de ces industries, les fournisseurs par exemple. La question, c’est: est-ce qu’on a les moyens de répondre à ces besoins? Une option serait d’augmenter les impôts, mais avec le chômage partiel qui vient encore noircir le tableau, réduire le pouvoir d’achat des gens n’est pas la meilleure piste pour soutenir l’économie.
Et c’est là qu’intervient la dette?
Elle apparaît dans notre contexte économique particulier comme un moindre mal. Il y a un consensus assez large sur le principe, la question débattue étant plutôt de savoir jusqu’où on augmente la dette pour aider l’économie. Mais c’est vrai qu’il y a tout de même débat, aux extrêmes, certains estimant que la dette, c’est sacré, avec une vision presque religieuse du principe: il ne faut pas la creuser, mieux vaut laisser certaines entreprises faire faillite. Je suis favorable à plus de générosité, il faut y aller maintenant, c’est le moment d’aider les PME à passer le cap, pour que notre économie soit prête à repartir tout de suite, dès que les mesures s’assoupliront, et ce sans passer par une longue récession.
Les personnes opposées à la dette arguent du fait que ce n’est pas très responsable de creuser un trou que les générations suivantes devront combler…
C’est vrai qu’on entend quelques politiciens opposés à la dette dire ceci. Mais c’est absurde, particulièrement en ce moment: les taux sont négatifs, donc emprunter ne nous appauvrit pas. De façon plus générale, les ménages qui s’endettent doivent être très prudents parce qu’ils doivent rembourser un jour, et qu’un taux d’endettement élevé peut les mener à des situations très difficiles. Là, la dette peut être excessive. Parce que les êtres humains doivent rembourser. Pour les États, c’est très différent. Ils ne meurent pas. Les générations futures devront certes supporter le poids des intérêts, mais pas rembourser–et encore une fois, aujourd’hui, les taux sont négatifs.

Et dans 10 ans?
Dans 10 ans, il y aura certainement un coût. Mais les États ont des moyens que les individus n’ont pas pour diminuer le poids de la dette. Comme nous l’avons vu, il faut rester idéalement sous les 60% de taux d’endettement, lequel est un ratio entre le PIB et la dette. Pour diminuer ce taux, vous pouvez augmenter le PIB. C’est d’ailleurs la finalité du soutien à l’économie: qu’elle reparte, et que le PIB croisse. Il n’y aurait alors pas de coût à la dette, ou en tout cas rien d’insupportable. Ce serait beaucoup moins cher financièrement et humainement que de laisser tomber les PME.
C’est donc pour ça que la dette est en ce moment plébiscitée?
Nous sommes très nombreux à penser qu’il faut soutenir l’économie maintenant, pour mieux redémarrer en 2022, quand on en aura fini avec la crise sanitaire. C’est important pour qu’on ne perde pas le tissu économique. L’idée étant d’alléger la souffrance actuelle pour repartir d’un bon pied. Une partie des dépenses de l’État est aujourd’hui directement en rapport avec le système sanitaire. C’est bien sûr indispensable. Comme il était indispensable de fermer les magasins et les restaurants pour stopper les contaminations. Mais tout cela a aussi un coût pour l’économie: il ne faut pas l’oublier. Investir maintenant permettra non seulement de redémarrer plus vite, mais aussi de préserver l’emploi. S’assurer que la croissance reprenne est essentiel, et cela passe par un soutien fort et rapide. Cela implique d’augmenter la dette, mais ce n’est de loin pas un problème aussi grave que de laisser couler des pans entiers de notre tissu économique.
Trouver des compromis sur les mesures, en gardant par exemple les restaurants ouverts mais en limitant les heures d’ouverture, pour modérer les pertes financières, c’était une bonne idée?
En novembre et décembre, on a voulu protéger l’économie en ne fermant pas tout. Mais l’épidémie a duré plus longtemps, avec des hauts et des bas, et un effet yoyo. Les mesures radicales, on ferme tout pour arrêter la circulation du virus, puis on redémarre plus vite, sont plus efficaces à la fois d’un point de vue sanitaire et économique.
Dans quelle situation se trouve actuellement la Suisse pour emprunter?
Dans une situation excellente, privilégiée même, grâce au frein à l’endettement. La Suisse a un taux d’endettement très bas, d’environ 30%, ce qui nous donne vraiment de la marge; je le rappelle, selon les travaux faits dans la perspective du Traité de Maastricht, être légèrement sous 60% est déjà un bon taux.
Comment expliquer que certains en Suisse soient opposés à une augmentation de la dette pour soutenir l’économie dans cette situation très particulière?
D’un point de vue économique, honnêtement je ne comprends pas; il n’y a pas vraiment de bon argument pour y être opposé – d’ordinaire on peut admettre qu’il y a les intérêts à payer et que ce peut être une charge, mais quand ils sont négatifs comme maintenant, le raisonnement ne tient plus. Et non, nos enfants ne vont pas devoir rembourser ce que nous aurons emprunté. Donc j’avoue que je ne comprends pas bien le discours de ceux qui s’opposent à ce que nous empruntions aujourd’hui pour soutenir l’économie qui souffre, dans le but de redémarrer plus vite, sans destruction du tissu économique et en préservant des PME, donc des emplois. Le seul élément qu’on pourrait entendre, c’est que si on augmente notre taux d’endettement disons jusqu’à 60%, et qu’une autre crise ou pandémie survient en 2025 par exemple, nous serions alors dans une moins bonne position pour l’affronter. Mais on ne va pas renoncer à réagir face à la crise dans laquelle nous sommes aujourd’hui pour nous préserver d’une hypothétique crise dans quatre ans!
Concrètement, si la Suisse empruntait davantage maintenant, que faudrait-il faire de cet argent pour qu’il soit le plus utile possible?
Il y a d’abord les coûts supplémentaires induits par la pandémie, qu’il faut bien payer: le système de testing, de traçage, la vaccination, tout cela a un prix, et il ne faudrait pas que l’argent soit un frein pour les déployer, puisqu’ils sont indispensables si on veut contenir le virus, et finalement s’en débarrasser. Ensuite, il y a les compensations aux entreprises qui ont dû cesser ou ralentir notablement leurs activités. On peut imaginer de partir avec des prêts, et qu’elles remboursent si la reprise est rapide. Sinon, il faudra oublier une partie de la dette – le fardeau risque sans cela d’être trop lourd, certaines PME ne pourront pas fonctionner. On le sait, la culture, le tourisme, l’hôtellerie, la restauration sont des secteurs qui souffrent. Ça, c’est pour l’immédiat – et c’est assez facile d’identifier ce qu’il faut faire maintenant.
Et à plus long terme?
C’est plus difficile de trancher aujourd’hui déjà. Faut-il imaginer un plan de relance, avec des investissements publics importants dans les infrastructures, par exemple dans les transports, les télécoms? Comme on ne sait pas encore de façon certaine comment les choses vont évoluer sur le plan de la pandémie ni comment va se passer la reprise, je suis d’avis qu’il ne faut pas se précipiter pour ce deuxième volet. Mais ce n’est pas interdit d’y penser et de réfléchir aux investissements qui seraient les plus intelligents pour le développement futur de la Suisse. L’Union européenne a libéré des fonds pour des plans d’investissement de ce type, les USA ont aussi un gros programme pour le moyen terme. Ce pourrait être quelque chose d’intéressant pour la Suisse si les taux restent négatifs. Pas un plan global de relance keynesien, mais quelque chose de ciblé sur les infrastructures – je pense particulièrement aux énergies renouvelables. Cela permettrait de redémarrer l’économie pour au moins les dix prochaines années. Lancer une réflexion sur cette question serait de toute façon intéressant. Donc pour la suite, je dirais: à discuter!



