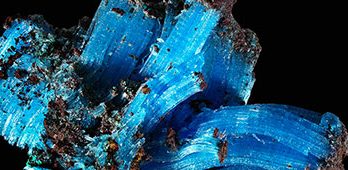La Suisse connaît une pénurie de médecins, et en particulier de médecins de premier recours. Que faire? Depuis plusieurs années, l’UNIL augmente le nombre de praticiens qu’elle forme. Ainsi, si l’institution a compté 120 diplômés en 2010, elle prévoit 245 places en master pour 2020. De plus, à l’avenir, certains médecins seront recrutés dans d’autres filières, comme les Sciences de la vie ou les Sciences infirmières. Ces nouveaux profils devront s’occuper d’une population vieillissante.
Début octobre 2028, dans une petite ville du canton de Vaud. Les habitants se félicitent de l’ouverture de la «Maison de la santé». Plusieurs généralistes, principalement des femmes, travaillent dans ce cabinet de groupe. La plupart d’entre elles a mené à bien la formation universitaire classique de médecin. Diplômée en Sciences infirmières, l’une des soignantes a fait partie de la première volée du master de Nurse practitioner, mis en place par l’UNIL, l’UNIGE et la HES-SO au début des années 2020. Sa mission principale consiste à suivre et traiter, de manière autonome, certains patients atteints de maladies chroniques. Davantage tournée vers la recherche, une autre collègue, médecin, exerce au CHUV. Cette ingénieure, qui a prolongé ses études en biotechnologie à l’EPFL par un master en Médecine de l’UNIL, s’intéresse à l’application des nouvelles technologies dans le domaine de la santé.
Pour imaginaire qu’elle soit, cette aquarelle du futur s’inspire de l’évolution possible de la formation médicale en Suisse romande. Une mutation qui s’inscrit dans la dynamique de l’accroissement et du vieillissement de la population, ainsi que de la pénurie de médecins de premier recours. Des données récentes indiquent que 60% de ces derniers seront à la retraite d’ici à 10 ans. Au niveau suisse, il en manque aujourd’hui plus de 2000 à plein temps pour atteindre la couverture recommandée (par l’OCDE) d’un omnipraticien pour 1000 habitants. Cette situation n’est toutefois pas une fatalité: des actions ont été entreprises depuis quelques années déjà.
Avant d’aller plus loin, il convient de préciser que les exigeantes études de médecine, dites prégraduées, durent six ans en théorie (bachelor puis master de durées égales). Elles se concluent par un examen fédéral, dont le contenu est le même partout en Suisse. Après quoi, les diplômés choisissent librement la suite de leur carrière, parmi les 44 formations postgraduées pilotées par l’Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue (ISFM). Il s’agit de spécialisations (et de sous-spécialisations), dont la médecine de famille fait partie. Ce cursus dure au moins aussi longtemps que le parcours académique. En moyenne, un professionnel en a terminé à plus de 37 ans.
Revenons au manque de généralistes. «Quatre moyens permettent d’agir sur cette pénurie, expose Dominique Arlettaz, recteur de l’UNIL jusqu’à fin juillet 2016 et aujourd’hui président du Conseil d’administration de l’Hôpital du Valais. D’abord, l’Université peut former davantage de médecins. Ensuite, elle peut contribuer à la création de nouvelles professions, qui répondent aux besoins des patients, notamment ceux atteints de maladies chroniques.» Les deux autres points échappent par contre à l’influence de l’académie. «Il serait sans doute possible de réformer la formation postgraduée. Enfin, la structure de la profession, c’est-à-dire, par exemple, la question des rémunérations ou celle du moratoire de l’ouverture des cabinets médicaux, constitue un levier important.»
En 2014, les Hautes Ecoles universitaires suisses ont délivrés 863 titres en Médecine humaine (dont 148 à l’UNIL), soit autant (ou aussi peu) qu’au début des années 80. Consciente du problème, la Confédération a lancé en 2016 un «Programme spécial de Médecine humaine 2017-2020», doté de 100 millions de francs. En échange de cette somme, ce plan exige 1300 master en Médecine humaine délivrés par les universités suisses à l’horizon 2025.

Même si ce montant ne sera attribué qu’une seule fois et que les cantons devront prendre en charge les coûts une fois la somme épuisée, l’argent fédéral suscite des appétits et des envies. Ainsi, 100 places en bachelor de Médecine seront créées par l’EPFZ à l’automne 2017. Les Universités de Suisse italienne, de Saint-Gall et de Lucerne, en partenariat avec l’Université de Zurich, vont ouvrir de nombreuses places de master ces prochaines années, tout comme l’Université de Fribourg, qui va en proposer 40. Ces 100 millions auraient pu susciter une foire d’empoigne. Mais un important effort de coordination a été mené au sein de la Chambre des Hautes Ecoles universitaires, présidée par Dominique Arlettaz. Les institutions de formation présentent aux Autorités politiques un plan global au niveau national. Les flux d’étudiants entre le bachelor et le master, ainsi que la question des stages cliniques, ont été organisés – sur le papier – au niveau national. En l’état actuel des projets, le but fixé par la Confédération pour 2025 sera atteint.
L’UNIL n’a pas attendu les ordres de Berne pour agir. Depuis 2012 déjà, l’institution augmente sa capacité de formation. De manière coordonnée, les quatre autres Facultés de médecine suisses (Genève, Bâle, Berne et Zurich) ont réalisé un effort similaire. En 2020, sur le campus lausannois, 220 places de master seront proposées. Il convient d’en ajouter 25, ce qui permettra une diversification des profils d’étudiants (lire au point 4 ci-dessous). Nous arrivons à un total de 245, contre 120 en 2010. Ce chiffre devrait être très proche du nombre final de diplômés, car les étudiants qui commencent un master mènent leur parcours à bien et décrochent leur titre fédéral, en très grande majorité. Cette montée en puissance est rapide, car au printemps dernier, près de 200 d’entre eux effectuaient leur 6e année.
«Les médecins ne poussent pas aux arbres», comme aime à le rappeler Dominique Arlettaz. Pour que l’université puisse en former davantage, à qualité au moins égale, elle a besoin de davantage d’enseignants, de locaux, d’argent et… de patients. Les premiers se recrutent principalement dans les hôpitaux universitaires ou régionaux. Dès l’automne 2017, la mise en service de deux nouveaux auditoires à la rue César-Roux 19 à Lausanne devrait répondre au deuxième souci, conjointement avec d’autres mesures. Le volet financier «demeure toujours une difficulté, mais la volonté affirmée des Autorités politiques vaudoises permet de résoudre cette question», note le recteur. C’est «l’accès aux malades» qui cause le plus de difficultés… en Suisse romande.
Au niveau des études…
En 3e année de Médecine (la dernière du bachelor), puis au début de la 4e (la première du master), l’étudiant entre en contact avec les patients–sous la dénomination officielle d’enseignement au lit du malade (ELM). Vingt semaines de pré-stages en ambulatoire et à l’hôpital (les «cours-blocs») jalonnent la suite de la 4e année et la 5e année. Enfin, la 6e année impose 10 mois de stages, avec un séjour obligatoire minimal d’un mois en Médecine interne, de famille, en chirurgie et en psychiatrie. A cette occasion, certains partent à l’étranger pour découvrir d’autres manières de travailler.
Ces parties pratiques se déroulent au CHUV et dans les hôpitaux romands qui collaborent avec l’UNIL. Les cabinets privés sont également mis à contribution. Giorgio Zanetti, vice-recteur en charge de l’enseignement, et directeur de l’Ecole de médecine jusqu’à fin juillet 2016, qualifie de «magnifiques» ces périodes d’exposition clinique. «Des efforts sont menés afin de les structurer davantage et de les doter d’objectifs pédagogiques encore plus clairs.»
Des moyens financiers supplémentaires ont été mis à disposition des hôpitaux, afin qu’ils puissent faire face à l’augmentation du nombre de stagiaires. «Cela permet de compenser le temps que les médecins-cadres consacrent à suivre nos étudiants», explique le professeur.
Au-delà des questions financières, ce dernier relève que les institutions sont souvent demandeuses. «La pénurie leur cause des soucis de recrutement. Des stagiaires avec qui ces hôpitaux ont tissé des liens peuvent devenir, quelques années plus tard, les médecins qu’ils recherchent», remarque Giorgio Zanetti. Cet aspect est également valable pour les praticiens en cabinet, qui rencontrent peut-être ainsi la relève dont ils ont besoin.
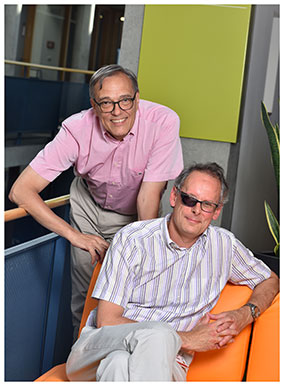
… Et après les études
«Les jeunes médecins qui sortent de l’UNIL en savent beaucoup, même si la partie pratique de leur bagage est encore restreinte», remarque Pierre-François Leyvraz, directeur général du CHUV. Une fois en possession de leur diplôme fédéral de médecin, ils entrent à l’hôpital (universitaire ou régional) en tant que médecins assistants. «C’est au contact de leurs aînés, un peu sur le modèle du compagnonnage, qu’ils mènent leur formation postgraduée», poursuit le professeur. Ce dernier ajoute que l’augmentation progressive de leur nombre incite les hôpitaux à communiquer encore mieux entre eux, afin d’organiser leurs «voyages» dans les différents services.
Ce détour démontre que les étudiants et les médecins assistants doivent avoir accès aux patients, si l’on veut assurer la qualité de leur formation. Or, même s’il faut s’en réjouir, ces derniers sont juste assez nombreux en Suisse romande pour permettre suffisamment de pratique. Notre région forme en effet 35% des médecins suisses, alors qu’elle abrite 24,7% de la population du pays. En Suisse alémanique, et surtout dans sa partie orientale, la situation inverse prévaut, avec des bassins de malades qui ne sont pas mis à contribution si l’on peut utiliser cette expression. C’est également dans cette région que la pénurie de médecins de premier recours s’avère la plus aiguë.
A chaque rentrée de septembre, plus de 400 jeunes entament des études de Médecine à l’UNIL. Ce grand intérêt n’empêche toutefois pas la création d’autres profils. En partenariat avec l’EPFL, et dans le cadre du «Programme spécial» de la Confédération, l’UNIL a déposé un projet de passerelle d’un an, doté à terme de 40 à 50 places. Il s’adressera dès 2017, ou 2018, aux personnes qui ont décroché leur bachelor en Biologie ou en Sciences de la vie (comme la Bioingénierie par exemple), à l’UNIL, à l’EPFL ou dans une autre université suisse, et qui souhaitent poursuivre leur formation en médecine.
Pendant ces deux semestres denses comme le platine, les étudiants devront «renforcer leurs connaissances en sciences pré-cliniques, comme l’anatomie, l’histologie, la microbiologie ou la physiologie, et étudier les sciences cliniques de base», explique Giorgio Zanetti. Par contre, ils possèdent déjà un solide bagage en sciences naturelles: biologie, chimie et physique. Ces disciplines figurent justement au programme des premières années du bachelor en Médecine.
Une fois leur année «passerelle» réussie, ces grands travailleurs rejoindront leurs camarades en 1re année de master de médecine «classique» à l’UNIL ou dans d’autres universités.
L’arrivée sur le marché de ces blouses blanches au profil composite répond à une demande croissante. «En trente ans de carrière, j’ai constaté les progrès extraordinaires, et de plus en plus rapides, réalisés par les technologies médicales. Le pilotage des machines, par exemple en oncologie, demande des compétences en informatique, en physique et en médecine», note Pierre-François Leyvraz. Même si la passerelle s’adresse à un nombre limité de personnes, elle va contribuer à la création de nouveaux profils de médecins et «à renforcer la recherche dans les hôpitaux universitaires» ajoute le directeur général.
Une autre piste va être explorée. En partenariat avec la HES-SO, l’UNIL propose déjà depuis 2009 un master en Sciences infirmières. A moyen terme, les deux hautes écoles envisagent de créer avec l’Université de Genève un master donnant accès à une pratique avancée. Sur quelle profession va-t-il déboucher? «En Occident, les médecins s’occupent beaucoup de patients atteints de maladies chroniques, constate Dominique Arlettaz. Une fois que le diagnostic a été posé et le traitement entamé, d’autres professionnels, que l’on appelle par exemple des Nurse practitioners aux USA ou au Canada, pourraient prendre le relais de manière autonome, mais en collaboration avec des médecins, afin d’assurer le suivi des soins.»
Le professeur est bien conscient que l’apparition d’une telle fonction bousculerait les mondes médical et politique, et surprendrait les patients. Le cadre légal devrait également changer, afin que ces Nurse practitioners obtiennent le droit d’exercer avec une certaine autonomie. Le chemin à parcourir est long, mais prometteur. Sa réussite aura besoin du soutien et de la détermination des Autorités politiques cantonales et fédérales.
Une fois leur titre fédéral en poche, «les diplômés sont entièrement libres de choisir la spécialisation qu’ils souhaitent», relève Pierre-François Leyvraz. Mais si, d’aventure, peu d’entre eux se décident à devenir médecins de premier recours, les efforts actuels risquent d’être inutiles. Allez savoir! a mené l’enquête afin de mieux connaître les intentions des premiers concernés (lire l’article).
Aujourd’hui, c’est par une bonne information et par des stages que l’UNIL cherche à rendre attractive la «médecine interne générale». Des cours dédiés, un forum «Carrières médicales» et des ateliers la mettent particulièrement en valeur. «Même au début de leur master, peu d’étudiants ont déjà déterminé leur spécialisation. Ils sont assez ouverts. Notre rôle consiste à les inciter à des choix plus précoces, et en particulier à les sensibiliser à la médecine de premier recours», note Giorgio Zanetti. Afin de les inciter à clarifier leur choix, un suivi plus serré des projets professionnels va être mis en place.
Même si l’institution s’efforce de faire aimer le métier, les personnes interrogées par Allez savoir! indiquent que c’est bien souvent la rencontre avec un généraliste, à l’occasion d’un stage, qui motive–ou non–un jeune à se décider pour cette filière. Car les conditions de travail (horaires, permanences, salaires, embrouilles avec les assurances-maladie?) pèsent lourd.
Au niveau postgradué, le patchwork éclaté des 44 spécialisations et sous-spécialisations (alors que le diplôme fédéral est unique), permet aux jeunes médecins assistants de butiner pendant quelque temps avant de se décider. «Tout le monde s’accorde à dire que leur choix devrait se faire plus tôt. Le système actuel coûte trop cher, en temps et en argent», note Giorgio Zanetti. Un pas plus loin, Jean-Daniel Tissot, doyen de la Faculté de biologie et de médecine, estime que le catalogue proposé «est davantage lié à des questions syndicales et de facturation des prestations qu’aux besoins réels de la société». Pour lui, la formation postgraduée est «densifiable, mais pas avec la trop courte semaine de 50 heures qui prévaut actuellement». Enfin, «les Autorités en charge de la santé publique souhaitent avoir davantage d’influence sur l’orientation vers les différentes spécialisations», dit Pierre-François Leyvraz. Tout cela signifie que la liberté actuelle pourrait se voir quelque peu remise en question, à terme, à moins que les Autorités politiques créent des conditions suffisamment incitatives.
Jean-Daniel Tissot souhaite que les évolutions en cours représentent l’occasion d’observer la pratique médicale–et ses progrès technologiques impressionnants–d’un œil extérieur. Pour lui, «un médecin doit être capable de penser le soin de manière globale. Il s’agit de prendre en charge la souffrance des patients en considérant ces derniers dans leur ensemble, soit dans leur environnement familial, social et spirituel. C’est-à-dire bien au-delà de leurs maladies ou de leurs gènes.» Une préoccupation qui s’inscrit dans le fil des réflexions de Montaigne, qui, dans ses Essais, mentionne «l’estroite couture de l’esprit et du corps entre-communiquant leurs fortunes». (I, 21). Le doyen n’est pas certain qu’un tel état d’esprit soit «enseignable. Est-ce qu’il ne mûrit pas plutôt au cours des expériences de vie du praticien?»
Enfin, la «société doit également se demander ce qu’elle attend de ses médecins». Au Moyen Age, les barbiers-chirurgiens étaient fort mal considérés. Leur position dans l’échelle sociale a depuis été totalement renversée. Au point qu’aujourd’hui, il est légitime de se demander: «Ne sommes-nous pas devenus dépendants de la médecine»
Article suivant: «En tout cas, j’espère que tu ne vas pas faire généraliste»
Dans leur effort de revalorisation de la branche, l’IUMF, l’UNIL et le CHUV s’accordent sur le terme de «médecin de famille» ou «médecin de premier recours», qui inclut le pédiatre. Mais «généraliste» reste la dénomination la plus souvent employée par les étudiants et plus généralement par la population.