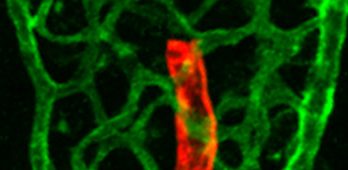Chercheur en sciences sociales à l’UNIL, Jérémie Voirol étudie les fêtes privées et publiques dans la région d’Otavalo, au nord de l’Equateur. Un complément à l’article paru dans Allez savoir ! 62, mai 2016.
Depuis une dizaine d’années, l’anthropologue Jérémie Voirol arpente l’Equateur, son terrain de recherche. En 2003 déjà, son mémoire de licence à l’Université de Neuchâtel portait sur la musique techno écoutée par les jeunes des élites de ce pays d’Amérique du Sud. «Par curiosité et intérêt pour les autochtones», ce doctorant au Laboratoire d’anthropologie culturelle et sociale a appris le kichwa (la langue des autochtones de la partie andine, qui était celle des Incas).
Après avoir effectué plusieurs séjours en immersion dans la région d’Otavalo (au nord de l’Equateur, à 2500 mètres d’altitude et 2 heures de bus de Quito), Jérémie Voirol a décidé de consacrer sa thèse – dirigée par Irène Maffi – aux fêtes locales, qu’elles soient privées ou publiques. Parmi ces dernières figure le «Pawkar Raymi Peguche Tío», un grand évènement annuel qui se tient dans la petite localité de Peguche. L’édition la plus récente, dont Alpha Blondy était la tête d’affiche, a eu lieu du 31 janvier au 14 février 2016.
L’anthropologue a assisté à cette manifestation avec Francis Mobio, chargé de cours à l’Institut religions, culture et modernité. Celui-ci a documenté la recherche, par la photographie et la vidéo. Un voyage soutenu par la Fondation Lobsiger, la Société académique vaudoise et la Fondation Van Walsem.
Du sport et des traditions
A l’origine, il s’agissait d’un tournoi de football. Sa première édition, en 1995, est issue d’une rivalité avec la communauté voisine d’Agato. Celle-ci organise en effet une manifestation sportive semblable depuis 1961, avec succès. «Ce n’est qu’ensuite, avec l’ajout de concerts et d’autres évènements, que cette fête a intégré une dimension dite “culturelle”. Au passage, elle a changé de nom pour devenir le Pawkar Raymi», explique Jérémie Voirol. Ce qui se traduit par «Fête de la floraison».
Ce nom provient d’une autre langue andine, l’aymara. Ce n’est pas un hasard, au contraire. Il existe aujourd’hui un mouvement de revalorisation des traditions autochtones. Un courant également vivant dans le monde universitaire. L’anthropologue relève une théorie avancée par certains intellectuels équatoriens. Quatre grandes fêtes traditionnelles, aux solstices et équinoxes, auraient rythmé la vie dans le monde pré-hispanique. Le Pawkar Raymi serait l’une d’elles.
De nombreux affluents se rejoignent au sein du festival. Le sport, avec le football, le cyclisme et le basket. Un concours de ñustas (princesses) en costume traditionnel fait partie du programme. Depuis 2004, une soirée traditionnelle (runakay) a été instituée. «Son but consiste à promouvoir la culture indigène auprès des jeunes, note Jérémie Voirol. Les autochtones doivent porter leur costume, tout comme les blanco-métis, dont on attend qu’ils arborent le leur… costard cravate et tenue de soirée.»
Dans ce cadre, une session chamanique publique se déroule sur scène. « L’officiant, le yachak, fait des références à des divinités de la nature. Mais dans la vie quotidienne, personne ne suit ces pratiques. La population est catholique, avec une forte minorité d’évangéliques et de mormons », complète le chercheur.
Economie locale
Ce doux mélange provient également du fait que les organisateurs, élus, changent chaque année. A leur tête se trouve un prioste autochtone, qui donne une teinte particulière à l’édition de l’année en fonction de ses choix. «Chacun cherche à faire mieux que ses prédécesseurs», note Jérémie Voirol. Le comité doit chercher du financement et du soutien, notamment auprès des autorités de Quito. La location de stands de nourriture et de boissons, ainsi que la vente de billets d’entrée, contribuent à l’économie locale. Toutefois, certains tarifs, comme ceux du concert d’Alpha Blondy, sont prohibitifs pour les moins aisés des habitants de la région, qui vivent principalement de l’artisanat (comme le tissage) et de son commerce, voire de l’agriculture (maïs et pomme de terre surtout).
Ce n’est pas tout. Francis Mobio et Jérémie Voirol ont documenté le Mardi-Gras, soit le 9 février 2016. Ce jour-là, en plein pawkar donc, tout le monde a rendez-vous à la chapelle pour la messe. «Le prêtre a un peu récupéré l’évènement en mettant sur pied une eucharistie de la floraison», sourit le scientifique. Ensuite, les participants se rendent à une source, accompagnés d’une fanfare. En chemin, les gens s’envoient des seaux d’eau sur la tête, une facétie de carnaval très vivace dans le pays (et également au sud de la Colombie). Sur place, un chaman, le prioste, ses proches et les ñustas élues auparavant participent à une cérémonie animiste. Le même jour, la cascade de Peguche devient le lieu d’une gigantesque bataille d’eau et de mousse, aussi bon enfant que désorganisée.
Fêtes intimes
A une autre échelle, Jérémie Voirol s’est intéressé aux fêtes indigènes intimes, telles que les baptêmes ou les mariages. Grâce à ses fréquents séjours sur place et à ses connaissances linguistiques, il s’est fait «une place dans le paysage.» De manière générale, «les autochtones sont humbles et timides. Mais ils apprécient qu’un Blanc comme moi s’intéresse à eux. Ils me facilitent même la tâche.»
La San Juan, en été, constitue l’occasion de la tradition de la «prise de coq». Ces animaux sont pendus par la patte sur la place du village. Toute personne qui le souhaite peut en emporter un, et ainsi en recevoir cinq autres tout de suite. «Mais votre geste signifie que l’année suivante, vous devez en rendre le double», explique Jérémie Voirol, qui a joué le jeu dans la localité d’Agato. Bien sûr, la restitution des coqs est une fête en soi. «J’ai loué une fanfare, et au son de la musique, j’ai participé à un défilé pour redonner douze coqs.» Une centaine de personnes ont participé à l’évènement, notamment en apportant de l’eau-de-vie et de la bière. Le chercheur a pris en charge la nourriture et l’accueil des invités sous une tente où l’on a dansé.
Le récent voyage de Francis Mobio et Jérémie Voirol a enfin été l’occasion de tourner des images et de mener des entretiens avec des personnalités locales. «Un film ethnographique, que je pourrais montrer aussi bien ici qu’en Equateur, me permettra de rendre ce que l’on m’a donné. Je ne me voyais pas faire des conférences !» D’ailleurs, grâce aux réseaux sociaux, le chercheur garde le contact avec ses amis et ses connaissances dans la région d’Otavalo.