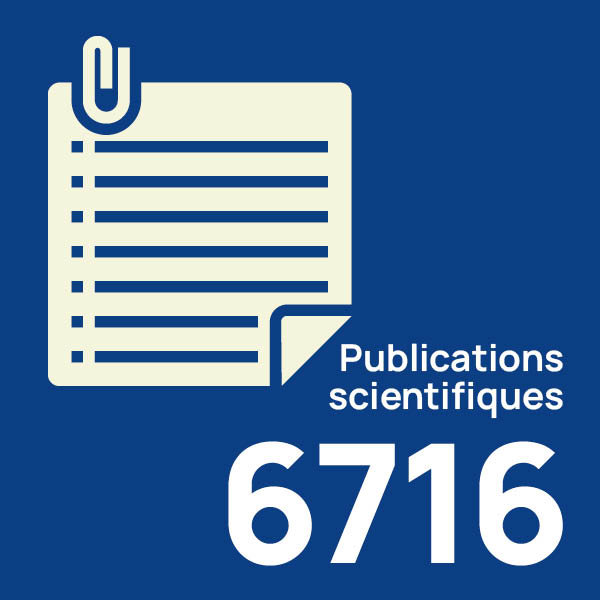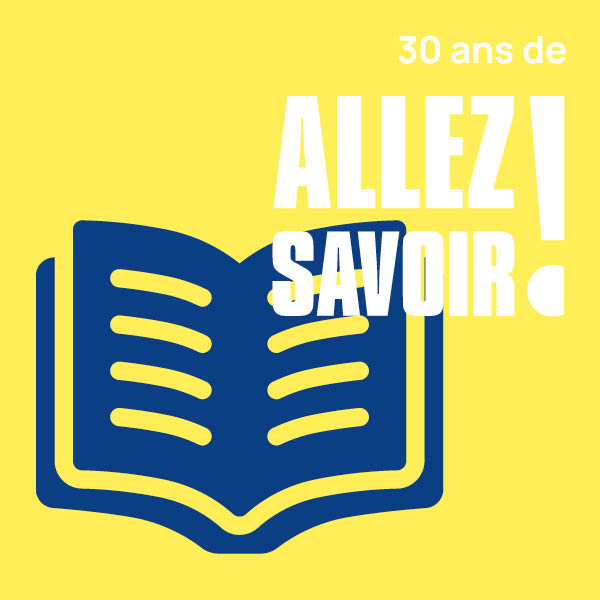TABLE DES MATIÈRES
Chronique
Une année universitaire est intense, mais il nous arrive de n’en retenir que certains éléments. Notre chronique 2024 restitue une part de cette diversité.
Une année avec la direction
Un choix, un seul par dicastère, pour évoquer le travail mené en 2024 par les membres de la Direction et leurs équipes.
Eclairages
Plonger dans les coulisses de l’UNIL à travers quelques exemples marquants.
Vu des facultés
Les facultés dévoilent la diversité et la vitalité de leurs thématiques de recherche et d’enseignement à travers sept exemples.
Portraits
Sept portraits parmi les nominations et promotions de l’année.
En chiffres
Bilan et comptes d’exploitation, ressources humaines, enseignement, recherche et durabilité
Le 5 mai 2025, Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen ont lancé à la Sorbonne l’initiative « Choose Europe for Science » afin de renforcer l’attractivité de l’Europe auprès des chercheuses et chercheurs internationaux. J’avais la chance d’y être, notamment avec des président·es d’université de notre alliance européenne CIVIS et la présidente de swissuniversities. Des mesures concrètes ont été annoncées à cette occasion : des soutiens financiers additionnels, des bourses prolongées à sept ans, un doublement des aides à l’installation, ainsi que la simplification des visas. Une loi européenne sur la liberté scientifique a aussi été proposée, comme c’est d’ailleurs le cas en Suisse. Des valeurs fondamentales ont surtout été défendues. C’est pour moi le plus important, car, dans un contexte international marqué par des tensions géopolitiques et des restrictions croissantes à la liberté académique, il est plus que jamais nécessaire de défendre une recherche fondamentale libre et de qualité. Soutenir la science, c’est défendre la démocratie, le progrès et notre avenir commun. Et nous devons le faire ensemble. Car, comme le disait Louis Pasteur, « la science ne connaît pas de patrie, parce que le savoir appartient à l’humanité, et c’est la torche qui éclaire le monde ».
La recherche portée par les universités est essentielle pour comprendre et affronter les grands défis de notre temps. Ces défis— qu’ils soient climatiques, sociaux, numériques ou sanitaires — sont nombreux, et les universités s’y attèlent avec rigueur, créativité, ouverture et responsabilité. Car c’est bien dans nos laboratoires, à l’écart des logiques politiques ou commerciales immédiates, que germent les connaissances qui nous permettront de répondre aux défis d’aujourd’hui et de demain.
Mettre l’accent sur la santé
Dans cet esprit, la Direction de l’UNIL a structuré sa stratégie autour de grands enjeux sociétaux. À l’occasion de notre Dies academicus du 23 mai 2025, et comme chaque année depuis le début de notre mandat, nous avons choisi de mettre l’accent sur l’un d’entre eux : la santé. Et j’insiste — c’est dans nos universités que l’on travaille d’arrache-pied pour mieux prévenir, diagnostiquer et traiter des maladies telles que le cancer, l’obésité, le diabète ou la maladie de Parkinson. Nous étudions également les modes de vie et les déterminants de la santé et du bien-être, qui jouent un rôle central dans la prévention de nombreuses pathologies. Ces efforts, qui mobilisent presque la moitié de l’activité de recherche menée à l’UNIL, permettent aussi de mieux comprendre l’impact de l’activité physique sur la santé, les mécanismes des maladies psychiatriques, ou encore la manière dont se propagent les maladies infectieuses.
Mais avant chaque innovation qui transforme nos vies, il y a un long chemin, souvent discret, parfois incertain — celui de la recherche fondamentale, avec sa temporalité particulière. C’est elle qui constitue le point de départ indispensable de toute avancée. Laissez-moi vous donner trois exemples concrets de découvertes fondamentales majeures, faites par des chercheuses et chercheurs de l’UNIL, qui ont révolutionné, ou qui vont le faire, notre quotidien. Car oui, tout commence dans un laboratoire, avec de la curiosité, du doute, de la rigueur.
Mon premier exemple est une avancée qui a transformé notre manière de traiter l’obésité : la découverte du GLP-1. Cette hormone, produite dans l’intestin après un repas, joue un rôle clé dans la régulation de la glycémie. C’est dans les années 80 et 90 que la recherche a franchi un cap, avec l’identification de sa structure et surtout du récepteur du GLP-1, grâce à Bernard Thorens, aujourd’hui Professeur honoraire à l’UNIL. Ce fut un tournant majeur : ses travaux ont posé les bases de traitements innovants contre les maladies métaboliques, dont le désormais célèbre médicament Ozempic. Actuellement, Sophie Croizier, Professeure à l’UNIL, travaille sur le développement de certains neurones de l’hypothalamus qui interagissent avec GLP1 et qui contrôlent la prise alimentaire. Ces travaux sont déterminants pour mieux comprendre les mécanismes d’action de cette molécule et comment le cerveau peut devenir un allié dans la lutte contre l’obésité. Toutes ces recherches ont conduit à des traitements révolutionnaires, capables de réduire l’appétit et de favoriser une perte de poids durable — une avancée capitale face à l’un des plus grands défis de santé publique actuels.
Lutte contre le cancer : reprogrammer les macrophages
La deuxième découverte révolutionnaire que je souhaitais mentionner est en oncologie. Elle concerne le rôle crucial des macrophages associés aux tumeurs dans la progression du cancer. Ces cellules immunitaires, que l’on peut diviser en bons macrophages et mauvais macrophages, jouent des rôles opposés dans le développement tumoral. Les mauvais macrophages sont souvent manipulés par la tumeur pour l’aider à se développer et se propager. En 2013, Johanna Joyce, Professeure à l’UNIL, a démontré que l’inhibition d’un récepteur clé chez ces macrophages ne les éliminait pas, mais les reprogrammait pour qu’ils passent de mauvais à bons macrophages, capables d’attaquer directement les cellules cancéreuses. Cette découverte a transformé la façon dont nous comprenons l’interaction entre le système immunitaire et les tumeurs. Elle ouvre la voie à de nouvelles thérapies qui, au lieu de simplement détruire les macrophages, cherchent à les reprogrammer pour qu’ils deviennent de véritables alliés dans la lutte contre le cancer, un tournant décisif dans le traitement de la maladie.
Mon troisième exemple nous emmène aux confins de l’innovation scientifique. L’équipe de Pierre Marquet parvient à générer, à partir de cellules urinaires de patientes et patients atteints de troubles psychiatriques, des neurones humains porteurs de leur vulnérabilité génétique, notamment celle liée à la dépression, la schizophrénie et la maladie bipolaire. Grâce à des techniques de microscopie optique de pointe développées dans leur laboratoire, il est désormais possible de visualiser — en 3D et sur plusieurs semaines — la naissance et la mise en réseau de ces neurones. L’observation de cette dynamique de mise en réseau permet d’identifier des signatures cellulaires spécifiques à ces pathologies, marquant une avancée vers un diagnostic plus précoce et plus fiable. Ces travaux fondamentaux ouvrent la voie à des thérapies plus ciblées et plus efficaces, offrant un réel espoir pour les millions de personnes confrontées à ces troubles.
Cultiver la diversité des idées pour « détruire l’ignorance »
J’aurais pu vous parler d’autres exemples tout aussi fascinants : du rôle de l’intelligence artificielle, de l’économie de la santé, de la sociologie de la santé, de l’interface cerveau-moelle épinière, ou encore des modèles de souris humanisées qui nous permettent de mieux comprendre les maladies humaines. Mais le message que je veux vous transmettre est bien plus simple : lorsque la liberté académique recule, ou que les financements s’assèchent, ce ne sont pas seulement ces recherches essentielles qui s’interrompent — c’est toute la chaîne de l’innovation qui se brise. C’est attaquer le progrès à sa source. Soutenir une recherche indépendante, ambitieuse, ouverte et libre au cœur des universités, là où la diversité des idées et des origines est une force, c’est donner à la société les moyens de prévenir la souffrance évitable, de mieux vivre, de vivre plus longtemps, et de faire face aux défis de demain.
C’est à l’Université que se préparent, chaque jour, les solutions de l’avenir. Continuons à lui donner les moyens d’agir. Continuons à briller et à valoriser le savoir, plutôt que l’ignorance. « Détruire l’ignorance, voilà le grand problème », disait Victor Hugo. Et ce problème, nous avons les moyens de le résoudre — ensemble, et avec ambition.
Présente à l’Anthropole depuis novembre 2024, l’exposition « Docteur Mussolini : un passé sensible » nous rappelle la complexité des processus sociaux et institutionnels. Entre discours officiels et officieux, formels et informels, transparents ou secrets, des choix sont faits, des décisions sont prises et des orientations sont données dans un entrelacs mouvant d’intérêts politiques, économiques, scientifiques et personnels. L’attribution d’un doctorat honoris causa à Benito Mussolini en 1937, les réactions qui, jusqu’à aujourd’hui, se sont élevées contre cette décision ou encore les opinions concernant les suites à donner à cet événement, 40 ans plus tard, témoignent de la diversité des systèmes de valeurs qui structurent la démocratie.
Un équilibre délicat
Le Conseil de l’Université de Lausanne s’inscrit pleinement dans cette complexité démocratique, par sa composition même : tous les corps de toutes les facultés y sont représentés, et chaque représentante et représentant porte en outre son propre système de valeurs, ses modes de fonctionnement, ses représentations sociales et ses préoccupations. Être élu, élue au Conseil de l’UNIL, comme dans toute assemblée représentative, relève ainsi d’un équilibre délicat entre la collégialité nécessaire au bon fonctionnement de la gouvernance de l’institution, la loyauté envers celles et ceux qui, au sein de nos corps et facultés, nous élisent pour les représenter et une fidélité à nos positions personnelles. Ces arguments de chacune et chacun, s’ils ne sont généralement pas inconciliables, n’en demeurent pas moins inévitables et ne vont pas sans générer des tensions. Ils sont au cœur même des systèmes démocratiques tels que nous les connaissons.
Comment dénouer les désaccords ?
En 2024, dans un contexte géopolitique, économique et social en plein chamboulement, notre université a atteint un degré élevé de tensions, reflet de positionnements politiques divergents mais aussi de différences, voire de désaccords profonds, sur la notion d’engagement dans la recherche, l’enseignement et la vie institutionnelle. Le problème n’est toutefois pas l’existence, même marquée, de ces tensions, mais la difficulté à en débattre pour les dénouer, pour parvenir à une explicitation des positionnements de chacune et de chacun, condition préalable à l’émergence éventuelle de consensus.
Si la « politique mémorielle de l’Université a été conçue comme un appel à la vigilance démocratique », comme nous le rappelle encore l’exposition « Docteur Mussolini », il est sans doute temps pour la communauté universitaire de se raccrocher aux valeurs fondamentales de notre institution, telles qu’énoncées dans la Charte de l’Université de Lausanne : savoir critique, autonomie, universalité, engagement citoyen et reconnaissance des personnes. Ces valeurs sont moins urgentes à mobiliser dans les temps heureux. Elles représentent, en revanche, un fanal lorsque les tempêtes se lèvent et risquent de nous pousser vers ces « possibles dérives idéologiques auxquelles toute personne, toute institution – à commencer par l’UNIL elle-même – ou société est exposée », pour reprendre encore les termes de l’exposition.