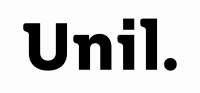Industrie, communication, enseignement, entrepreneuriat ou encore recherche : nombreuses sont les portes ouvertes par des études de biologie, médecine ou sciences infirmières. Découvrez ici les parcours professionnels de diplômé·es de la Faculté de biologie et de médecine (FBM) de l’Unil.
Céline Leyvraz Recrosio, responsable scientifique adjointe dans un laboratoire de biologie de la reproduction
Céline Plancherel, collaboratrice en éducation à l’environnement chez Pro Natura Vaud
Lionel Maumary, biologiste, président du Cercle ornithologique de Lausanne
Patrice Descombes, conservateur en chef du Département de botanique du Naturéum
Plus de parcours
Charlotte Ducotterd, collaboratrice scientifique chez info fauna, spécialiste des tortues
Tiphaine Charmillot, médecin assistante et chercheuse en santé planétaire
Christophe Nakamura, infirmier praticien spécialisé en gériatrie et réadaptation gériatrique
Jessica Lavier, adjointe de la directrice de l’expérimentation animale UNIL-CHUV
Léonie Egli, responsable de recherche à l’Agence mondiale antidopage
Jean-Baptiste Mercoli (Oboni), médecin spécialiste en soins palliatifs
Ruth Debernardi, enseignante à la Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires
Vincent Sonnay, biologiste dans un bureau d’écologie appliquée
Lucien Genoud, étudiant à l’UNIL, cofondateur de Levatura SA
Sandra Sulser, biologiste et entrepreneuse
Corinne Andreutti, spécialiste de médecine de laboratoire
Amalio Telenti, spécialiste du big data médical
Elisabeth Martineu-Jeannin, conseillère en brevets
Annie Mercier Zuber, enseignante de biologie au gymnase
Francesca Amati, professeure associée à la FBM
Davide Staedler, biologiste et entrepreneur
Roxanne Currat, conservatrice de musée
Audrey Megali, biologiste dans un bureau d’études
Étudier à l’UNIL : en savoir plus
Perspectives professionnelles après l’Unil : en savoir plus

Céline Leyvraz Recrosio
Responsable scientifique adjointe chez Fertas (laboratoire de biologie de la reproduction)
La science, une évidence pour vous ?
Enfant, j’adorais découvrir les champignons avec mes parents ou les plantes avec ma grand-maman. En terminant l’école, je n’avais pas de projet précis, mais le monde scientifique m’appelait, j’y revenais toujours. Devoir être très organisée, consciencieuse, c’était quelque chose qui me correspondait. J’ai imaginé devenir laborantine, assistante en pharmacie ou droguiste, mais ne me projetais pas dans un apprentissage. J’ai donc fait le gymnase en scientifique, puis réussi l’examen pour entrer à l’école de technicienne en analyses biomédicales, tout en m’inscrivant en biologie à l’Unil. Les gens qui connaissaient cet univers me disaient : « Mais vas-y, t’as les notes ! » Alors je me suis lancée.
Quel souvenir gardez-vous de vos études à l’Unil ?
J’ai adoré le milieu universitaire, en ébullition constante. Tout s’est enchaîné jusqu’au doctorat, alors que je n’avais jamais envisagé une carrière académique. C’est arrivé parce que je me sentais bien, que j’ai rencontré des personnes passionnées et inspirantes et que j’ai eu de la chance.
Comment êtes-vous arrivée à votre poste actuel ?
Durant ma thèse, je me suis intéressée à l’effet de gènes sur la physiologie de la peau. J’ai ensuite ressenti le besoin de m’orienter vers des projets plus appliqués. Trois ans de postdoctorat au CHUV, sur l’obésité, ont amorcé mon passage vers le monde médical. Puis j’ai travaillé pendant plus de dix ans dans le Laboratoire de biologie de la reproduction du CHUV avant d’arriver, en 2022, à mon poste actuel.
En quoi consiste votre travail ?
Dans notre labo, nous prenons en charge les gamètes (ovocytes et spermatozoïdes) une fois prélevés chez les patientes et patients, recréons les conditions nécessaires à leur rencontre, avant de cultiver les embryons pour le transfert. Concrètement, nous sélectionnons et préparons les spermatozoïdes, mettons en culture les ovocytes, puis procédons à la fécondation in vitro classique ou avec ICSI1. Nous suivons l’évolution des embryons dans l’incubateur et choisissons celui avec le meilleur potentiel de développement pour l’implantation dans l’utérus de la femme. Nous pouvons aussi congeler gamètes et embryons pour une utilisation ultérieure ou prélever des cellules pour un diagnostic préimplantatoire2.
Ce qui vous plaît dans votre activité ?
C’est le meilleur job du monde ! Les personnes qui viennent nous voir nous confient quelque chose de très intime. Il y a peu de domaines en biologie où l’on est autant impliqué dans la relation de soins.
1Fécondation in vitro (FIV) – Classique et avec ICSI : Techniques médicales où la fécondation (fusion entre le spermatozoïde et l’ovule) se déroule à l’extérieur du corps de la femme, en laboratoire, avant que l’embryon ne soit implanté dans l’utérus. Dans une FIV classique, plusieurs dizaines de milliers de spermatozoïdes sont mis en contact avec l’ovocyte dans une boîte de culture, et la fécondation se fait spontanément, comme dans le corps. Dans la variante avec ICSI (injection intracytoplasmique de spermatozoïde), un seul spermatozoïde est sélectionné, principalement pour sa morphologie et sa motilité, puis injecté directement dans l’ovocyte avec une micropipette.
2Diagnostic préimplantatoire : Examen génétique réalisé sur un embryon avant son transfert dans l’utérus, dans le but de détecter la présence d’une anomalie chromosomique ou d’une grave maladie génétique héréditaire.
Interview publiée dans Échos du vivant n°19 | Automne 2025
Texte: Mélanie Affentranger | Photo: Felix Imhof

Céline Plancherel
Collaboratrice en éducation à l’environnement chez Pro Natura Vaud
Je travaille en particulier sur un projet d’éducation à l’environnement dans la réserve naturelle des Grangettes, située à côté de Villeneuve. Je suis en charge de créer le programme, de le coordonner et d’animer certains ateliers. J’ai beaucoup de liberté et peux souvent laisser place à ma créativité pour mettre en valeur cette magnifique réserve! J’organise également des événements pour faire connaître notre association, par exemple à Polymanga cette année. D’autres petits projets stimulants de sensibilisation occupent le reste de mon temps (collaboration pour une exposition ou projet de jeu vidéo pédagogique).
Formation
- 2016: Bachelor en biologie et ethnologie, Université de Neuchâtel
- 2018: Master en comportement, évolution et conservation, Université de Lausanne
- 2023: Master en études muséales, Université de Neuchâtel
En savoir plus sur les activités de Céline Plancherel
- Profil LinkedIn
- Réserve des Grangettes
- «On fait quoi ce week-end? – ProNatura Vaud» (émission Six heures – Neuf heures, le samedi, RTS, 7 décembre 2024)
Interview publiée dans Échos du vivant n°18 | Printemps 2025
Photo: Didier Dorsaz

Lionel Maumary
Biologiste, président du Cercle ornithologique de Lausanne
Je suis employé à 40% chez Ecoscan, un bureau d’études en environnement, et travaille comme biologiste indépendant. Je collabore ainsi avec la Station ornithologique suisse, BirdLife, Pro Natura et la Société romande pour l’étude et la protection des oiseaux, notamment. Je guide des excursions ornithologiques en Suisse et à l’étranger, donne des cours et ai écrit le livre Les oiseaux de Suisse. En tant que président du Cercle ornithologique de Lausanne depuis 1990, je suis l’instigateur de l’île aux oiseaux, à Préverenges, et de la station de baguage des oiseaux migrateurs et des chauves-souris au col de Jaman.
Formation
- 1994: Diplôme de biologie, Université de Lausanne
En savoir plus sur les activités de Lionel Maumary
- oiseaux.ch
- birdline.ch
- Cercle ornithologique de Lausanne
- «Des palpitements dʹailes au retour du printemps» (émission Côté jardin, RTS, 9 mars 2025)
- «Entretien avec Lionel Maumary, président du Centre ornithologique de Lausanne» (émission Couleurs locales, RTS, 7 avril 2023)
- «Lionel Maumary – Lʹîle aux oiseaux» (émission Chouette!, RTS, 19 juillet 2021)
Interview publiée dans Échos du vivant n°18 | Printemps 2025
Photo: Marino Trotta

Patrice Descombes
Conservateur en chef du Département de botanique du Naturéum
Je dirige le Département de botanique au sein du Naturéum, où je pilote sa stratégie, sa gestion opérationnelle et ses ressources. Mon travail est passionnant et varié. Il englobe la conservation, la numérisation et la valorisation scientifique des herbiers, le développement et l’enrichissement des collections vivantes dans nos jardins botaniques, la recherche scientifique associée à ces collections et la diffusion des connaissances au travers de la médiation et du développement d’expositions. Je m’attache également à promouvoir nos jardins comme des lieux incontournables de recherche et de conservation.
Formation
- 2011: Bachelor en biologie, Université de Lausanne
- 2013: Master en comportement, évolution et conservation, Université de Lausanne
- 2018: Doctorat en écologie, École polytechnique fédérale de Zurich
En savoir plus sur les activités de Patrice Descombes
- Profil LinkedIn
- Département de botanique du Naturéum
- «La botanique des ronces, un sujet nettement plus touffu quʹil nʹy paraît» (émission CQFD, RTS, 13 janvier 2025)
- «Plongée dans les trésors de l’herbier cantonal vaudois» (article dans Terre & Nature, 7 mars 2024)
Interview publiée dans Échos du vivant n°18 | Printemps 2025
Photo: Roman Devuyst

Charlotte Ducotterd
Collaboratrice scientifique chez info fauna, spécialiste des tortues
Je suis responsable du Département espèces exotiques animales chez info fauna, le centre national de données et d’informations sur la faune. Mon rôle est de surveiller l’apparition de nouvelles espèces exotiques en Suisse et ainsi réaliser des listes d’espèces exotiques et/ou invasives, développer les flux de données, conseiller les cantons dans la lutte et produire des fiches pour l’information du public. Je suis aussi biologiste indépendante, je réalise des missions de terrain comme le suivi des populations réintroduites de cistudes d’Europe, l’unique tortue indigène de Suisse, et des captures de tortues exotiques.
Formation
- 2011: Bachelor en biologie, Université de Neuchâtel
- 2015: Master en parasitologie et écoéthologie, Université de Neuchâtel
- 2020: Doctorat en zoologie (titre: Ecology of the European pond turtle in Switzerland), Université de Lausanne
En savoir plus sur les activités de Charlotte Ducotterd
- Profil LinkedIn
- Profil ResearchGate
- info fauna
- «Charlotte Ducotterd – Cistude» (émission Chouette!, RTS, 15 août 2022)
- «Comment sauver l’unique tortue suisse?» (article dans Allez savoir!, 20 mai 2021)
Interview publiée dans Échos du vivant n°18 | Printemps 2025
Photo: Olivier Le Duc

Tiphaine Charmillot
Médecin assistante à l’Hôpital de Bienne et chercheuse en santé planétaire
La médecine, un rêve d’enfant ?
J’ai su ce que je voulais faire vers l’âge de 14 ans, le corps humain me fascinait. Après le lycée, j’ai ainsi quitté Saignelégier pour mes études à Lausanne. Le côté social, c’est un peu une histoire de famille : ma maman est infirmière, mon papa est diacre, mes trois sœurs et moi travaillons toutes « pour les autres ».
Les questions de durabilité vous accompagnent depuis longtemps.
En bachelor, j’ai participé à un échange avec l’Association suisse des étudiant·es en médecine. La délégation taïwanaise y a présenté un projet sur les tortues de mer, en tissant des liens avec les microplastiques, l’impact de la vie humaine sur la nature et inversement. Cela semblait farfelu, mais ça a été le déclic ! J’ai alors compris qu’il existait une relation très forte entre santé et environnement. Pour mon mémoire de master, j’ai effectué une analyse de cycle de vie des gobelets à médicaments à usage unique en plastique utilisés au CHUV, dans l’idée de voir si une alternative en carton était possible. Au début, je m’étais dit : « Plus jamais de recherche ! C’est beaucoup trop technique, trop loin des patient·es, trop solitaire. » Et pourtant… (rires). J’ai eu envie de creuser davantage. Une manière aussi de prolonger ma vie d’étudiante, qui me plaisait beaucoup.
Vous avez consacré votre doctorat en médecine aux rejets de médicaments dans le Léman…
En pratique, j’ai croisé trois types d’informations : 1) qu’est-ce qui, via les eaux usées, se retrouve dans le lac et les rivières vaudoises ? 2) quels sont les médicaments les plus prescrits en médecine de famille ? et 3) quels traitements sont connus pour être nocifs pour les écosystèmes aquatiques ? J’ai ainsi créé une classification du potentiel écotoxique des médicaments sur les eaux pour comprendre si certaines molécules sont plus recommandables que d’autres.
Vous imaginez-vous poursuivre dans cette direction ?
Aujourd’hui, je suis médecin assistante en médecine interne à Bienne, mais je garde un pied dans la recherche : je vais travailler à Unisanté sur un projet visant à mieux comprendre le lien entre santé, changement climatique et urbanisme. J’aimerais me spécialiser en médecine de famille et j’envisage d’ouvrir un cabinet de groupe à la campagne avec des amies physiothérapeutes et psychologues. Tout en poursuivant ma recherche clinique en santé planétaire.
Médicaments & environnement : en savoir plus
- Vidéo « Odyssée du médicament »
- Groupe de recherche de Nathalie Chèvre
- Commission internationale pour la protection des eaux du Léman (cipel)
Interview publiée dans Échos du vivant n°17 | Automne 2024
Texte: Mélanie Affentranger | Photo: Felix Imhof

Christophe Nakamura
Infirmier praticien spécialisé au Service de gériatrie et réadaptation gériatrique du CHUV
Quel est votre parcours, en bref ?
Mes premières amours étaient la pâtisserie et le chocolat ! Puis j’ai fait un détour par la médiamatique avant de finalement bifurquer vers la santé. J’ai ainsi quitté mon Jura natal pour étudier à La Source, à Lausanne. L’appel de la ville ! Mon bachelor en poche, j’ai intégré le Service de gériatrie et réadaptation gériatrique du CHUV. D’abord pour m’occuper de personnes âgées en attente d’une place dans un établissement médico-social, puis d’autres nécessitant des soins de réadaptation.
Vous êtes titulaire de deux masters en soins de l’UNIL
En parallèle de mon travail, j’ai réalisé un Master en sciences infirmières. Cette formation m’a notamment permis de mener des projets d’amélioration de la qualité des soins et d’accompagner les équipes soignantes dans des changements de pratiques cliniques. En 2018, un nouveau master, en pratique infirmière spécialisée, a été lancé. J’avais alors envie d’acquérir des connaissances cliniques spécifiques à mon domaine. Aller plus loin pour mieux suivre, aider et soigner mes patient·e·s.
Que faites-vous aujourd’hui ?
Je travaille au Centre de gériatrie ambulatoire et communautaire du CHUV, une équipe interdisciplinaire qui suit des personnes rencontrant des problèmes liés à l’âge, par exemple de mobilité, de dénutrition, de troubles cognitifs ou d’isolement social. L’essentiel de mon activité se déroule hors de l’hôpital, sur les lieux de vie des patient·e·s. En tant qu’infirmier praticien spécialisé, j’assure une prise en charge globale dans des situations complexes et bénéficie d’une grande autonomie : je peux prescrire des médicaments ou des examens, interpréter des tests et réaliser certains actes médicaux dans ma spécialité.
Ce qui vous plaît dans votre travail ?
Les patient·e·s. Plus on vieillit, plus on a d’expérience, plus on affirme qui on est. Chacun·e est unique, même lorsque les problèmes de santé sont les mêmes. J’aime créer des contacts humains avec des personnes parfois très isolées ou qui ont de la difficulté à faire confiance. J’affectionne aussi le travail en équipe. Mais ce qui me plaît surtout, c’est que même si je suis parfois confronté à des réalités difficiles, j’apprends tous les jours quelque chose de nouveau.
Interview publiée dans Échos du vivant n°16 | Printemps 2024
Texte: Mélanie Affentranger | Photo: Felix Imhof

Jessica Lavier
Adjointe de la directrice de l’expérimentation animale UNIL-CHUV
Enfant, vous vous imaginiez où ?
Je n’avais pas d’idée toute faite, mais j’étais attirée par les sciences ! Binationale, j’ai passé mon bac dans le sud de la France avant de rejoindre Lausanne pour des études de médecine. J’ai vite réalisé que ce n’était absolument pas pour moi. Je m’intéressais surtout à la recherche, j’ai donc naturellement bifurqué vers la biologie.
Le doctorat, hasard ou volonté ?
Me lancer dans une thèse était une évidence, le domaine moins. J’avais pour idée de travailler sur les maladies respiratoires mais, au fil des réflexions, mon choix s’est porté sur une thématique sport-santé, qui me correspond davantage (Jessica Lavier est ceinture noire de karaté, 3e dan, ndlr). En analysant l’activité physique chez la souris, j’ai pu démontrer que les exercices à très haute intensité, en particulier en altitude, sont tout aussi bénéfiques pour nos vaisseaux sanguins que les exercices d’endurance.
Quel est votre quotidien aujourd’hui ?
J’accompagne et je soutiens les membres de la Faculté de biologie et de médecine dans toutes les démarches liées à l’expérimentation animale. Pour chaque projet, le ou la chercheur·euse doit renseigner très précisément une quarantaine de points, notamment le type et le nombre d’animaux nécessaires, le degré de sévérité, les procédures expérimentales et le but des travaux. Je veille à ce que les demandes d’autorisation d’expériences soient réalisées dans le respect de la loi et de l’éthique, puis je m’occupe de les soumettre et d’assurer le lien avec les autorités cantonales en charge d’évaluer les requêtes. En parallèle de ce poste à 50%, j’ai travaillé comme animatrice scientifique dans des écoles. Depuis mai 2023, je suis aussi chargée de missions pédagogiques et administratives à l’École de biologie de l’UNIL.
Quel conseil donneriez-vous à un·e futur·e étudiant·e ?
La première année ne détermine pas toute la suite du parcours. Elle permet plutôt de comprendre le système et les possibilités qui s’offrent à soi. En d’autres termes, rater une année n’est pas un échec. Au contraire, à mes yeux, la première année est une façon de savoir ce que l’on ne veut pas et laisse l’opportunité de tester, d’explorer et de mieux comprendre ce qui nous fait plaisir et nous convient.
Interview publiée dans Échos du vivant n°15 | Printemps 2023
Texte: Mélanie Affentranger | Photo: Nicole Chuard

Léonie Egli
Responsable de recherche à l’Agence mondiale antidopage
La biologie, une voie toute tracée ?
Au gymnase, j’adorais les langues et les sciences. Au moment de m’inscrire à l’UNIL, je me suis lancée en biologie. Mon bachelor en poche, je me posais toujours la grande question : « Et après ? » Pour comprendre à quoi cette voie ressemblait en pratique, j’ai réalisé un stage au Laboratoire suisse d’analyse du dopage. Rassurée dans mes choix, j’ai entamé un Master en biologie médicale puis enchaîné avec un doctorat en physiologie humaine, toujours à l’UNIL. Je me suis demandé de quelle manière l’exercice physique pouvait prévenir les effets néfastes du fructose.
En quoi vos études vous ont-elles préparée au monde professionnel ?
Elles m’ont bien sûr permis d’acquérir des connaissances scientifiques, mais pas seulement. Durant mon doctorat, j’ai appris à m’organiser et à travailler avec des personnes d’horizons divers : médecins, technicien·ne·s de laboratoire, personnel infirmier et volontaires de nos études. Cela m’a été utile pour la suite de mon parcours, au cours duquel j’ai collaboré avec des équipes multiculturelles et multidisciplinaires.
Après l’UNIL, l’industrie…
J’ai d’abord travaillé au Centre de recherche de Nestlé dans les hauts de Lausanne. Je m’occupais d’évaluer les effets de la reformulation de produits, par exemple la réduction de la teneur en sucre, sur la santé cardio-métabolique. J’ai ensuite vécu deux ans à Singapour afin d’aider au développement d’un centre de recherche sur place.
Que faites-vous actuellement ?
J’ai intégré le bureau lausannois de l’Agence mondiale antidopage (AMA) en 2019 pour gérer un projet spécifique : la mise au point de tests antidopage à partir de gouttes de sang séchées. Ce type de dépistage est peu intrusif pour les athlètes et facilite le transport et la conservation des échantillons. Il est désormais utilisé en complément aux prélèvements conventionnels de sang et d’urine. En tant que chargée de projet, j’assure la coordination avec les partenaires (organisations nationales antidopage et laboratoires d’analyses, entre autres) pour développer la méthode et adapter les règles antidopage. Depuis l’été 2022, je contribue aussi à coordonner l’évaluation des projets de recherche scientifique subventionnés par l’AMA.
Interview publiée dans Échos du vivant n°14 | Automne 2022
Texte: Mélanie Affentranger | Photo: Felix Imhof
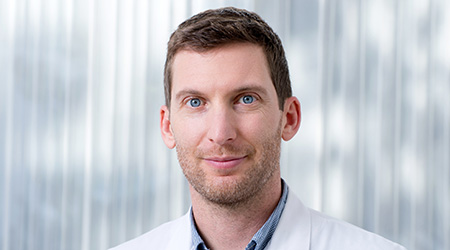
Jean-Baptiste Mercoli (Oboni)
Médecin spécialiste en soins palliatifs au CHUV
En quoi consiste votre travail ?
Notre mission est d’améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de maladies incurables, et ce pas seulement dans la dernière phase de vie. Le suivi des proches fait aussi partie intégrante de notre travail. En tant que coresponsable de l’équipe mobile de soins palliatifs du CHUV, je me rends au chevet de patient·e·s hors de l’hôpital, par exemple dans des cliniques privées ou sur leur lieu de vie, que ce soit à domicile ou en EMS. Parallèlement à ces activités cliniques, je forme de jeunes médecins, ainsi que des étudiant·e·s en médecine et en soins infirmiers. Je participe aussi à la gestion globale du Service de soins palliatifs du CHUV, avec mes autres collègues cadres.
Votre parcours est atypique : études complètes de biologie, puis de médecine. Jusqu’au doctorat…
Je me suis d’abord orienté vers la biologie de la conservation. Après mon Bachelor à l’UNIL, j’ai travaillé en Australie avec des abeilles et au Canada avec des poissons. De retour à Lausanne, j’ai réalisé un Master en biologie médicale et participé à des travaux visant à comprendre les effets du fructose sur l’organisme. Le contact avec les volontaires de cette étude m’ayant particulièrement plu, je me suis lancé dans la médecine.
Ce qui vous plaît dans votre métier ?
Durant ma spécialisation en médecine interne au CHUV, j’ai passé quelques mois au Service de soins palliatifs. La révélation ! C’était tout ce que j’attendais de la médecine : une approche très humaniste, avec du temps à consacrer aux patient·e·s, aux proches. Nous les accompagnons dans des moments de vie très particuliers, forts en émotions. Je m’étonne souvent de constater à quel point ces personnes sont reconnaissantes et altruistes, malgré ce qu’elles sont en train de traverser. Elles m’inspirent énormément.
Un conseil à quelqu’un que votre parcours séduirait ?
N’ayez pas peur de faire de longues études, ce sont des années magnifiques. Gardez toutes les portes ouvertes jusqu’à trouver votre voie. Il faut parfois du temps, mais rien n’est jamais perdu ! Il est aussi important de se créer des opportunités, et de les saisir.
Interview publiée dans Échos du vivant n°13 | Printemps 2022
Texte: Mélanie Affentranger | Photo: Felix Imhof

Ruth Debernardi
Enseignante à la Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires
Quel est votre parcours, en bref ?
À l’origine, c’est le cerveau qui m’intéressait. Au gymnase, ma motivation était de comprendre comment nous, les êtres humains, fonctionnons. Je me suis donc lancée dans des études de biologie à l’UNIL. Après avoir obtenu mon diplôme, j’ai enchaîné avec un doctorat : un travail de recherche de plusieurs années en neurosciences. J’ai ensuite ressenti le besoin de me réorienter vers quelque chose de plus large et, en 2004, j’ai obtenu un poste de professeure à la Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires, au sein de la HES bernoise.
Les thèmes du goût et de l’odorat figurent au cœur de vos cours…
Oui, j’enseigne les bases de la biologie, avec un intérêt particulier pour la santé et la nutrition, notamment la qualité des aliments : de la production jusqu’à l’assiette. J’organise des cours liés au vin et ai mis sur pied des modules sur les plantes sauvages comestibles et les champignons. Nous avons même publié un livre en français, allemand et italien qui propose des recettes de desserts sucrés aux champignons créées par mes étudiantes et étudiants ! En parallèle, je mène aussi de petits projets de recherche et collabore avec l’Union suisse des producteurs de champignons. Nous avons, par exemple, développé des champignons de Paris enrichis en vitamine D, mis sur le marché en 2018.
D’où vient cet attrait pour les odeurs et les saveurs ?
J’ai grandi dans une ferme du Gros-de-Vaud, entourée d’un panel d’odeurs extrêmement variées. Mes parents possédaient du bétail, un jardin et un verger immenses. J’essaie aujourd’hui d’exploiter ce « patrimoine odorant », hérité de mon enfance, dans les cours que je donne.
Ce qui vous plaît dans votre métier ?
Personne dans ma famille n’a fait d’études universitaires ; j’ai découvert le monde académique par moi-même. J’aime aujourd’hui pouvoir partager avec mes élèves ce que j’ai acquis « au prix fort ». J’ai toujours apprécié enseigner et, cerise sur le gâteau, une partie de mon temps est consacrée à des cours que j’ai créés sur la base de mes passions : les plantes et les champignons sauvages comestibles. Une chance inouïe !
Interview publiée dans Échos du vivant n°12 | Automne 2021
Texte: Mélanie Affentranger | Photo: Felix Imhof

Vincent Sonnay
Biologiste dans un bureau d’écologie appliquée et ancien président de la Société vaudoise des sciences naturelles
Quel est votre travail au quotidien ?
Je travaille sur des projets de gestion des milieux naturels et de la biodiversité au sein du bureau d’écologie appliquée n+p. Lorsqu’un mandat nous est confié, nous commençons généralement par évaluer les valeurs naturelles, par exemple en répertoriant les espèces végétales et animales présentes. Ce travail de terrain représente environ 15% de mes activités. Le reste se passe au bureau : je traite et analyse les données dans le but de formuler des recommandations concernant la manière de gérer les espaces pour préserver et développer la biodiversité.
Ce qui vous plaît dans ce métier ?
Les projets dont je m’occupe, et mes interlocuteurs, sont très variés. Je travaille par exemple avec des militaires pour coordonner un programme de gestion de la biodiversité sur des places d’armes. Ou avec la Ville de Lausanne sur le tracé d’une nouvelle ligne de tram. La plus grande satisfaction est évidemment d’observer des améliorations concrètes obtenues suite à mes conseils.
Comment êtes-vous arrivé à ce poste ?
J’ai terminé mon Master en comportement, évolution et conservation à l’UNIL début 2012. Mon travail de mémoire a été codirigé par mon patron actuel, Jérôme Pellet. À l’époque, il était employé dans un autre bureau d’études en environnement. J’ai pu le rejoindre pour un stage, puis j’ai été engagé. En 2015, Jérôme a créé sa propre entreprise et je l’ai suivi. Parallèlement, je me suis toujours investi dans le domaine de l’écologie. J’ai participé à des activités de Pro Natura liées à la conservation des amphibiens et j’ai été président de la Société vaudoise des sciences naturelles durant six ans, jusqu’en mars 2020. Ces expériences m’ont permis d’approfondir mes compétences naturalistes et de développer mon réseau dans le milieu de l’environnement en Suisse romande. Ce qui facilite évidemment les choses.
Que vous ont apporté vos études ?
L’apprentissage de la démarche scientifique, et la rigueur qui va avec. Je me tiens informé des dernières avancées de la recherche pour être le plus pertinent possible dans les solutions que je propose à mes clients.
Interview publiée dans Échos du vivant n°11 | Automne 2020
Texte: Mélanie Affentranger | Photo: Felix Imhof

Lucien Genoud
Étudiant à l’UNIL, cofondateur de Levatura SA
L’idée de votre entreprise est née durant le Bachelor en biologie…
C’était en 2017, pendant le cours de troisième année «Être entrepreneur en biologie». La partie pratique consistait à développer un projet de start-up. À l’époque, des brasseurs nous disaient devoir se cantonner à quatre ou cinq souches de levure sèche pour fabriquer leurs bières. Et impossible de s’approvisionner en levures liquides suisses. Avec quatre amis, dont Hugues de Villiers de la Noue, l’actuel coprésident, nous avons imaginé produire des levures fraîches sur mesure. Levatura était née. L’entreprise a été baptisée en référence à une herbe utilisée au Moyen Âge pour ensemencer le moût et faire fermenter la bière.
Au printemps 2019, c’est l’inauguration de vos locaux à Épendes, dans le Nord vaudois
Nous sommes le seul producteur suisse de levures de bière. Dans la majorité des cas, nous commandons les souches auprès de fabricants, tous à l’étranger, puis les faisons proliférer dans notre laboratoire pour fabriquer de la levure fraîche que nous vendons sous forme liquide. Jusqu’ici, nous en avons distribué plus de 5000 litres à 40 brasseries romandes. Sur demande, nous créons aussi des souches. À l’abbaye de Saint-Maurice, nous avons par exemple capturé une levure sur un parchemin de 1319 ! Elle sert aujourd’hui à brasser la bière blanche de l’abbaye.
Ce qui vous plaît dans votre travail ?
Hugues s’occupe de la production, moi de la comptabilité et des relations clients. J’ai toujours eu la fibre entrepreneuriale et Levatura réunit deux mondes entre lesquels je navigue depuis longtemps: l’économie et la biologie.
Comment conjuguez-vous cette activité avec vos études ?
Nous avons terminé notre bachelor à l’été 2018, puis nous nous sommes consacrés à 100% à l’entreprise durant un an. En septembre 2019, Hugues s’est lancé dans un Master en sciences moléculaires du vivant et j’ai entamé un raccordement pour accéder au Master en management de la Faculté des hautes études commerciales de l’UNIL. Chacun continue d’assumer ses tâches au sein de Levatura. Mais nous avons engagé une personne pour nous soutenir, en particulier dans la production.
Interview publiée dans Échos du vivant n°10 | Automne 2019
Texte: Mélanie Affentranger | Photo: Felix Imhof

Sandra Sulser
Biologiste et entrepreneuse
Les moments clés de votre parcours ?
J’ai fait mes études de biologie à l’École polytechnique fédérale de Zurich, puis une thèse en microbiologie fondamentale à la Faculté de biologie et de médecine de l’UNIL. Je me suis notamment penchée sur la manière dont certaines bactéries effectuent des donations de gènes à leurs congénères, les rendant ainsi résistantes aux antibiotiques. Parallèlement, j’ai cofondé l’association Innovation Forum Lausanne, permettant aux jeunes chercheurs et créateurs de start-up d’interagir avec des investisseurs, des entrepreneurs et des décideurs politiques.
Aujourd’hui, en quoi consiste votre travail ?
Depuis 2017, je travaille pour Seerave. Cette fondation soutient des projets dans plusieurs domaines (nutrition, microbiome et flore intestinale, immunité) dont le but est d’améliorer la prise en charge des malades du cancer, en complément des traitements existants. En tant que chargée de projet, j’identifie les recherches que nous souhaitons parrainer à travers le monde et en assure le suivi.
Ce qui vous plaît dans votre métier ?
La polyvalence et la flexibilité. Nous formons une toute petite équipe de quatre personnes, il faut donc savoir être touche-à-tout. Je ne fais plus de recherche à proprement parler mais j’ai une meilleure vue d’ensemble et cela me plaît. Nous soutenons des projets dans le monde entier, ce qui me permet de voyager et de rencontrer des chercheurs internationaux. C’est un environnement très nourrissant, tant du point de vue scientifique qu’humain.
Le doctorat, une évidence ?
Pas du tout. J’ai toujours voulu comprendre comment fonctionnent les êtres vivants et me suis lancée dans des études de biologie parce qu’elles me laissaient d’innombrables portes ouvertes. J’étais heureuse d’avoir quelques années pour investiguer ces opportunités. Ce n’est que pendant le master que j’ai eu envie d’approfondir mes connaissances et de débuter une thèse. J’ai toujours procédé par étapes, c’est aussi ce que je conseillais à mes étudiants lorsque j’étais assistante à l’UNIL. Ne pas savoir trop précisément où l’on souhaite aller est une force, et non une faiblesse, selon moi.
Interview publiée dans Échos du vivant n°9 | Printemps 2019
Texte: Mélanie Affentranger | Photo: Felix Imhof

Corinne Andreutti
Spécialiste de médecine de laboratoire
En quoi consiste votre travail ?
A la clinique de La Source, à Lausanne, je mets en place et je valide les techniques nécessaires à l’identification des bactéries présentes dans les échantillons biologiques (urine, sang, biopsies etc.) ; je détecte d’éventuelles résistances de ces microbes aux antibiotiques. Ces analyses de microbiologie permettent de diagnostiquer les maladies infectieuses dont souffrent les patients et de traiter ceux-ci avec les bons antibiotiques.
Comment êtes-vous venue à ce métier ?
A l’Université, j’avais de nombreux contacts avec le laboratoire de diagnostic parasitaire. Ses chercheurs m’ont appris qu’il existait au CHUV une formation FAMH (dispensée par l’Association des laboratoires médicaux de Suisse) en microbiologie. Avant de la suivre, j’ai fait une thèse à l’ISREC (Institut suisse de recherche expérimentale sur le cancer).
Malgré votre thèse, vous n’aviez donc pas envie de faire de la recherche ?
Non, je n’ai jamais renoncé à l’idée de faire du diagnostic pour lequel j’avais eu un coup de cœur pendant mes études de biologie. D’ailleurs, le sujet de ma thèse était déjà orienté vers ce thème ; c’est cela qui m’avait passionné. Je travaille à l’interface entre la médecine et le laboratoire. J’ai besoin de me sentir utile, de voir directement à quoi va servir mon travail.
Que diriez-vous à quelqu’un que votre métier intéresserait ?
Qu’il faut aimer la médecine et la biologie et qu’il faut bien choisir sa formation FAMH, car il en existe dans plusieurs spécialités (chimie, microbiologie, hématologie, immunologie, génétique). Notre métier est très varié – en arrivant le matin nous ne savons pas ce qui nous attend. Nous participons à des congrès, nous sommes en contact avec des médecins, nous contribuons à la formation des technicien(ne)s etc. C’est passionnant.
Interview publiée dans Échos du vivant n°8 | Printemps 2018
Texte: Elisabeth Gordon | Photo: Stéphane Dussex, Studio Bôregard
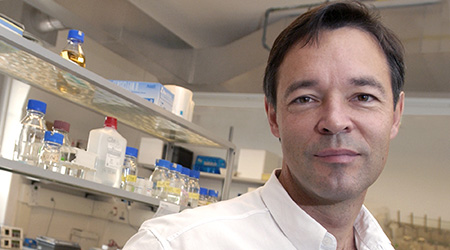
Amalio Telenti
Spécialiste du big data médical
En quoi consiste votre travail ?
Je suis directeur scientifique de Human Longevity* à San Diego, en Californie. Cette entreprise teste, évalue et développe des technologies et de larges ensembles de données, le big data, qui sont susceptibles de révolutionner la médecine et de conduire au développement d’une médecine numérique. Moi qui suis médecin, je dirige une équipe d’ingénieurs, d’informaticiens, de statisticiens, de mathématiciens etc.
Comment un professeur de virologie à l’UNIL est-il devenu spécialiste de big data ?
Notre génome renferme des séquences de génomes de virus et l’étude de cette coexistence m’avait donné une certaine expertise dans le domaine de l’analyse détaillée de données complexes, ce que je fais aujourd’hui à une échelle beaucoup plus large. Par ailleurs, en tant que médecin, j’ai pu voir que nous ne répondions pas tous de la même manière à une maladie donnée. Cela m’a donné envie d’identifier, dans les génomes humains, les petites différences qui pouvaient expliquer cette inégalité.
Qu’est-ce qui vous a conduit à vous orienter vers les technologies ?
Je cherchais à changer de profession, car cela confère de nouvelles compétences. Même une entreprise qui travaille dans les technologies a besoin de quelqu’un qui connaît la biologie et la médecine. C’est un mariage nécessaire. Les ingénieurs et les mathématiciens se familiarisent avec la médecine, et moi avec l’analyse des données à haut débit.
Que diriez-vous à quelqu’un qui souhaiterait suivre votre parcours ?
Il suffit de regarder autour de soi : nous sommes en interaction constante avec de grandes quantités de données via Google, Facebook etc. Aucune profession n’échappera à ce phénomène et l’avenir est à ceux, notamment les médecins, qui sauront faire converger leur spécialité avec les technologies numériques.
* A l’heure où nous mettons sous presse, nous apprenons qu’Amalio Telenti quitte Human Longevity pour travailler au Scripps Research Institute, où il s’occupera toujours de big data.
Interview publiée dans Échos du vivant n°7 | Automne 2017
Texte: Elisabeth Gordon | Photo: Silvano Prada

Elisabeth Martineu-Jeannin
Conseil en brevets
En quoi consiste votre travail ?
Je travaille pour une société de services en propriété intellectuelle, KATZAROV SA à Genève. Je m’occupe des demandes de brevets pour des inventions dans les domaines pharmaceutique, biotechnologique et chimique. Nos clients sont de grandes entreprises, des start-ups et des institutions de recherche.
Comment êtes-vous arrivée à ce poste ?
Après ma thèse en biologie moléculaire obtenue à l’UNIL, j’ai d’abord fait de la recherche comme post-doctorante puis dans une start-up. J’ai ensuite rejoint la société AC Immune à ses débuts, et travaillé dans la veille technologique et la gestion de projets. Dans les petites structures comme les start-ups, nous avons accès à différents domaines, il faut donc être polyvalent. C’est là que j’ai commencé à m’intéresser aux brevets. J’ai suivi diverses formations dont celle de l’epi-CEIPI, la formation de base en droit européen des brevets.
En quoi vous aide votre parcours ?
Bien évidemment, avoir un doctorat, une expérience dans la recherche et une formation scientifique variée est un atout. Il faut en effet bien comprendre ce que font les clients dans des domaines divers et pointus. Pour exercer cette profession, il faut avoir obtenu au minimum une licence scientifique ou technique de niveau universitaire.
Que diriez-vous à quelqu’un que votre parcours intéresserait ?
Je n’avais pas d’idée précise de carrière quand j’ai fait mon diplôme à l’Université de Strasbourg : j’ai donc suivi une filière assez large, intégrant biologie, maths, physique et chimie. Toutes ces matières me sont très utiles dans ma profession aujourd’hui ! Au niveau des études, je conseillerais de choisir les matières que l’on aime sans restreindre son horizon. Les langues sont aussi importantes : anglais, allemand et français sont les trois langues officielles de l’Office européen des brevets.
Interview publiée dans Échos du vivant n°6 | Printemps 2017
Texte: Nicolas Berlie | Photo: Felix Imhof

Annie Mercier Zuber
Enseignante de biologie au gymnase
Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier ?
J’aime imaginer des solutions pour rendre les élèves réceptifs à la matière que j’enseigne. Être témoin de leur ouverture vers le monde est fantastique. Accompagner des élèves pendant leur travail de maturité et partager des idées avec les autres enseignants sont aussi des aspects du métier qui me plaisent bien.
Quel parcours avez-vous suivi avant de devenir enseignante ?
Je suis diplômée en biologie de l’Université de Lausanne, où j’ai également effectué une thèse de doctorat sur la physiologie du rein. Ensuite, je suis partie 3 ans et demi à Cambridge pour faire de la recherche, qui s’est poursuivie encore deux ans à mon retour, avant d’entrer à la Haute école pédagogique du canton de Vaud. Juste après ma formation, j’ai été engagée pour un remplacement au Gymnase de Beaulieu, où j’ai pu rester par la suite.
Avez-vous hésité entre une carrière d’enseignante et de chercheuse ?
Non, j’ai débuté mes études de biologie avec à l’esprit l’idée de devenir enseignante. Mais j’ai adoré faire de la recherche, et j’aurais pu continuer si je l’avais désiré. Travailler comme chercheuse m’a permis d’acquérir de l’expérience professionnelle. Grâce à cela, je suis bien placée pour expliquer la démarche scientifique à mes élèves.
Que diriez-vous à une personne qui se destine à l’enseignement ?
Être passionnée est essentiel, car cela pousse à récolter des idées et à se tenir au courant des avancées de la recherche afin de les intégrer de façon appropriée dans son enseignement. Il faut aimer transmettre son savoir et être capable de se remettre en question pour s’améliorer. Et cela aide évidemment si l’on dispose de qualités sociales afin d’installer un climat de confiance et de respect mutuel dans sa classe.
Interview publiée dans Échos du vivant n°5 | Automne 2016
Texte: Anne Burkhardt | Photo: Felix Imhof

Francesca Amati
Professeure associée à la FBM
Quelle formation avez-vous suivie ?
Après avoir étudié la médecine à l’Université de Genève, j’ai fait une spécialisation en médecine interne, suivie par la diabétologie et la médecine
du sport. C’est grâce à un séjour aux États-Unis que j’ai découvert la physiologie de l’effort. Je me suis formée à cette discipline en y effectuant un master et un doctorat ès sciences.
Comment avez-vous choisi votre spécialisation ?
J’ai trouvé ma voie petit à petit. Au début de mes études, je me destinais plutôt à la médecine tropicale, puis aux urgences. Pendant ma formation en médecine interne, j’ai commencé à m’intéresser aux bénéfices de l’exercice physique dans les maladies chroniques, comme le diabète. C’est donc assez naturellement que je me suis tournée vers la diabétologie et la médecine du sport. Les personnes que j’ai côtoyées sur mon chemin m’ont aussi encouragée.
Et aujourd’hui, en quoi consiste votre travail ?
J’enseigne à l’Institut des sciences du sport et je fais de la recherche au Département de physiologie de l’Université de Lausanne. Mon groupe travaille sur les effets moléculaires de l’exercice physique et le métabolisme musculaire chez des volontaires de plus de 60 ans. Au Centre hospitalier universitaire vaudois, je suis responsable de la consultation médicale «sport et diabète».
Que diriez-vous à un jeune tenté par la médecine et la biologie?
Il faut suivre ses envies, tout en restant ouvert parce que l’on ne sait pas où cela nous mènera. En débutant la médecine, je n’imaginais pas que je ferais de la recherche à cheval entre les deux disciplines. Un jeune qui désire comprendre les mécanismes par l’expérimentation se plaira mieux en biologie. Celui qui aime accompagner les gens se trouvera mieux en médecine.
Interview publiée dans Échos du vivant n°4 | Printemps 2016
Texte: Anne Burkhardt | Photo: Felix Imhof
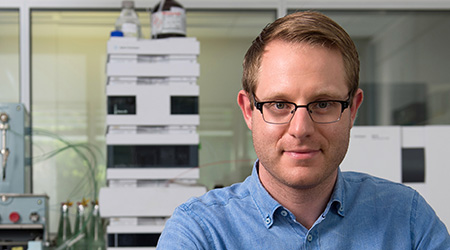
Davide Staedler
Biologiste et entrepreneur
Comment est née votre entreprise ?
Quand j’étais en deuxième année de bachelor en biologie à l’UNIL, un ami m’a parlé d’un problème de pollution. J’ai eu l’idée d’utiliser des bactéries qui produisent du savon pour laver in situ l’huile isolante à l’intérieur de vieux câbles électriques souterrains. J’ai créé mon entreprise de conseil scientifique, TIBIO Sàrl (pour Technologie Industrie BIOlogie), parce que j’avais un client intéressé par ma solution.
En quoi consiste votre travail ?
Je m’occupe de la gestion financière et stratégique de l’entreprise, tandis que les chefs de projets cherchent des solutions aux problématiques environnementales ou médicales des clients. Je travaille également en tant que directeur scientifique chez Scitec Research SA, un laboratoire d’analyses.
Je consacre beaucoup de temps à discuter avec les clients. Je lis aussi des articles scientifiques qui m’inspirent des idées de solutions à tester.
N’aurait-il pas mieux valu étudier l’économie ?
Non, pour fonder ce type d’entreprise, il vaut mieux commencer par la biologie puis rattraper les notions économiques, que l’inverse. A l’UNIL, j’ai développé l’esprit critique et l’humilité, et le bachelor m’a donné une vision globale de la biologie. Tout cela est utile pour se confronter aux problèmes des clients. Après ma maîtrise en biologie médicale à l’UNIL, j’ai obtenu un doctorat à l’EPFL. Détenir un doctorat rassure les clients.
Que diriez vous à un futur biologiste entrepreneur ?
Souvent, les start-ups académiques ne marchent pas car, même si l’idée était bonne, on a oublié d’étudier le marché! Il faut être à l’écoute des besoins des clients et s’assurer de leur intérêt pour les services proposés. Et contrairement à ce que pensent de nombreux jeunes, le métier d’entrepreneur est assez difficile, surtout au début.
Interview publiée dans Échos du vivant n°3 | Automne 2015
Texte: Anne Burkhardt | Photo: Felix Imhof

Roxanne Currat
Conservatrice de musée
En quoi consiste votre travail ?
Je travaille comme conservatrice au Musée de la main UNIL-CHUV à Lausanne. Je m’occupe des expositions scientifiques pour le grand public: recherche d’informations, conception avec l’équipe du musée, mise en place avec les scénographes et les techniciens, création d’ateliers ou de matériel pédagogique et formation des guides.
Comment êtes-vous arrivée à ce poste ?
Je m’intéresse depuis longtemps au lien entre Science et Société. Pendant mes études de biologie à l’Université de Lausanne, j’ai suivi des cours d’éthique et de sociologie des sciences. J’ai aussi conduit des animations scientifiques pendant mon temps libre. A la fin de ma Maîtrise ès sciences en Génomique et biologie expérimentale1, j’ai fait un stage de sept mois à L’Éprouvette, le laboratoire public de l’UNIL. J’ai travaillé comme chercheuse puis suis entrée au Musée.
Que vous ont apporté vos études à l’UNIL ?
A l’Université, j’ai acquis des bases en méthodologie scientifique qui sont très utiles pour lire des articles scientifiques, ce que je fais pour préparer les expositions et me tenir à jour. J’ai aussi appris à synthétiser l’information, mais ici je dois en plus la «traduire» en langage compréhensible pour le public.
Que diriez-vous à quelqu’un que votre parcours inspirerait ?
Au début de mes études, je ne m’imaginais pas travailler dans un musée. Aujourd’hui, je suis consciente d’avoir de la chance, car les postes fixes sont plutôt rares dans ce domaine. Les stages et les rencontres avec des gens du métier sont importants pour augmenter ses chances de trouver du travail dans le domaine de la vulgarisation scientifique.
1 Remplacée depuis par la Maîtrise ès Sciences en Sciences moléculaires du vivant.
Interview publiée dans Échos du vivant n°2 | Printemps 2015
Texte: Anne Burkhardt | Photo: Felix Imhof

Audrey Megali
Biologiste dans un bureau d’études
Quel a été votre parcours ?
J’ai étudié la biologie à l’Université de Lausanne, avec une année Erasmus en Écosse, et j’ai obtenu une Maîtrise ès Sciences en comportement, évolution et conservation. Ensuite, j’ai fait un stage au Centre-nature ASPO de La Sauge et j’ai travaillé au Tierspital à Berne. Enfin, j’ai été stagiaire chez A. MAibach Sàrl, un bureau d’études en environnement à Oron-la-Ville. Ce stage a débouché sur mon emploi actuel. Je travaille sur des projets de préservation et d’aménagement de sites naturels: passages à faune, réseaux agroécologiques, plans de gestion forestiers et revitalisation de cours d’eau.
Que vous ont apporté les stages pour votre poste actuel ?
Les stages m’ont permis de découvrir les débouchés et mieux cerner mes intérêts, pour le travail de terrain par exemple. J’ai aussi appris à communiquer avec des gens très différents et approfondi ma connaissance des oiseaux. Et A. MAibach Sàrl m’a engagée grâce à mon stage chez eux!
Vos études à l’UNIL vous ont-elles bien préparée ?
Esprit critique, recherche et synthèse d’informations sont des compétences acquises pendant mes études et très utiles à mon poste actuel. Mais en arrivant ici, j’ai dû en plus apprendre à connaître les lois, les procédures à suivre et les personnes à contacter, et approfondir mes connaissances naturalistes et en géomatique.
Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans votre travail ?
Apprendre constamment me stimule. Le terrain me plaît beaucoup, même si j’aimerais pouvoir y consacrer plus de temps. C’est gratifiant de voir le résultat de son travail, par exemple un cours d’eau revitalisé selon les recommandations que j’avais faites. Et pendant mes loisirs, je peux profiter de la nature sans penser au travail.
Interview publiée dans Échos du vivant n°1 | Automne 2014
Texte: Anne Burkhardt | Photo: Felix Imhof