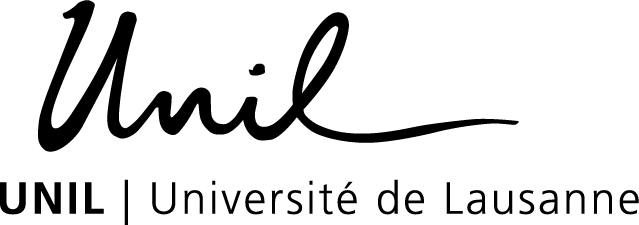Cohérence & Innovation
L’UNIL mobilise sa force d’innovation afin de stimuler et soutenir l’émergence de pratiques académiques et professionnelles s’inscrivant dans les limites planétaires.
Elle promeut l’excellence collective à tous les niveaux et soutient activement la production de recherches sur les transformations sociétales nécessaires à l’atteinte de la durabilité.
Objectifs à 2037
Réduire les émissions de CO2 eq. dû aux déplacements professionnels en avion de 60% minimum par rapport à 2019.
Contexte
La mobilité professionnelle en avion est responsable de 24% des émissions de CO2 eq. de l’UNIL, ce qui en fait le plus gros poste, et de 6% de son impact sur la biodiversité globale (en 2019). L’UNIL a une grande marge de manœuvre pour agir sur les déplacements de son personnel et a déjà pris de premières mesures en se dotant d’une nouvelle directive sur les voyages professionnels qui introduit notamment une interdiction du recours à l’avion pour les destinations atteignables en une dizaine d’heures de train (cf. Directive 0.8).
Effets attendus d’ici 2037
Réduction de 17% des émissions de CO2 eq. et de 4% de l’impact sur la biodiversité globale de l’UNIL par rapport au scénario tendance.
Co-bénéfices
- Réduction de la fréquence des déplacements bénéfique à la conciliation avec la vie de famille et à l’atténuation de la fatigue liée aux longs voyages.
Points de vigilance
- Veiller à maintenir une participation active aux réseaux internationaux.
- Veiller à conserver l’attractivité de l’UNIL pour les chercheur·euses.
- Tenir compte des différences de coûts entre le train et l’avion.
- Prêter attention à ce que les chercheur·euses qui privilégient la durabilité ne soient pas pénalisés dans leur carrière.
Opportunités
- Répartir plus équitablement les opportunités de voyage entre les chercheurs·euses sénior·es et les plus juniors.
- Repenser le temps de la recherche et les critères d’excellence académique, aujourd’hui très quantitatifs, pour les rendre plus qualitatifs et collectifs (dans la lignée de la Coalition for Advancing Research Assessment).
- Repenser le rôle des échanges internationaux, également dans une perspective de décolonisation de la production du savoir.
- Renforcer les collaborations au niveau européen (notamment via le réseau CIVIS).
- Développer des partenariats avec des universités situées proches de terrains de recherches pertinents pour les chercheur·euses UNIL afin de réduire le besoin de s’y rendre.
- Développer les capacités de l’UNIL à accueillir des conférences en multi-hubing afin d’en faire un pôle au niveau européen.
Réduire le volume d’achat de biens d’équipement liés aux laboratoires de 40% minimum par rapport à 2019.
Contexte
Les achats d’équipements liés aux laboratoires sont responsables de 2% des émissions de CO2 eq. de l’UNIL ainsi que de 3% de ses impacts sur la biodiversité globale (en 2019).
A l’heure actuelle, il existe des initiatives visant la réduction des impacts dans certains laboratoires, mais il manque une approche cohérente et organisée à l’échelle de l’institution.
La réduction de la quantité d’équipements de laboratoires achetée implique de disposer d’une meilleure connaissance des acquisitions réalisées afin notamment de mutualiser leur utilisation et d’allonger leur durée de vie.
Une Task Force Green Labs dédiée à cet enjeu sera constituée dès septembre 2024.
Effets attendus d’ici 2037
Réduction de 1% des émissions de CO2 eq. et de 1% de l’impact sur la biodiversité globale de l’UNIL par rapport au scénario tendance.
Co-bénéfices
- Réalisation d’économies financières.
- Augmentation des échanges académiques entre unités favorisant l’interdisciplinarité.
- Meilleures connaissances de la qualité environnementale et sociales des biens consommés.
Points de vigilance
- Veiller à ne pas rajouter trop de procédures administratives risquant de pénaliser la compétitivité de la recherche.
- Veiller à allouer les ressources suffisantes pour que les projets soient fonctionnels et répondent aux besoins des utilisateur·trices.
Opportunités
- Homogénéisation et formalisation des processus d’achats favorisant notamment le bon respect des critères de marchés publics.
- (Ré)acquisition des compétences métiers spécifiques en interne (pour la maintenance technique) permettant notamment de gagner en indépendance par rapport aux fournisseurs.
- Augmenter la traçabilité pour réduire le risque d’achats socialement non-éthiques.
Réduire le volume d’achat de consommables de laboratoire de 20% minimum par rapport à 2019.
Contexte
Les achats de consommables liés aux laboratoires sont responsables de 15% des émissions de CO2 eq. de l’UNIL ainsi que de 11% de ses impacts sur la biodiversité globale (en 2019). A noter qu’il reste complexe de quantifier l’étendue exacte de ces impacts, en raison de la très grande diversité des produits achetés et du manque de connaissance sur leurs impacts.
A l’heure actuelle, il existe des initiatives visant la réduction des impacts dans certains laboratoires, mais il manque une approche cohérente et organisée à l’échelle de l’institution.
La réduction de la masse d’achat de consommables nécessitera notamment de recourir à du matériel lavable et de repenser certaines pratiques et protocoles de laboratoire.
Une Task Force Green Labs dédiée à cet enjeu sera constituée dès septembre 2024.
Effets attendus d’ici 2037
Réduction de 6% des émissions de CO2 eq. et de 4% de l’impact sur la biodiversité globale de l’UNIL par rapport au scénario tendance.
Co-bénéfices
- Réalisation d’économies financières.
- Réduction de la dépendance à des fournisseurs externes.
- Meilleures connaissances de la qualité environnementale et sociales des biens consommés.
Points de vigilance
- Veiller à ne pas ralentir les process au risque de pénaliser la compétitivité de la recherche.
- Veiller à assurer la bonne formation de tout le personnel de laboratoire afin d’éviter les risques de contamination liés à l’usage de matériel lavable.
- Veiller à allouer les ressources suffisantes pour que les projets soient fonctionnels et répondent aux besoins des utilisateur·trices.
Opportunités
- (Ré)acquisition des compétences métiers spécifiques en interne (pour le lavage et la stérilisation, …).
- Développement de postes de Personnel administratif et technique (PAT) spécialisés pouvant assurer le développement et la transition des bonnes pratiques au sein des laboratoires.
- Augmenter la traçabilité pour réduire le risque d’achats socialement non-éthiques.
Réduire le volume d’achat de biens informatiques et électroniques de 40% minimum par rapport à 2019 et de 60% pour les autres types de biens.
Contexte
L’achat de matériel informatique et électronique représente 4% des émissions de CO2 eq.de l’UNIL ainsi que 30% des impacts de l’UNIL sur la biodiversité globale (en 2019) .
Les autres achats (produits d’entretien des bâtiments, mobilier, matériel de bureau, papier, produits agricoles et autres biens de consommation) représentent 3% des émissions de CO2 eq. de l’UNIL (en 2019) et 3% de ses impacts sur la biodiversité globale.
L’achat du matériel informatique, des meubles ou des produits d’entretien se fait déjà de manière assez centralisée. Dans d’autres domaines, les achats sont encore très décentralisés et les procédures d’acquisition varient d’un acheteur·euse à l’autre.
A noter que le matériel informatique et électronique est également un domaine porteur d’un fort impact social dans les pays où il est fabriqué (haut potentiel d’esclavage moderne importé).
Effets attendus d’ici 2037
Pour le matériel informatique et électronique, réduction de 2% des émissions de CO2 eq. et de 16% de l’impact sur la biodiversité globale de l’UNIL par rapport au scénario tendance.
Pour les autres types d’achats, réduction de 2% des émissions de CO2 eq. et de 5% de l’impact sur la biodiversité globale de l’UNIL par rapport au scénario tendance.
Co-bénéfices
- Réalisation d’économies financières.
- Réduction du risque d’esclavage moderne importé.
Points de vigilance
- Veiller à ne pas créer une dette technologique qui serait difficile à rattraper et pénalisant la compétitivité de la recherche.
Opportunités
- Homogénéisation et formalisation des processus d’achats favorisant notamment le bon respect des critères de marchés publics.
- Réduction du risque lié aux achats socialement non-éthiques.
Réduire l’énergie thermique et électrique consommées pour l’exploitation des bâtiments de 50% par rapport à 2019.
Contexte
La consommation d’énergie thermique et électrique représente 24% des émissions de CO2 eq. de l’UNIL ainsi que 18% de son impact sur la biodiversité globale (en 2019). Les besoins thermiques dépendent essentiellement de la qualité de l’enveloppe des bâtiments ainsi que de la possibilité d’effectuer des réglages thermiques centralisés. Les besoins électriques sont liés à l’éclairage, à la ventilation et aux pompes à chaleur.
Dès 2027, avec l’entrée en fonction de la nouvelle centrale de chauffe à l’eau du lac, les bâtiments seront chauffés uniquement avec une énergie électrique. La réduction des émissions de CO2 sera conséquente, mais les besoins électriques augmenteront, car cette énergie sera également utilisée pour satisfaire les besoins thermiques.
Plusieurs projets de rénovations énergétiques sont planifiés et un important travail d’optimisation des consommations est en cours. Il faudra également questionner systématiquement les besoins afin de réduire la demande globale en énergie de l’UNIL.
A noter que :
- Les bâtiments sont la propriété de l’État de Vaud qui en délègue l’exploitation courante à l’UNIL. Tous les investissements liés à des rénovations sont à la charge de l’État.
- L’UNIL est soumise aux objectifs des lois cantonales et fédérales sur l’énergie et le climat.
Effets attendus d’ici 2037
Réduction de 14% des émissions de CO2 eq. et de 10% de l’impact sur la biodiversité globale de l’UNIL par rapport au scénario tendance.
Co-bénéfices
- Réalisation d’économies financières.
- Réduction des dommages en cas de pénurie énergétique.
Points de vigilance
- Les rénovations sont conditionnées à un investissement important de l’État et à la disponibilité des ressources matériels et humaines pour réaliser les chantiers.
- Les procédures actuelles touchant aux bâtiments sont très lourdes et allongent le temps de réalisation des travaux.
Opportunités
- Optimiser l’usage actuel des bâtiments, notamment en intégrant les nouvelles formes et habitudes de travail (desk sharing, télétravail, …), afin de limiter le besoin de construire de nouvelles surfaces.
Réduire l’énergie électrique consommée par les activités de recherche expérimentale de 20% par rapport à 2019.
Contexte
La consommation d’énergie thermique et électrique représente 24% des émissions de CO2 eq. de l’UNIL ainsi que 18% de son impact sur la biodiversité globale (en 2019). Certains besoins électriques sont conditionnés par des activités spécifiques à la recherche expérimentale (process).
Il existe une marge de manœuvre pour diminuer la quantité d’équipements et en optimiser l’utilisation.
Une Task Force Green Labs dédiée à cet enjeu sera constituée dès septembre 2024.
A noter qu’il est actuellement difficile d’isoler la consommation liée aux process de la consommation d’électricité globale. Néanmoins, ces 20% de réduction viennent s’ajouter aux 50% de réduction liée à l’exploitation des bâtiments.
Effets attendus d’ici 2037
Non quantifiable, car il n’est actuellement pas possible d’isoler la consommation liée au process de la consommation d’électricité globale.
Co-bénéfices
- Contribuer à l’augmentation de l’autonomie énergétique suisse.
- Développer de meilleures connaissances du parc d’équipements des laboratoires UNIL.
Points de vigilance
- Mettre à disposition les ressources nécessaires pour que les systèmes de réduction des consommations soient fonctionnels.
Opportunités
- Optimiser l’usage des équipements pour en réduire le nombre et les besoins électriques.
Couvrir l’entier des besoins en énergies thermiques et électrique avec 100% d’énergie renouvelable.
Contexte
La consommation d’énergie thermique et électrique représente 24% des émissions de CO2 eq. de l’UNIL ainsi que 18% de son impact sur la biodiversité globale (en2019).
Dès 2027, avec l’entrée en fonction de la nouvelle centrale de chauffe à l’eau du lac, les bâtiments seront chauffés uniquement avec une énergie électrique. La réduction des émissions de CO2 sera conséquente, mais les besoins électriques augmenteront, car cette énergie sera également utilisée pour satisfaire les besoins thermiques.
A noter :
- A l’heure actuelle, l’UNIL achète uniquement de l’électricité renouvelable certifiée TÜW SÜD (contrat en cours jusqu’à 2027).
- L’UNIL couvre 6% de ses besoins en électricité grâce aux panneaux photovoltaïques installés sur ses bâtiments.
Effets attendus d’ici 2037
Réduction de 18% des émissions CO2 eq. de l’UNIL par rapport au scénario tendance (aucune réduction significative de l’impact sur la biodiversité globale de l’UNIL).
Co-bénéfices
- Réduction des risques liés aux fluctuations de l’approvisionnement en énergies fossiles.
- Contribuer à l’augmentation de l’autonomie énergétique suisse.
Points de vigilance
- L’achat d’énergie certifiée ne garantit pas que l’énergie effectivement consommée soit renouvelable en tout temps (notamment durant l’hiver).
- Choisir un autre type de certificat (Nativa+ par exemple) peut représenter un surcoût.
Opportunités
- La procédure d’appel d’offres pour trouver un fournisseur dès 2028 peut être l’occasion de changer de type de certificat.
Diminuer la surface brute de plancher moyenne bâtie par personne de minimum de 20% par rapport à 2019.
Contexte
La construction de tout nouveau bâtiment représente des impacts environnementaux importants. Ainsi, densifier l’usage des surfaces déjà bâties représente une excellente solution pour éviter de devoir en construire de nouvelles.
A noter qu’éviter l’augmentation des surfaces bâties permet également de limiter l’augmentation des consommations d’énergies thermiques et électriques ainsi que de limiter l’augmentation de la surface artificialisée sur le campus.
Effets attendus d’ici 2037
Réduction de 7% des émissions de CO2 eq. et de 5% de l’impact sur la biodiversité globale de l’UNIL (l’impact des matériaux de construction est lissé sur 30 ans).
Co-bénéfices
- Gain pour la biodiversité locale, la gestion des eaux de pluie et la qualité des sols si l’artificialisation par de nouvelles constructions est évitée.
Points de vigilance
- Veiller à ne pas entraver les possibilités de rénovation.
- Veiller à distinguer les affectations qui ont un fort potentiel de densification (bureaux, stockages, …) de celles qui sont déjà très sollicitées (auditoires, salles de sport, …).
Opportunités
- Augmentation des échanges et de la convivialité en développant de nouveaux espaces de travail plus flexibles.
Adopter un fonctionnement institutionnel laissant une large place aux expérimentations et à l’innovation socio-écologique.
Contexte
La transition nécessite de questionner les pratiques actuelles pour en inventer de nouvelles qui soient plus durables. La mise en place de conditions propices à l’expérimentation et stimulant la créativité à tous les niveaux de l’institution permettra d’accélérer l’émergence et l’adoption de ces nouvelles pratiques.
Différentes initiatives existent déjà dans les services et facultés, telles que le programme Impulse du HUB Entrepreneuriat et Innovation stimulant l’intrapreunariat. Néanmoins, il n’y a pas encore une véritable culture de l’expérimentation et de l’innovation socio-écologique au niveau de l’institution.
Effets attendus d’ici 2037
Non quantifiable, mais nécessaire pour atteindre les autres objectifs.
Co-bénéfices
- Amélioration du cadre de travail.
- Renforcement de l’attractivité de l’UNIL.
Points de vigilance
- Risque de surcharge de travail si le développement de nouvelles pratiques se fait en plus des tâches existantes et non en remplacement.
Opportunités
- Développer et tester à l’échelle de l’UNIL des méthodologies et savoirs qui pourront ensuite être utiles à la société.
- Renforcer les collaborations avec les chercheur·euses afin de mesurer l’impact des expériences réalisées.
Renforcer la communauté de recherche interdisciplinaire de l’UNIL sur les enjeux de transition.
Contexte
L’UNIL dispose déjà d’une communauté grandissante de chercheur·euses actifs sur la durabilité dans l’ensemble de ses facultés (recensée sur le Sustainability Portal). L’UNIL dispose également de plateformes et centres de recherche sur différents aspects de la durabilité.
Ces éléments ont permis, aujourd’hui, à l’UNIL d’être reconnue comme une université pionnière dans le développement de savoirs sur la transition. L’enjeu est maintenant d’affirmer ce positionnement et d’assurer cette reconnaissance sur le long terme.
Effets attendus d’ici 2037
Non quantifiable, mais nécessaire pour atteindre les autres objectifs.
Co-bénéfices
- Fédérer la communauté interdisciplinaire de chercheur·euses UNIL.
- Augmenter la visibilité de l’UNIL.
- Attirer des chercheur·euses et susciter de nouvelles orientations de recherche.
Points de vigilance
- Veiller à respecter la liberté académique et à soutenir également d’autres thématiques de recherche.
- Veiller à ce que l’UNIL ne se substitue pas au FNS et aux autres bailleurs de fonds.
Opportunités
- Développement de savoirs qui seront utiles à la société.
- Comprendre et anticiper les changements sociétaux et leurs impacts.
- Susciter la création de nouveaux financements en faveur de la transition au niveau des bailleurs de fonds classiques.