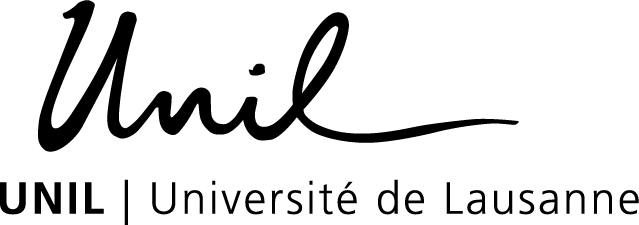Formation & Expérimentation
L’UNIL s’appuie sur sa capacité de formation pour doter l’ensemble de sa communauté de connaissances et compétences pratiques en matière de durabilité.
L’UNIL est un lieu d’expériences transformatrices qui contribue à développer des pratiques bénéfiques à la santé humaine et à l’environnement afin de renforcer la qualité de vie sur le campus.
Objectifs à 2037
Former l’ensemble de la communauté UNIL à la durabilité.
Contexte
L’UNIL a pour mission de former les citoyen·nes de demain. Cela nécessite de doter l’ensemble des étudiant·es de compétences, tant générales que propres à leurs disciplines, sur les enjeux de transition.
Actuellement, des enseignements sur la durabilité existent dans toutes les facultés, mais leur intégration manque encore souvent de cohérence au niveau du cursus.
Des démarches plus systématiques ont déjà été réalisées dans certains domaines, notamment au niveau du bachelor de HEC et de l’école de médecine.
Pour engager la transition de l’institution vers un fonctionnement plus durable, il est également nécessaire que l’UNIL dote l’ensemble de ses collaborateur·trices de connaissances et compétences en matière de durabilité.
Effets attendus d’ici 2037
Non quantifiable, mais nécessaire pour atteindre les autres objectifs.
Co-bénéfices
- Fédérer la communauté UNIL.
- Développer l’attractivité et l’exemplarité de l’UNIL.
Points de vigilance
- Veiller à multiplier les points de vue et les débats afin de prendre en compte les différentes perceptions autour de la durabilité.
- Prêter attention à la disponibilité d’enseignant.e.s pour porter ces nouveaux contenus.
- Allouer des ressources, notamment en temps, pour que les personnes puissent se former.
Opportunités
- Développer les collaborations interfacultaires pour favoriser l’interdisciplinarité et l’échange de cours entre facultés.
Réduire la part de mobilité pendulaire en transport individuel motorisé (TIM) de 50% par rapport à 2019.
Contexte
La mobilité pendulaire est responsable de 15% des émissions de CO2 eq. de l’UNIL ainsi que de 14% de son impact sur la biodiversité globale (en 2019). La mobilité TIM de la communauté universitaire est également responsable d’une part de la pollution et du trafic dans l’agglomération.
Depuis 2010, de nombreux efforts ont été faits pour flexibiliser l’offre de stationnement sur le campus afin de réduire la part modale TIM tout en continuant à offrir à l’ensemble du personnel de l’UNIL la possibilité d’avoir une autorisation de stationnement si besoin.
Cette stratégie a porté ses fruits : la part modale de la communauté recourant aux TIM est passée de 18% en 2010 à 11% en 2023. L’objectif est de réduire encore un peu ce chiffre afin de pouvoir continuer à délivrer une autorisation de stationnement à tous les membres du personnel qui en font la demande, sans avoir à introduire de critères d’exclusion (résidence à proximité du campus, desserte en TP, …).
A noter que l’hypothèse retenue est un report sur les mobilités actives et les transports publics.
Effets attendus d’ici 2037
Réduction de 3% des émissions de CO2 eq. et de 3% de l’impact sur la biodiversité globale de l’UNIL par rapport au scénario tendance.
Co-bénéfices
- Diminution de la pollution et de l’aspect routier du campus et de ces abords.
- Amélioration de la qualité de vie sur le campus.
Points de vigilance
- Continuer à offrir la possibilité de stationner sur le campus aux personnes qui en expriment le besoin.
Opportunités
- Poursuivre la réorganisation du stationnement sur le campus afin de concentrer les parkings en périphérie et améliorer l’aspect apaisé de l’intérieur du site.
Doubler la part de mobilité pendulaire à vélo et à pied par rapport à 2019.
Contexte
La mobilité pendulaire est responsable de 15% des émissions de CO2 eq. de l’UNIL ainsi que de 14% de son impact sur la biodiversité globale (en 2019).
En 2019, la part de la communauté se rendant sur le campus en vélo était de 9% et celle s’y rendant à pied de 4%.
A noter que la part modale du vélo est en croissance continue depuis plusieurs années atteignant en 2023 19.4% pour le corps académique et 13.4% pour le personnel administratif et technique contre 6.6% pour les étudiant·es.
D’ici 2030 et la mise en service de nouvelles offres de transports publics, les mobilités actives présentent le plus fort potentiel de croissance.
Effets attendus d’ici 2037
Réduction de 1% des émissions de CO2 eq. et de 1% de l’impact sur la biodiversité globale de l’UNIL par rapport au scénario tendance.
Co-bénéfices
- Pratiquer une activité physique au quotidien est bénéfique pour la santé physique et mentale.
- Reconnexion aux éléments naturels, à l’environnement bâti et aux autres usager·ères des rues.
- Permet de ralentir la croissance de la fréquentation des TL et leur surcharge.
Points de vigilance
- Continuer à offrir des alternatives aux personnes pour qui les mobilités actives ne sont pas une option.
Opportunités
- Requalification routière pour améliorer le réseau cyclable.
- Constitution d’une communauté cycliste conviviale à l’UNIL.
Augmenter la part (en masse) d’aliments d’origine végétale proposée dans les cafétérias de 30% minimum par rapport à 2019.
Contexte
L’alimentation servie dans les cafétérias du campus est responsable de 5% des émissions de CO2 eq. de l’UNIL, dont environ la moitié est imputable aux produits carnés, ainsi que de 6% de son impact sur la biodiversité globale (en 2019).
En 2019, la part d’aliments d’origine végétale servi dans les cafétérias du campus était de 73%.
Depuis 2018, l’UNIL est dotée d’un Cadre de référence pour une alimentation équilibrée et durable qui fixe des objectifs en matière d’offre végétarienne, de provenance et de saisonnalité.
Ce cadre évolutif est contraignant pour l’ensemble des prestataires exploitant un lieu de restauration sur le campus, dont les contrats seront remis au concours en 2032.
Effets attendus d’ici 2037
Réduction de 3% des émissions de CO2 eq. et de 4% de l’impact sur la biodiversité globale de l’UNIL par rapport au scénario tendance.
Co-bénéfices
- Gain pour la santé d’une diminution de la consommation de viande.
Points de vigilance
- Veiller à maintenir l’attractivité des cafétérias afin de garantir leur viabilité économique.
- Tenir compte des personnes précaires pour qui les cafétérias sont une opportunité de consommer un repas équilibré à prix abordable.
Opportunités
- Renforcer l’attractivité et la variété des plats végétariens proposés.
- Renforcer la traçabilité des aliments.
- Établir des liens privilégiés avec les éleveurs locaux.
Augmenter la part (en masse) de produits alimentaires suisses de 50% minimum par rapport à 2019.
Contexte
L’alimentation servie dans les cafétérias du campus est responsable de 5% des émissions de CO2 eq. de l’UNIL, ainsi que de 6% de son impact sur la biodiversité globale (en 2019).
En 2019, la part de produits suisses servi dans les cafétérias du campus était de 46%.
Depuis 2018, l’UNIL s’est dotée d’un Cadre de référence pour une alimentation équilibrée et durable qui fixe des objectifs en matière d’offre végétarienne, de provenance et de saisonnalité.
Ce cadre évolutif est contraignant pour l’ensemble des prestataires exploitant un lieu de restauration sur le campus, dont les contrats seront remis au concours en 2032.
Effets attendus d’ici 2037
Non quantifié actuellement, mais travail en cours pour obtenir les données nécessaires à une quantification.
Co-bénéfices
- Soutien à la production agricole suisse.
Points de vigilance
- Tenir compte de la capacité du marché suisse à répondre à une augmentation de la demande.
- Veiller à maintenir l’attractivité des cafétérias afin de garantir leur viabilité économique.
- Tenir compte des personnes précaires pour qui les cafétérias sont une opportunité de consommer un repas équilibré à prix abordable.
Opportunités
- Renforcer les liens entre l’UNIL et les milieux agricoles suisses.
Au minimum tripler la part (en masse) de produits alimentaires labélisés bio par rapport à 2019.
Contexte
L’alimentation servie dans les cafétérias du campus est responsable de 5% des émissions de CO2 eq. de l’UNIL, ainsi que de 6% de son impact sur la biodiversité globale (en 2019).
En 2019, la part de produits labélisés bio servie dans les cafétérias du campus était de 5%.
Depuis 2018, l’UNIL est dotée d’un Cadre de référence pour une alimentation équilibrée et durable qui fixe des objectifs en matière d’offre végétarienne, de provenance et de saisonnalité.
Ce cadre évolutif est contraignant pour l’ensemble des prestataires exploitant un lieu de restauration sur le campus, dont les contrats seront remis au concours en 2032.
Effets attendus d’ici 2037
Non quantifié actuellement en raison de l’absence de base de données de référence.
Co-bénéfices
- Gain pour la biodiversité, la qualité des sols et des eaux ainsi que pour la santé humaine d’une réduction de l’exposition à des aliments potentiellement traités.
Points de vigilance
- Tenir compte de la capacité du marché suisse à répondre à une augmentation de la demande.
- Veiller à maintenir l’attractivité des cafétérias afin de garantir leur viabilité économique.
- Tenir compte des personnes précaires pour qui les cafétérias sont une opportunité de consommer un repas équilibré à prix abordable.
Opportunités
- Renforcer les liens entre l’UNIL et les milieux agricoles suisses.
- Contribuer au développement de l’offre bio.
Maintenir à 60% la part de surface non artificialisée sur le campus de Dorigny.
Contexte
Depuis son implantation sur le site de Dorigny en 1970, le campus de l’UNIL s’est développé en faisant un usage parcimonieux du sol préservant le concept d’aménagement initial du site en «parc urbain».
Si la construction de deux nouveaux bâtiments est d’ores et déjà prévue, il s’agit de compenser l’artificialisation de ces surfaces afin de maintenir le caractère paysager actuel du campus.
Les surfaces artificialisées comprennent les zones imperméables, semi-perméables compactées ou recouvertes de minéraux et les terrains de sport.
Effets attendus d’ici 2037
Non quantifié actuellement.
Co-bénéfices
- Gain pour la biodiversité locale, la qualité des sols et des eaux.
- Adaptation aux changements climatiques, notamment en matière d’îlots de chaleur.
- Contact avec la nature bénéfique pour la santé physique et mentale.
Points de vigilance
- Veiller à ne pas entraver les possibilités de rénovations.
Opportunités
- Requalification de certains parkings en surfaces bénéfiques à la biodiversité et au contact humain.
Améliorer l’état de l’infrastructure écologique sur le campus.
Contexte
L’importance des espaces verts du campus lui confère un potentiel élevé de promotion de la biodiversité locale.
Depuis 2022, l’UNIL dispose d’un concept de monitoring contenant une quinzaine d’indicateurs développés pour chacune des trames écologiques ( forêt, paysages cultivés semi-ouverts, cours d’eau et points d’eau, prairies maigres et sèches, ainsi que les surfaces exemptes de pollution lumineuse ).
D’ici 2030, chaque indicateur aura été renseigné au moins une fois.
Une série de mesures pour augmenter la qualité de la biodiversité locale a déjà été identifiée et les premières réalisations interviendront en 2024.
A noter que l’augmentation de la biodiversité locale s’inscrit dans le long terme et que les résultats des mesures entreprises prennent souvent des années pour se concrétiser.
Effets attendus d’ici 2037
Non quantifié actuellement, mais travail en cours pour obtenir les données nécessaires à une quantification.
Co-bénéfices
- Contact avec la nature bénéfique pour la santé physique et mentale.
Points de vigilance
- Nécessite des interventions cohérentes sur la durée pour que des effets soient effectivement observables.
Opportunités
- Renforcer l’aspect « parc urbain » du campus et en faire un exemple de gestion durable des espaces verts.
Atteindre un indice de canopée de 27% sur le campus de Dorigny.
Contexte
L’indice de canopée fait référence aux arbres de hauteur supérieure à 3 mètres. Il s’élevait à 23.3% en 2022.
La trame verte (arbustive et arborée) possède un rôle central pour améliorer l’état de la biodiversité sur le campus et ainsi lutter contre la perte locale de biodiversité. Elle permet également de lutter efficacement contre les îlots de chaleur.
Effets attendus d’ici 2037
Non quantifié actuellement.
Co-bénéfices
- Adaptation aux changements climatiques.
- Augmentation du confort des usager·ères du campus avec plus d’espaces verts et ombragés.
Points de vigilance
- Certains projets d’infrastructures, comme la renaturation de la Chamberonne, vont impliquer la coupe de certains arbres. Il est donc nécessaire d’anticiper la plante de nouveaux arbres qui auront besoin de plusieurs années pour atteindre 3 mètres.
Opportunités
- Renforcer la gestion agroécologique des surfaces agricoles du campus.