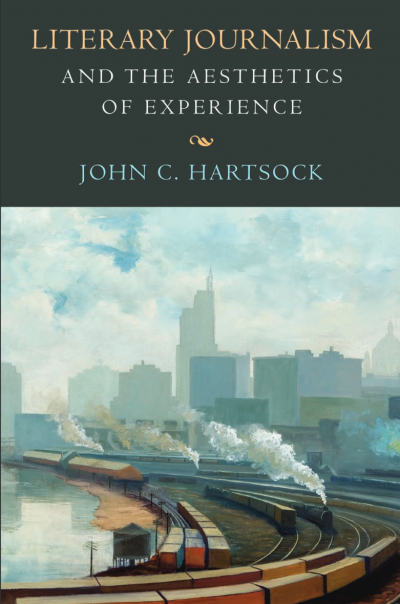La traduction de textes académiques constitue un élément essentiel de la circulation d’idées et donc de notions et de concepts. Ces derniers, produits dans certains contextes culturels et linguistiques, s’appliquent souvent au-delà de ces cloisons et sont généralement considérés comme des outils de réflexion partageables. Mieke Bal ([2002] 2023) les décrit comme « les outils de l’intersubjectivité [qui] facilitent le débat parce qu’ils forment un langage commun, un socle » (p. 47). Les concepts seraient une condition du dialogue et de la mise en relation des discours. Tout en jouant un rôle important dans la construction d’une réflexion interpersonnelle et, idéalement, interculturelle et interlinguistique, les notions et concepts présentent toutefois la même difficulté que tout autre mot au moment de leur traduction – voire suscitent un plus grand embarras encore, étant donné l’attention soutenue dont ils font souvent l’objet. Barbara Cassin a illustré ce paradoxe avec le Vocabulaire européen des philosophies. Dictionnaire des intraduisibles(2004), un ouvrage qui exemplifie la difficulté de faire circuler des concepts entre les langues en même temps que le caractère néanmoins ordinaire de cette circulation.
La traduction académique doit porter une attention particulière aux notions et concepts sur lesquels se fondent certaines réflexions entières. C’est le cas de certains domaines particulièrement techniques comme la narratologie. Cette dernière discipline connaît des configurations notionnelles assez délicates et difficiles à traduire, y compris entre le français et l’anglais, alors même que les deux espaces linguistiques et théoriques ont beaucoup échangé. Les termes d’« histoire », de « récit » et de « narration » peuvent a priori paraître équivalents de « story », « narrative » et « narration », d’autant plus que les travaux de Gérard Genette – qui, parmi d’autres, fait un usage intensif de cette triade en français – ont été traduits et sont fréquemment cités en anglais. Pourtant, les réalités recouvertes par ces trois termes en anglais ne correspondent pas toujours exactement à celles qui sont pensées par Genette. Un exemple devrait nous en convaincre, en même temps que nous réjouir : la difficulté que pose la traduction des notions et concepts offre aussi l’occasion d’en clarifier les usages ou de les assouplir – et cet assouplissement ne travaille pas toujours contre la possibilité d’un dialogue, parfois limitée par des usages trop rigides ou hermétiques.
Dans son livre Literary Journalism and the Aesthetics of Experience (2016), John Hartsock analyse le statut et les effets du journalisme littéraire, genre marginal et peu étudié s’il en est. Il applique les concepts narratologiques anglophones à des auteurs américains ayant réfléchi à la narration journalistique et son ouvrage semble cohérent à cet égard. Cette cohérence provient aussi de l’utilisation d’un système notionnel complexe et dense. John Hartsock cite Gérard Genette au moment de définir un « narrative », mais il semble que le sens de la triade « histoire », « récit » et « narration » connaît en anglais un déplacement subtil et surtout non signalé, ce qui peut générer des difficultés de compréhension chez les lecteurs et lectrices francophones de Gérard Genette.
La mobilisation du storytelling – terme rarement traduit en français, qui se trouve à la frontière entre récit et narration et qui est régulièrement utilisé pour insister sur l’aspect commercial du produit fini – permet notamment de décharger les deux derniers termes d’une partie de leur étendue sémantique. De même, en français, John Hartsock a composé un néologisme par l’articulation de deux notions habituellement distinguées, celles de narration et de description, avec le journalisme « narra-descriptif ». Ce rapprochement permet de représenter un type de récit dont John Hartsock constate l’usage intensif dans l’industrie journalistique. L’inexistence (ou l’usage marginal) de certaines notions qu’il mobilise en anglais dans la tradition francophone rend la traduction complexe. La traduction systématique des pseudo-équivalences – « story » en histoire,« narrative » en récit,« narration » en narration – s’avère insatisfaisante et c’est la nuance qui prévaut lorsque l’équivalence faillit. En parlant d’un reportage de Georges Orwell, John Hartsock explique par exemple :
He acknowledges, then, that he engages in digressive exposition but only in order to inform the subsequent narra-descriptive story. And indeed he does, because after the expository chapter he returns to his extended narra-descriptive intent. (p. 13-14).
Le terme « story », soit « histoire », apparaît. Or, la formule « narra-descriptive story » résiste à cette traduction par « histoire ». Une histoire « narra-descriptive » n’aurait en effet pas de sens en français, dans la mesure où l’on ne peut pas lui attribuer des « intentions descriptives » ou « narratives » – si l’on retient la définition donnée par Tzvetan Todorov ([1966] 1981) et reprise par la quasi-totalité des narratologues francophones, selon qui l’histoire est une « abstraction » qui « n’existe pas en soi », car elle « est toujours perçue et racontée par quelqu’un » ; elle « n’existe pas au niveau des événements eux-mêmes » (p. 133), mais en tant que représentée par le biais d’un récit produit par un acte de narration. On pourrait alors être tenté de rendre « story » par « récit » – contre la lettre du texte, mais conformément à son esprit –, et bien que « récit narratif » apparaisse comme redondant :
Il reconnaît son engagement sur une pente d’exposition digressive, mais seulement pour contextualiser le récit narra-descriptif ultérieur. Et, en effet, il contextualise puisqu’il retourne immédiatement à l’intention narra-descriptive après le chapitre expositoire.
Ce faisant, sommes-nous en train de corriger l’auteur, avec le risque de modifier sa pensée en y introduisant une rigidité étrangère (voire même une erreur d’appréciation quant au sens des termes utilisés en anglais) ou nous confrontons-nous à un vrai problème de traduction, que la permutation de deux termes résout en français ? Il n’y a pas de réponse évidente à cette question.
La définition donnée par John Hartsock peut permettre de comprendre ces difficultés. Lorsqu’il établit les notions essentielles à sa réflexion et qu’il cite Gérard Genette, il décrit le récit comme suit : « I draw here from narratology and use one of the most basic of widely accepted definitions of narrative, meaning “a sequence of events” » (p. 10). Pourtant Gérard Genette, dans « Frontières du récit » ([1966] 1981), définit le récit comme « la représentation d’un événement ou d’une séquence d’événements » (p. 152, je souligne). John Hartsock mentionne donc une définition de manière tronquée, en faisant correspondre le récit aux événements eux-mêmes et non à leur représentation – distinction qui fonde pourtant la logique de la triade chez Genette. Est-ce une inadvertance ou une différence théorique essentielle à la réflexion du critique américain ? Dans le second cas, celle-ci participe-t-elle d’un système notionnel plus complexe, qui intègre des concepts indigènes à la réflexion anglo-américaine ? Dès lors, ne faudrait-il pas laisser une part d’étrangeté à ces notions en les traduisant de manière littérale ? En même temps, le texte français apparaitrait sans doute difficile à lire, imprécis dans le cadre théorique francophone – et il vaudrait mieux, de ce point de vue, faire correspondre à chaque occurrence des notions son équivalent sémantique apparent, quitte à traduire « story » par des termes différents : parfois par « histoire », parfois par « récit ». Aucune solution ne s’impose d’elle-même.
Quoi qu’il en soit de l’option choisie, l’opération de la traduction permet d’interroger l’utilisation parfois figée de certains concepts et notions. Si elle loue leur pouvoir fédérateur, Mieke Bal ([2002] 2023) rappelle en effet que « les concepts ne sont ni fixes ni sans ambigüités » (p. 48). Ceux-ci portent en eux une part de flou. Régulièrement pas assez explicités (si bien qu’on ne sait quel terme sélectionner pour les traduire) ou trop précis (si bien qu’aucun terme ne semble convenir), ils cristallisent certains enjeux de la traduction académique. En même temps, l’opération de traduction permet peut-être, dans certaines circonstances, d’explorer ces ambigüités et de remettre du jeu dans cette fixité – et dès lors de repenser non seulement ces notions, mais encore les réalités qu’elles recouvrent. La traduction comme voyage géographique et linguistique apporte ainsi une plus-value qui ne se résume pas à la mise en circulation internationale des textes et des idées, mais intéresse directement leur (ré)élaboration.
Bibliographie
BAL Mieke, 2023, Concepts itinérants : comment se déplacer dans les sciences humaines (2002), trad. Cécile Dutheil de La Rochère, Dijon, Les Presses du réel.
CASSIN Barbara, (dir.), 2004, Vocabulaire européen des philosophies : dictionnaire des intraduisibles, Paris, Seuil.
HARTSOCK John C., 2016, Literary Journalism and the Aesthetics of Experience, Amherst, University of Massachusetts Press.
GENETTE Gérard, 1981, « Frontières du récit », Communications, no 8, « L’analyse structurale du récit » (1966), dir. Roland Barthes, Paris, Seuil, p. 152-163.
TODOROV Tzvetan, 1981, « Les catégories du récit littéraire », Communications, no 8, « L’analyse structurale du récit » (1966), dir. Roland Barthes, Paris, Seuil, p. 125-151.