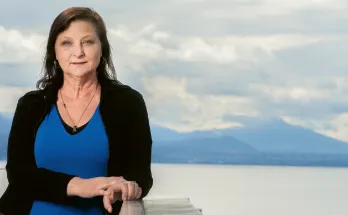Vêtue d’une blouse de laboratoire bleue, les mains dissimulées dans une paire de gants chirurgicaux, Charline Carron transporte des petites fioles de liquide rose stériles de l’incubateur à 37°, jusqu’à l’abri de la hotte sous laquelle elle s’apprête à les manipuler. Son terrain de recherche, c’est le cerveau. Et ce jour-là, elle doit respecter des timings précis – soit toutes les six, quatre et deux heures – pour injecter un traitement dans des cellules souches de souris.
La Valaisanne a rejoint le laboratoire Toni du Centre de neurosciences psychiatriques de l’UNIL-CHUV en 2018 lors de son travail de master. Depuis 2019, elle y poursuit une thèse sur l’Effet d’un peptide sécrété par les astrocytes sur la neurogenèse adulte hippocampale. Lauréate de plusieurs prix durant le concours 2023 de vulgarisation scientifique «Ma thèse en 180 secondes», Charline Carron y a brillamment filé une métaphore sur le jardinage pour expliquer son travail au grand public. Elle y a comparé l’hippocampe du cerveau humain à un jardin dans lequel se développent des neurones. Et son travail, c’est d’étudier l’engrais qui les fait pousser.
Au départ, elle pensait avoir trouvé une molécule clé contre le traitement des pertes de mémoire. Mais en été 2023, soit une année avant la fin de son doctorat, tout a bifurqué. La molécule découverte s’est en fait révélée efficace dans la gestion du stress. «Ce n’est pas impossible qu’elle agisse aussi sur la mémoire, mais je n’ai pas réussi à le prouver», précise la doctorante.
Lorsque des mois de travail sont ainsi brusquement remis en question par l’arrivée d’un élément nouveau, le choc est parfois dur à encaisser. «On a l’impression d’avoir travaillé dans le vide», reconnaît Charline Carron. Et au cours d’un doctorat, elle admet que «des moments où on n’y croit plus, il y en a beaucoup». Elle se souvient d’ailleurs, amusée: «Deux semaines après avoir commencé ma thèse, un collègue en post-doctorat m’avait demandé en rigolant combien de fois j’avais déjà pleuré». Surprise, la chercheuse n’avait sur le moment pas compris le sens de la remarque. Mais très vite, la réalité l’a rattrapée. «Au final j’ai souvent débarqué en flaque dans le bureau de mon directeur», confie Charline Carron.
Le nerf de la guerre
Si, dans la recherche, les revirements sont monnaie courante, il faut du temps pour les apprivoiser. Et le doctorat sert aussi à ça. «Une thèse, c’est d’abord apprendre à faire de la science, et comprendre que ce n’est pas que des résultats. On fait de la recherche, pas de la trouvaille.» Une réalité parfois difficile pour le mental: «Dans les sciences dures, je pense qu’on traverse plus de downs que de ups. On enchaîne les séries d’expériences et ça n’aboutit pas toujours à ce que l’on veut .» Pour Charline Carron, le nerf de la guerre aura été d’apprendre à remonter la pente: «J’ai compris que la machine ne devait jamais s’arrêter complètement, au risque de ne plus repartir. Il faut accepter de tourner à bas régime. La science n’est jamais un processus rapide. C’est l’ego qui pousse à penser ça.»
Malgré tout, c’est avec enthousiasme et bonne humeur que Charline Carron évoque son quotidien de doctorante. Nul doute qu’elle s’y épanouit. «Une recherche, c’est un mystère à découvrir, une énigme qui nous tient en haleine, c’est motivant. Au fond, j’adore ce monde». /