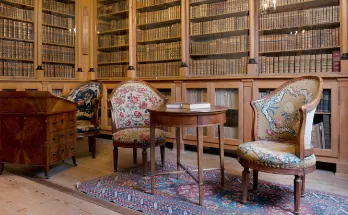Les Jeux olympiques de Paris ne sont plus qu’un souvenir, ils ont toutefois laissé des belles traces. Parmi elles, cet impressionnant catalogue d’une exposition qui s’est tenue au Musée du Louvre entre avril et septembre 2024. Sous le titre L’Olympisme. Une invention moderne, un héritage antique, elle entendait montrer combien les chefs-d’œuvre d’art antique conservés dans ses collections «ont nourri l’inspiration de ceux qui, à la fin du XIXe siècle, ont fait (re)naître les Jeux».
Il s’agissait, dans un premier temps, d’évoquer les cadres et les acteurs de ce mouvement. L’occasion de révéler le rôle largement méconnu joué par un artiste d’origine suisse installé à Athènes, Émile Gilliéron, qui travaillait comme restaurateur et dessinateur pour tous les archéologues actifs dans le pays. Dans la deuxième partie qui oppose invention et héritage, Pierre Ducrey, professeur honoraire et ancien recteur de l’UNIL, se penche avec humour et passion sur les liens entre l’athlétisme et l’entraînement militaire dans le monde grec.
Étaient-ils complémentaires ou antagonistes? Comme les similitudes entre les disciplines sportives et les techniques de combat sont flagrantes, on penche dans un premier temps pour la première hypothèse. L’auteur toutefois nous prévient: «L’entraînement au gymnase est loin de faire l’unanimité, en particulier dans les cités réputées pour leur valeur guerrière.» Autre idée reçue mise à mal, la fameuse trêve olympique mettant temporairement fin à la guerre. «Elle ne concernait que certains lieux et un nombre limité de personnes, pour une période bien définie», précise Pierre Ducrey. Qui conclut: «L’universalité prêtée à la trêve olympique est sans doute le mythe le plus fermement attaché aux concours gymniques de la Grèce ancienne.» / Mireille Descombes
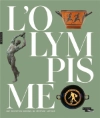
À quoi carbure-t-on en Suisse ?
Cet ouvrage indispensable présente l’histoire de l’énergie en Suisse, depuis les débuts de l’industrialisation jusqu’à nos jours. Le texte traverse les composants du mix énergétique au fil du temps, depuis la force humaine et animale jusqu’au renouvelable, en passant par le bois ou le nucléaire, sans oublier l’hydroélectrique, une spécialité helvétique. Les liens que la production, la distribution et la consommation d’énergie entretiennent avec l’économie, la société et l’environnement sont traités, tout comme le fait que, dans ce domaine, la Suisse n’est pas isolée du reste du monde.
L’approche historique offre un peu de hauteur et de nuance face à des sujets de débats réguliers, par exemple autour de la danse entre la substitution et l’addition des énergies dans le mix suisse. «Alors que le nucléaire n’a pas conduit à un abandon de l’hydroélectricité, le boom du pétrole constitue bien une transition conduisant à une diminution drastique de la consommation de charbon.» / DS
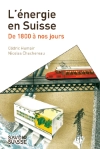
Notice sur LabeLettres, site de la Faculté des lettres
Un vieux couple dysfonctionnel
Quelle est l’histoire des liens entre le sport et le tourisme, depuis le XIXe siècle jusqu’à nos jours? Dans l’une des contributions de cet ouvrage académique, Grégory Quin, maître d’enseignement et de recherche à l’Institut des sciences du sport, nous emmène par exemple à Saint-Moritz. Peu après la Seconde Guerre mondiale, alors que la pratique du ski n’était pas «massifiée», un projet de téléphérique menant au Piz Nair a été mis sur pied. Parmi ses soutiens, deux riches touristes, l’armateur Stávros Niárchos et l’héritier Loel Guinness.
Malgré la crainte que les bâtiments édifiés en altitude n’altèrent le panorama, les installations sont inaugurées le 1er janvier 1955. L’investissement s’avère rentable. La fréquentation de la station est multipliée par 2,5 entre les hivers 1950-51 et 1960-61. D’autres constructions de téléphériques, comme celui de Corvatsch, mettent en lumière, déjà, la tension entre les dividendes du tourisme et la protection du paysage. / DS