
Depuis une quinzaine d’années, la nature semble reprendre ses droits dans les milieux urbains, qui aiment à la redécouvrir, à coups de potagers urbains, pelouses en friche et autres réalisations végétalo-architecturales tape-à-l’œil. Le point avec Joëlle Salomon Cavin, spécialiste en Aménagement du territoire, et le biologiste Daniel Cherix.
Rat des villes ou rat de champs? Longtemps, il fallait choisir son camp. Les amoureux de la nature se décidaient souvent à prendre le large pour la campagne, tandis que les âmes citadines se rendaient dans les grandes villes, abandonnant leur bout de terre familial pour un mode de vie jugé plus moderne.
Aujourd’hui, la séparation entre milieu urbain et paysan n’est plus aussi radicale. Alors qu’il y a encore quelques décennies, on cantonnait la nature en ville à quelques pelouses de ronds-points fleuries et millimétrées, à présent les villes s’amourachent des espaces verts à gogo, entre talus laissés en friche, potagers urbains et autres créations architecturales invitant le végétal au cœur même de leur concept.
Sur ce point, l’exemple le plus récent et notoire n’est autre que ce gratte-ciel qui devrait prochainement être érigé à Chavannes, dans le quartier des Cèdres, soit une tour de 117 mètres de haut, avec 35 étages, mais aussi 80 arbres et 3000 mètres carrés d’arbustes sur ses terrasses! A noter encore que cette «tour-forêt», imaginée par l’architecte Stefano Boeri, a été votée à l’unanimité, et ce même face aux projets présentés par des noms illustres comme Mario Botta – c’est dire l’engouement actuel pour ce genre de réalisations vertes.

Nicole Chuard © UNIL
Une «vraie» nature?
Mais que penser de cette tendance actuelle? Augure-t-elle d’un vrai retour de la nature en ville, ou ne faut-il n’y voir qu’un attrait purement esthétique, et donc forcément passager?
Pour Joëlle Salomon Cavin, maître d’enseignement et de recherche en Politiques territoriales à l’UNIL, il est important de préciser que «la nature en ville a toujours existé, mais elle a longtemps été niée». La spécialiste en veut pour preuve le cas probant des naturalistes (biologistes, écologues, etc.) qui ne s’étaient jusque-là jamais intéressés à cette nature au cœur des villes: «Celle-ci ne leur paraissait tout simplement pas digne d’intérêt, en tout cas pas comme pouvait l’être celle que l’on trouve dans des espaces sauvages.»
Or, depuis quelques années, fait remarquer la chercheuse, «les protecteurs de la nature reviennent en ville. Des acteurs comme Pro Natura se soucient de cette «sous-nature» urbaine qu’ils avaient toujours jugée sans valeur, soit parce qu’ils la considéraient inintéressante en soi ou comme trop modifiée par l’homme.» Joëlle Salomon Cavin évoque alors les pionniers de l’école d’écologie urbaine, à Berlin, dans les années 80: «Ils ont été les premiers à s’intéresser à la nature en ville et à démontrer qu’il y avait de la biodiversité en milieu urbain.» Mieux: «Que la ville pouvait même être un refuge pour certaines espèces chassées des périphéries urbaines par l’agriculture intensive!»
La chercheuse cite alors l’exemple emblématique du faucon pèlerin: «Cet oiseau est un chasseur de mulots, mais ceux-ci ont été décimés par l’agriculture. Le rapace s’est donc déplacé ces dernières années en ville, où il a pu trouver d’autres petits animaux à manger. Il est dès lors devenu une espèce urbaine.»
Changement de perspective
Est-ce à dire que l’on aurait sous-estimé les villes en tant que terres d’accueil de la biodiversité? «Totalement», répond Joëlle Salomon Cavin qui cite encore «la variété de mousses et lichens apparemment exceptionnelle en milieu urbain». Et de conclure: «Cette prise de conscience a bouleversé notre imaginaire traditionnel selon lequel il n’y aurait pas de nature en ville, ou qu’une pauvre nature, et que la campagne serait le lieu de la nature par excellence. Or il y a des zones extrêmement polluées et stérilisées dans les espaces agricoles, et de réels écosystèmes en milieux urbains. La distinction entre la ville qui serait stérile et la campagne fertile est aujourd’hui totalement dépassée.»
Ce changement de perception apparaît en effet des plus radical, et n’allait de ce fait pas manquer de modifier la manière même de gérer ces espaces de nature en plein cœur de nos cités, comme nous le confirme Daniel Cherix, professeur honoraire au Département d’écologie et d’évolution: «Depuis une quinzaine d’années, beaucoup de choses ont changé. Principalement, on est passé de l’obsession de la tondeuse à gazon à un entretien différencié.» Soit à des interventions qui se veulent aujourd’hui respectueuses des particularités de chaque site.
Même observation du côté de la spécialiste en Politiques territoriales de l’UNIL: «Dans les services de gestion des espaces verts, on a largement abandonné une perspective très horticole pour une vision plus orientée sur l’écologie et la gestion des biotopes. De nouvelles préoccupations ont émergé, en lien avec des soucis de conservation de la nature, alors qu’auparavant on ne considérait les espaces verts urbains que comme des espaces à aménager.»
Le grand retour du «naturel»
Révolu désormais, le penchant très helvète d’entretenir tous les espaces verts d’une ville de manière standardisée! Aujourd’hui, les villes souhaitent prendre en compte les spécificités de chaque zone verte, pour mieux les accompagner dans ce qu’elles nomment dorénavant «leur vocation». «Dans la pratique, et en caricaturant un peu, un jardinier ne sera plus amené à entretenir de la même manière le gazon d’une piscine et, à l’autre extrême, un talus en bord de route», expose, de façon des plus limpide, la brochure sur le sujet édité par la Ville de Lausanne, «véritable précurseur en la matière», selon le professeur.
Outre la mise en place d’une fauche tardive de ses talus en vue de préserver la biodiversité de leur flore et petite faune, la capitale vaudoise s’est également engagée à stopper toute utilisation de pesticides, se réjouit le biologiste. A cela s’ajoute encore, précise-t-il, la participation de la ville à des programmes européens, comme le «Urban bees». Soit l’aménagement d’«hôtels pour les abeilles sauvages», qui jouent un rôle essentiel dans la pollinisation de toutes sortes de plantes, sauvages ou cultivées, et aussi des arbres fruitiers. Des actions qui marquent, on ne peut que le constater, un réel progrès en matière de biodiversité. Ce d’autant plus que les initiatives des collectivités se conjuguent avec une réelle prise de conscience au niveau de la population, qui se révèle toujours davantage soucieuse de ces questions.
«Toutes les études montrent aujourd’hui que les gens, s’ils ont le choix, optent toujours pour un aménagement plus naturel», note le biologiste. «Il y a une véritable prise de conscience qui fait que la majeure partie des mesures prises par les différents services en faveur de l’environnement vont être bien acceptées.» Mieux: de plus en plus de particuliers se lancent dans des projets en lien avec ce retour de la nature en ville. Les jardins urbains et autres potagers associatifs sont dans ce sens en pleine expansion dans les villes. «Les citadins veulent aujourd’hui de la nature à leurs portes», relève Joëlle Salomon Cavin. «Ces potagers et pratiques jardinières urbaines sont, pour beaucoup de gens, une manière de retrouver un lien avec la terre et les saisons, qui leur manquait.»
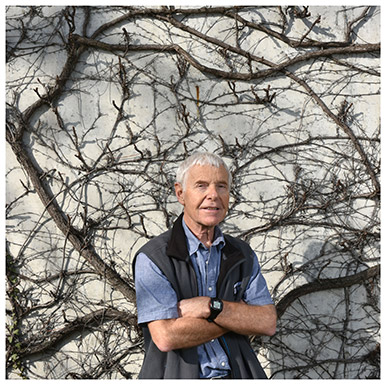
La biodiversité en fête?
Ville et nature seraient donc aujourd’hui à nouveau réunies pour le meilleur? «Tout n’est pas aussi rose que cela», nuance Daniel Cherix. Car si la préservation de la biodiversité est le principal avantage de cette révolution, «il faut encore habituer les gens aux conséquences de ces changements», souligne-t-il. «Si un talus fleuri paraît spontanément très sympathique, le changement est plus difficile à accepter pour ce qui est des parcs et autres zones de délassement…»
Certes, selon les différentes études, nous relate Daniel Cherix, une très grande majorité des citadins se déclarent en faveur de la protection de l’environnement. Mais le fait est que souvent ces derniers idéalisent cette nature qu’ils veulent à tout prix remettre dans leur quotidien. «Prenez l’exemple du loup», expose le biologiste. «En ville, près des deux tiers de la population sont favorables au loup, tandis qu’à la campagne vous n’en trouverez à peine que 2?% en sa faveur.» Le cas de figure est certes extrême, mais il illustre bien la différence de mentalités entre citoyens des villes et citoyens des champs, certainement plus conscients des problèmes que peut aussi poser la nature.
Le biologiste cite un exemple plus répandu pour illustrer son propos: celui de cette mode des années 80 qui était de créer ce que les gens appelaient à tort des biotopes, soit un petit étang dans leur jardin. «En théorie, ces initiatives étaient des plus heureuses car en Suisse, près de 70?% des zones humides avaient disparu en moins d’un siècle.» Pourtant, la réalité n’était pas celle escomptée par les propriétaires de ces jardins: «Ils s’imaginaient avec des libellules, des coléoptères aquatiques et n’avaient à aucun moment songé aux grenouilles qui viendraient chanter au printemps sous leurs fenêtres.» Et d’ajouter: «Ils ont préféré alors mettre dans leur mare des poissons rouges et des tortues qui n’ont rien à faire dans cet environnement. Le fait est que les gens adoptent une attitude nature, mais ne sont pas prêts à accepter les conséquences qui vont avec. Ils veulent bien d’une gouille d’eau dans leur jardin mais ne veulent pas les espèces locales qui vont s’y inviter parce qu’elles font du bruit ou en tout cas dérangent d’une manière qui ne leur est pas supportable.»
Problèmes de cohabitation
Hommes et faune sauvage ne font peut-être pas si bon ménage que ça, n’en déplaise aux utopistes. «Certains problèmes de cette cohabitation ne sont clairement pas réglés», expose le biologiste, en citant notamment les dégâts importants causés par certaines espèces comme les étourneaux, les corneilles ou encore les fouines: souillures d’excréments, câbles rongés, graines déterrées, etc. Et le problème se pose également dans l’autre sens: l’arrivée (ou la prolifération) de certaines espèces en ville ne signifie pas pour autant qu’elles y trouvent un habitat qui leur soit bénéfique…
«Il ne faut pas oublier qu’en ville, on demeure dans un écosystème en partie artificiel», rappelle Daniel Cherix. «La lumière et le bruit représentent d’importants facteurs de stress sur certaines populations, notamment sur les passereaux. Car s’il y a de la lumière, cela signifie qu’il peut y avoir un prédateur», explique-t-il. «Les oiseaux ne vont donc dormir que d’un œil et cela va avoir des impacts négatifs sur leur physiologie.»
Autre problématique urbaine, la nourriture trop grasse ingurgitée par les moineaux des villes: «Ce facteur graisseux trop important chez les jeunes individus va avoir des conséquences sur leurs capacités à pondre des œufs à l’âge adulte. Ce qui au final va aller dans le sens d’un déclin de cette population urbaine», note encore le biologiste.
Mais alors, au final, que faut-il en déduire de ce rapprochement entre le vert et le bitume? «La cohabitation a ses limites. On n’a pas encore réussi à résoudre un certain nombre de problèmes.» Et surtout: sera-t-on prêt à y apporter les solutions qui s’imposent? «Il y a des aménagements possibles pour limiter la lumière dans les villes par exemple, comme avec le système testé à Yverdon où les réverbères ne s’allument qu’au passage des promeneurs.» S’en donnera-t-on les moyens? L’avenir nous le dira. Quant aux désagréments de la nature sauvage, le biologiste reste lucide mais confiant: «Il y aura encore tout un travail à faire pour expliquer aux gens qu’on ne peut pas vouloir un jardin naturel sans moustiques ni araignées. C’est difficile pour nos générations de changer de mentalités, mais nos enfants grandissent avec ces idées. Nous avons fait le premier pas, ils feront sûrement le deuxième.»
De l’agriculture au cœur de nos cités
La demande pour des produits locaux et des circuits courts stimule le mélange entre urbain et rural. Même si nous sommes encore loin de transformer tous les espaces verts en champs.
Depuis plusieurs années, le monde agricole s’est également rapproché des villes. «Physiquement, c’est une évidence», lâche Joëlle Salomon Cavin. «En périphérie des villes, il y a de plus en plus de champs côtoyant des constructions. Ce mélange entre urbanisation et agriculture se fait pour le pire et le meilleur.» Car si voitures et tracteurs ne font pas bon ménage et qu’il n’est jamais agréable de voir son champ enclavé par des bâtiments, «cette proximité favorise les circuits courts», note la spécialiste. «Il y a une demande urbaine très forte pour l’agriculture de proximité, notamment ce qu’on appelle l’agriculture contractuelle de proximité avec ces fameux paniers maraîchers», souligne la chercheuse. «C’est une manière de rapprocher le consommateur et le producteur, mais aussi un engagement de la part du consommateur à soutenir un certain type d’agriculture.»
Sur les toits
Que pense-t-elle de ces spéculations quant à ces «Edible Cities», soit littéralement ces «villes consommables»? «Il y a beaucoup de fantasmes autour de cette notion de villes productives. Beaucoup de délires d’architectes ou de paysagistes aussi qui nous donnent à voir des villes où l’on transformerait tous les toits et parcs en champs. Mais il y a aussi des choses concrètes qui se font.» Avec les étudiants du séminaire d’«agriculture urbaine», elle mène justement «des réflexions quant aux possibilités réelles de développer en ville une agriculture sur les toits». Et de citer encore «des projets, comme à Genève, d’intégration de fermes dans les espaces publics, ces fameux parcs agro-urbains, qui sont une autre manière d’intégrer concrètement l’agriculture dans la fabrique d’une ville. C’est intéressant, mais moins spectaculaire…»



